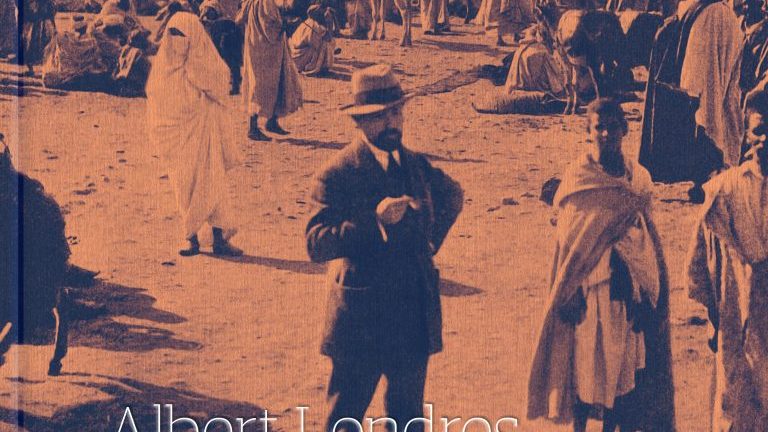En 1989 est tombé le Mur, mais aussi l’URSS, la fracture Est-Ouest, et le monde bipolaire que ce schéma portait. L’échiquier mondial subit le dégel et se refaçonne. Au Moyen-Orient, en Afrique, les cartes sont égale¬ment rebattues. Le XXIe siècle est multipolaire. Chacun cherche sa position sur la scène internationale.
Des reporters sont allés au front pour raconter ces nouvelles fractures et nous faire vivre l’histoire sur le vif avec une focale centrée sur les lieux chauds de la planète, ceux qui s’embrasent, ceux qui explosent. Leurs articles ont été primés pour l’observation fine qu’ils portent, mais aussi pour leur qualité d’écriture. Les reporters primés alors avaient moins de 40 ans.
Tous les articles primés depuis 1989 rassemblés en un seul ouvrage.
680 pages regroupant 103 reportages exceptionnels de la presse française édités par Les Arènes.
Jean-Claude Guillebaud
Prix Albert-Londres 1972
« Soyons nets : depuis 1989, durant ces trente dernières années, le monde a plus changé que pendant le siècle qui précédait. Et d’abord pour les journalistes confrontés à des tragédies sans équivalent dans l’histoire, à des formes nouvelles de violence et de massacres, et donc à un « retour du tragique ». Pensons aux épouvantes du Rwanda, à la sauvagerie des tueries irakiennes et syriennes, à l’obscénité des exterminations revendiquées et affichées par des groupes terroristes comme le prétendu État islamique ou Al-Qaïda. Sans parler du 11 septembre 2001. Tous ces événements ont métamorphosé le métier de reporter. L’importance prise par le « front médiatique » (souvent plus décisif que les affrontements sur le terrain) a fait, par exemple, de chaque journaliste autre chose qu’un simple témoin. À son corps défendant, il devient souvent un protagoniste des événements.
À cause de ces transformations, le métier de journaliste ne pourra plus jamais être ce qu’il était. Il devra d’abord s’émanciper du « médiatique » en flux tendu qui prend la main jour après jour, le plus souvent pour le pire. Cette évidence nous renvoie à l’exaspération de Paul Valéry pour « l’événement ». Lequel, réduit à lui seul, nous aveugle au lieu de nous éclairer. En réalité les bouleversements du monde incluent les tragédies citées plus haut, mais se situent à un tout autre niveau. Si le monde ancien disparaît, c’est qu’il est déjà disloqué par plusieurs séismes tectoniques des profondeurs. Séismes ou mutations, c’est affaire de vocabulaire.
Le premier séisme est géopolitique. On pourrait l’appeler le décentrement du monde. Il correspond à une remise en marche de l’histoire après l’effondrement du communisme. Au partage entre l’Est et l’Ouest, à cette « guerre froide » qui structurait la planète depuis 1917, succède un monde polycentré qui, de la Chine à l’Inde ou au Brésil, voit émerger de nouvelles puissances. Lorsqu’on évoque ce planisphère redessiné et cette redistribution de l’influence, on oublie d’ajouter qu’il marque la fermeture d’une parenthèse de quatre siècles. Quatre siècles durant lesquels l’Occident (c’est-à‑dire l’Europe et les États-Unis) avaient été les maîtres du monde.
À partir du XVIIe siècle, après avoir rattrapé son retard sur les autres grandes civilisations, l’Europe avait conquis une quadruple hégémonie : militaire, économique, technologique, culturelle. Cette surpuissance avait fait de nous les conquérants du monde (colonisation) et les initiateurs de la modernité.
Pendant quatre siècles la marche de l’histoire fut gouvernée à partir d’un centre (l’Occident) qui dominait et « civilisait » (croyait-il) la périphérie, soit par les armes, soit par l’influence, le plus souvent en combinant les deux. Cette centralité et ces hégémonies appartiennent dorénavant au passé. Nous ne sommes plus les uniques propriétaires ni promoteurs de la modernité. Les attentats du 11-Septembre – le Nine Eleven – en furent le signe le plus tangible. Et sanglant.
Le monde doit être raconté « autrement ».
La deuxième mutation, économique celle-là, c’est la mondialisation. Contrairement à ce qu’on dit parfois, elle n’est pas le simple prolongement des mondialisations passées, notamment celle du xixe siècle. Les nouvelles technologies lui donnent une portée et un rythme sans précédent. C’est peu de dire qu’en matière d’économie et de démocratie cette mondialisation-là change les règles du jeu. L’économie de marché, jusqu’alors parquée dans l’enclos de l’État-nation qui pouvait donc démocratiquement la réguler, s’est libérée de toute attache. La voilà hors d’atteinte de l’éthique démocratique minimale.
En cavalant sans brides ni contraintes à travers le monde, le tout-puissant marché montre sa capacité à produire de la richesse, certes, et plus efficacement que l’économie administrée de l’ex-URSS. Mais il inflige en passant d’énormes dégâts aux sociétés qu’il traverse. Outre la richesse, il produit de la pauvreté et de l’injustice. Le libre marché obéit à un seul principe (le profit) tellement unidimensionnel qu’il en devient stupide. Il prétend appliquer à toutes les activités humaines l’unique critère de la rentabilité. Il est conduit, sur le long terme, à détruire pierre à pierre le socle (la société) qui lui permettait d’exister.
Quand on répète qu’il faut « réguler » la mondialisation, on exprime à demi-mots une véritable urgence : repasser à l’économie de marché le licol de la démocratie. Et enclore à nouveau ce puissant mécanisme dans les limites d’un espace juridique contraignant : nation, ensemble régional, fédération ou autre. On répugne pour l’instant à choisir la taille de l’enclos.
Il faudra bien s’y résoudre.
Le troisième séisme a révolutionné quant à lui la biologie : c’est la révolution génétique. Amorcée au milieu des années 1950, elle n’a pris son envol qu’au début des années 1980. Pour définir de façon sommaire cette mutation, on dira qu’elle donne aux hommes, pour la première fois dans l’histoire, le pouvoir d’agir directement sur les mécanismes de la vie. Nous savions transformer le monde, détourner le cours des fleuves et percer les montagnes. Nous pouvons désormais intervenir sur la procréation et modifier le génome des espèces végétales ou animales. Nous pouvons transformer certaines données fondatrices de l’humain comme les structures de la parenté, ou l’ordre généalogique.
Cette mutation-là est aussi directement politique. On l’a vu au sujet du mariage gay, de l’IVG, de la gestation pour autrui, etc. Mais dans mille autres domaines elle est riche de promesses. Pensons à l’ouverture que représentent la thérapie génique et la médecine prédictive ; songeons au pouvoir de donner la vie qui est restitué à ceux – couples ou individus – qui en étaient privés ; comptons sur nos doigts les maladies incurables possiblement vaincues ; gardons en tête les nouveaux appareillages technologiques du corps humain qui, à terme, peuvent rendre la vue aux aveugles, la mobilité aux amputés et la socialisation aux tétraplégiques.
Cette liste de promesses doit être mise en miroir avec une autre liste, celle qui répertorie les menaces historiquement inventoriées. Elles sont innombrables elles aussi : eugénisme réinventé, clonage, discrimination des humains en fonction de leur « patrimoine génétique », post-humanisme et retour du surhomme des nazis, etc. Entre ces deux listes, les citoyens que nous sommes ont la responsabilité historique de faire pencher la balance du bon côté.
La quatrième mutation est induite par les technologies les plus avancées : on l’appelle communément la révolution numérique. C’est sans doute elle qui, d’ores et déjà, a chamboulé notre rapport au réel, aux autres, à la politique, et bien entendu au journalisme. Rendue possible par l’usage généralisé des algorithmes mathématiques, elle nous précipite vers l’immatériel, c’est-à‑dire une déréalisation progressive du monde, qu’analysa avec lucidité le regretté André Gorz, disparu en 2007. Ramenée à une suite de 0 et de 1, la réalité devient saisissable, archivable et transmissible à l’infini.
Cet ébranlement ne se réduit pas à ces mille commodités qui fluidifient notre vie quotidienne : ordinateurs, téléphones portables, cartes mémoire, etc. Une métaphore permet de s’en faire une idée plus juste : celle du sixième continent. Ce dernier – Internet, la Toile, le Web, selon la terminologie choisie – a surajouté un immense territoire virtuel aux espaces géographiques traditionnels. Ce continent virtuel est partout et nulle part. Nous n’avons pas encore appris à le définir. Nous manquons encore des concepts nécessaires. Quant à l’État de droit, il peine – et peinera longtemps – à s’y installer pour le civiliser. Le sixième continent est encore une jungle qui abrite le meilleur et le pire, tout le savoir du monde et toute la saloperie humaine.
Dans l’aventure, et sans que nous l’ayons voulu, nos activités et nos professions subissent une métamorphose. Elles changent de statuts, de règles et de sens. La culture devient « connaissance » ; la finance devient un orage magnétique permanent qui fait circuler des milliers de milliards de dollars « virtuels » d’un bout à l’autre de la planète ; les réseaux sociaux bousculent les hiérarchies et les pouvoirs alors même que la démocratie à l’ancienne, affaiblie, demeure prisonnière des anciens territoires.
L’avènement du sixième continent est ambivalent lui aussi. D’un côté il offre un accès illimité à tous les savoirs, de l’autre il permet l’arraisonnement du réel par le virtuel. Quand les « marchés financiers » dictent leur loi aux économies réelles, c’est bien de cela qu’il s’agit. D’un délire dominateur. Et sans issue. Comme l’écrivait André Gorz dans L’Immatériel (Galilée, 2003), « ce sont les capacités qui excèdent toute fonctionnalité productive, c’est la culture qui ne sert à rien qui, seules, rendent une société capable de se poser des questions sur les changements qui s’opèrent en elle et de leur imprimer un sens ». Les nouvelles dominations sont plus difficiles à débusquer que celles de jadis. Mais elles sont toujours là. C’est bien le problème.
Reste le cinquième « tremblement de terre » historique : la prise de conscience écologique. Nous réalisons depuis une trentaine d’années que l’entreprise prométhéenne des humains bute sur une infranchissable limite. Le remodelage anthropocentré de la planète, tel que la culture occidentale le met en œuvre depuis des siècles, s’abîme dans une contradiction : on ne peut déployer un projet de croissance infinie à l’intérieur d’un monde fini.
En nous mettant sous les yeux les saccages de la Terre et l’épuisement de ses ressources, la conscience écologique nous révèle l’approche d’une impasse. Est-ce si nouveau ? On objectera que le souci de l’environnement ne date pas d’hier. Et on aura raison. De Rachel Carson (Le Printemps silencieux, 1963) à Bernard Charbonneau (Le Jardin de Babylone, 1969), ou Jacques Ellul (La Technique ou l’enjeu du siècle, 1954) et bien d’autres encore, l’écologie a une longue histoire. Elle a eu ses réseaux (La Gueule ouverte dans les années 1970) et ses fanatiques (l’Américain Lynn White et les tenants de la deep ecology dans les années 1960).
Il n’empêche. Un seuil qualitatif et politique a été franchi durant ces dernières décennies, un degré d’urgence absolue est atteint. Du coup la courte vue de la plupart des décideurs et des champions du « médiatique » nous mettent au défi. Depuis janvier 2017, l’un de ces décideurs irréfléchis n’est autre que Donald Trump, ce docteur Folamour devenu président des États-Unis.
Les journalistes du monde entier sont confrontés, en plus des autres, à un énorme défi politique.
Gageons qu’ils sauront le relever. »