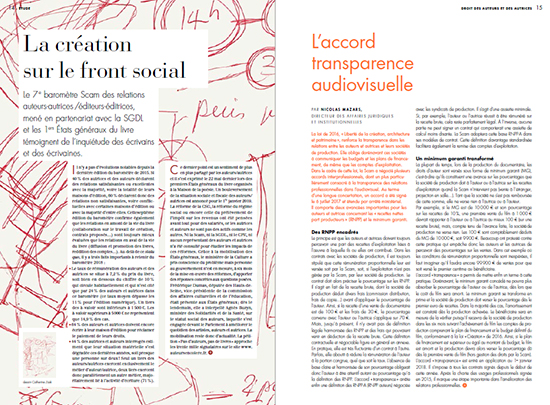Confrontés depuis des années à la dégradation de leurs conditions de travail, les traducteurs et traductrices, adaptateurs et adaptatrices de l’audiovisuel tirent la sonnette d’alarme. Un article du journaliste Charles Knappek pour la lettre Astérisque n°60.
Sale temps pour les traducteurs et traductrices, adaptateurs et adaptatrices de l’audiovisuel. Tarifs en baisse, délais raccourcis, charge de travail alourdie, manque de considération… : la liste des griefs est longue pour ces maillons essentiels, mais trop peu connus de la chaîne de production audiovisuelle. Professionnels à leur compte, travaillant la plupart du temps depuis leur domicile, ils retranscrivent en français le travail des réalisateurs et réalisatrices de documentaires télévisés étrangers. En voice over (un comédien ou une comédienne lit leur texte par-dessus la version originale) ou en sous-titrages, leur mission implique une large part de création ; elle est à ce titre rémunérée en droits d’auteur. « Nous traduisons et adaptons la pensée du réalisateur, résume Laurence Vager, du haut de ses vingt-deux ans d’expérience. Sans nous, les programmes étrangers n’auraient pas de public dans les pays francophones ». Sur les 177 260 heures diffusées en 2015 et réparties en 2016, 36 % ont été adaptées, ce qui montre assez bien l’importance du travail des quelque mille deux cents traducteurs/adaptateurs exerçant en France et enregistrés à la Scam.
Pourtant, la profession est plus sinistrée que jamais. « On nous demande de faire plus, plus vite et pour moins cher », pointe Brigitte Hansen, bientôt vingt-cinq ans de métier au compteur. À travail égal, ces professionnels perçoivent entre 30 et 40 % de moins qu’au début des années 2000. Une étude de l’Association des traducteurs/adaptateurs del’audiovisuel (Ataa) menée auprès de cent cinquante personnes établit même que la rémunération au sous-titre a chuté d’environ 60 % depuis le milieu des années 1980.
Si les plus anciens tirent encore leur épingle du jeu grâce à la perception de droits de diffusion qui représentent jusqu’à plus de la moitié de leurs revenus, ce n’est pas le cas des nouveaux entrants, qui ne peuvent compter, dans un premier temps, que sur leurs droits d’auteur. Les droits de diffusion s’acquièrent avec les années et sont d’autant plus importants que l’ancienneté n’offre aucune garantie d’être mieux payé. C’est même l’inverse : « Quand j’ai débuté, en 2000, on pouvait obtenir un tarif au feuillet d’environ 35 €, c’était correct. Aujourd’hui, on est content quand on obtient 20 €
du feuillet », témoigne Sylvain Gourgeon. « Nous ne sommes pas en mesure d’imposer nos tarifs », abonde Claudia Faes, qui exerce depuis 1989 et estime à « un tiers » la baisse de ses revenus depuis dix ans.
Horaires à rallonge
Le temps de travail s’en ressent pour qui veut maintenir son niveau de rémunération : « J’allume mon ordinateur à 7 h 30 et je l’éteins rarement avant 23 h 30 », indique Brigitte Hansen. La banalisation des horaires à rallonge tient notamment à l’évolution des modes de rémunération. Alors qu’il était autrefois la norme, le paiement au feuillet tend à devenir l’exception, supplanté par le forfait, voire la rémunération à la minute parlée, qui ne tiennent compte ni l’un ni l’autre de la charge de travail réelle. Un documentaire animalier avec peu de texte et un épisode de téléréalité « très bavard » seront ainsi payés au même tarif quand l’un aura nécessité trois jours de travail et l’autre une semaine.
Des tâches annexes (traduction des génériques, listing des intervenants, manipulations techniques sur le logiciel de montage…) qui ne relèvent pas, en théorie, des fonctions de l’adaptateur, ont, en plus, été progressivement ajoutées au cahier des charges. Sans pour autant faire l’objet de rémunérations spécifiques. « Avant, les relectures croisées étaient payées. Maintenant, elles sont incluses dans la prestation globale et réalisées par un binôme qu’on ne connaît pas forcément », illustre Olivia Azoulay, trente-neuf ans, dont quinze dans le métier.
En raison de leur inexpérience, les jeunes sont particulièrement confrontés à cette surcharge de travail. Une adaptatrice affichant moins de trois ans d’ancienneté explique avoir toujours effectué ces tâches parce qu’elle pensait que « cela faisait partie du job ». « Maintenant je n’ose plus les refuser », confie-t-elle. « La réalité, c’est que les relectures sont de moins en moins faites parce que, il ne faut pas se leurrer, la motivation est faible quand on n’est pas payé », déplore une adaptatrice chevronnée, qui ajoute : « C’est un manque de respect des chaînes à l’égard du téléspectateur et cela participe de la baisse générale de qualité et d’exigence qu’on observe à tous les niveaux de la production culturelle ».
On aurait pu imaginer que l’apparition des chaînes de la TNT dans les années 2000 et, plus récemment, de la télévision à la demande offrirait de nouveaux débouchés à la profession. Les formations diplômantes créées par plusieurs universités ont alimenté ce sentiment : chaque année, quelques dizaines de jeunes actifs arrivent sur un marché qui n’a pourtant que peu d’opportunités à leur offrir. « Le système s’est industrialisé, constate Sylvain Gourgeon. Les chaînes sont de plus en plus nombreuses et cherchent d’abord à remplir leurs grilles à peu de frais. » Les exigences des services de vidéo à la demande comme Netflix amplifient encore cette logique d’abattage. « Une série est traduite et mise en ligne d’un seul coup, témoigne Laurence Vager. Nous n’avons même plus le temps de nous harmoniser entre nous quand nous travaillons à plusieurs sur le même programme. » « Certaines productions sont proposées sur les plateformes de vidéo à la demande vingt-quatre heures après leur diffusion en version originale, confirme Julie Verdalle, vingt-six ans, dont deux et demi comme adaptatrice. Les gens ne veulent plus attendre, les diffuseurs non plus, et nous nous retrouvons en bout de chaîne à devoir travailler de plus en plus vite ».
Facteur aggravant, les professionnels français sont confrontés à la double concurrence d’équipes de traducteurs montées à l’étranger, au Maroc notamment, qui tirent les tarifs vers le bas, et dans le même temps à l’émergence des fans subs, ces amateurs fans de série qui sous-titrent eux-mêmes leurs programmes favoris. Les fans subs, en particulier, nuisent à la profession car ils produisent très vite et parfois pas trop mal. « Cela donne l’impression aux labos que n’importe qui peut faire notre métier », pointe Julie Verdalle. « Quand j’ai débuté en 2000, on me demandait mes diplômes, aujourd’hui ce n’est plus le cas », constate sa consœur Céline Coussedière. Moins exigeantes que par le passé, les chaînes sont entrées dans une logique de réduction des coûts mortifère pour la profession. « Elles mettent une pression monumentale sur les labos, elles sont en situation de toute-puissance pour faire jouer la concurrence et nous servons de variable d’ajustement », dénonce Olivia Azoulay. Les marges de manœuvre existent pourtant. Impliquée au sein de l’Ataa et jeune professionnelle, Lilia Adnan pointe les différences de tarifs pratiqués pour un même programme par deux labos différents, ce qui, selon elle, « montre bien que les chaînes ont les moyens de financer correctement leurs programmes quand elles le souhaitent ».
« On n’est pas des cheminots »
Les adaptateurs et adaptatrices souffrent particulièrement de leur invisibilité dans la chaîne de production. « Notre poste est devenu anecdotique dans l’esprit des chaînes de télévision, pourtant il reste essentiel, décrypte Olivia Azoulay. J’en suis venue à me demander si les responsables de programmation s’imaginent que les traductions sont effectuées par des programmes informatiques. » Il est vrai que les traducteurs et traductrices ne voient presque jamais leurs clients. « J’en ai rencontré un une fois, mais sinon tout se passe toujours au téléphone », confirme Céline Coussedière.
Pour l’heure, rien ne laisse présager une amélioration de la situation, en grande partie par défaut d’une mobilisation générale et concertée. « On n’est pas des cheminots, ironise Claudia Faes. Le public ne nous connaît pas, nous sommes peu nombreux et les labos trouvent toujours des gens qui acceptent de travailler à bas prix. » L’une de ses consœurs n’exclut pas, cependant, de lancer une opération « Name and shame » si les tarifs continuent d’être tirés vers le bas.
Pour les traducteurs/adaptateurs, la véritable pierre d’achoppement serait une remise en question du système actuel des droits de diffusion. La disparition de ces derniers serait perçue comme « catastrophique ». L’absence d’accord entre Netflix et la Scam conduit déjà à leur quasi inexistence sur les programmes de vidéo à la demande, de l’ordre de quelques centimes. « La question de la diffusion délinéarisée est un enjeu important des prochaines années, assure Sylvain Gourgeon. Si les droits de diffusion ne suivent pas, je serai contraint de changer de métier. » Plus optimiste, Olivia Azoulay estime que le système a atteint ses limites dans sa configuration actuelle : « On est en train de toucher le fond, maintenant cela ne peut que remonter ».
> Lire l'article – pdf
> Lire La Lettre Astérisque n°60 – pdf