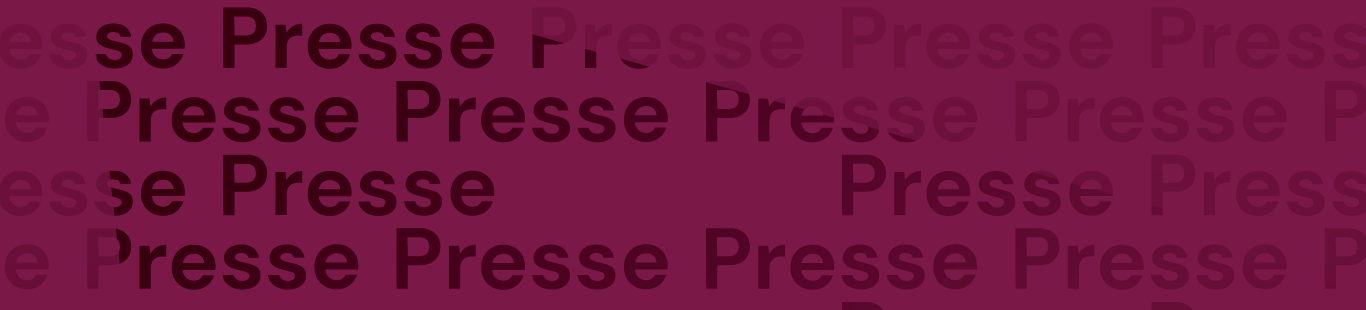
17 janvier 2024
Etats généraux de l’information : constats et propositions de la Scam
Forte de sa légitimité dans la défense des droits d’auteurs des journalistes, la Scam formule des propositions.
Pluralisme et indépendance de l’information
Concentration des médias
La concentration des médias menace l’exercice indépendant du métier de journaliste et la liberté d’informer. C’est un enjeu majeur qui touche tous les citoyens, et dont les pouvoirs publics, garants de l’intérêt général, doivent s’emparer.
La concentration des médias français dans les mains d’une poignée d’actionnaires, de capitaines d’industries, parfois pétris d’ambitions idéologiques, et de grands groupes qui détiennent une majorité des médias privés d’information en France, alimente les soupçons et la défiance du public et laisse à penser que les garde-fous en matière de concentration dans le secteur des médias ne sont aujourd’hui pas capables d’assurer le pluralisme de manière satisfaisante.
En matière audiovisuelle, le dispositif anti-concentration contenu dans la loi de 1986, texte ravaudé et mal adapté aux enjeux liés à la concentration dans un monde numérique, reste focalisé sur les médias hertziens. Il existe par ailleurs des dispositions sur la presse mais rien véritablement sur le numérique.
L’édition contribue à informer l’opinion publique, à développer l’esprit critique. Elle joue un rôle crucial dans la préservation de l’intégrité de l’espace public et fait partie des domaines essentiels au fonctionnement de nos sociétés démocratiques.
Pour cela, ces professionnels – journalistes et écrivains – doivent pouvoir exercer leur métier en toute indépendance. Or ils sont de plus en plus confrontés à des risques d’ingérences dans leurs décisions éditoriales. Ce sont ainsi parfois des livres d’enquêtes ou d’humour empêchés de paraître car ils portaient préjudice aux actionnaires des maisons d’édition qui entendaient les publier.
Le règlement européen sur la liberté des médias (EMFA), sur lequel un accord politique a été trouvé en « trilogue » le 14 décembre dernier, apporte des réponses sur la transparence de la propriété des médias, mais aucune véritable disposition sur le contrôle des concentrations.
Sur ce point, nous proposons de suivre les recommandations de l’IGF et de l’IGAC, dans leur rapport de mars 2022, qui pointait l’obsolescence du « cadre juridique du contrôle sectoriel des concentrations spécifique aux médias […], dans ses outils et dans son approche ». Ses rédacteurs proposent d’y substituer une approche centrée sur les médias d’information et, sur une appréciation au cas par cas de l’Arcom, avec des modalités souples, plutôt que sur des seuils stricts.
Transparence et indépendance des journalistes
Dans son préambule, la déclaration des devoirs et des droits des journalistes dite Charte de Munich (1971) précise que : « La responsabilité des journalistes vis-à-vis du public prime sur tout autre responsabilité, en particulier à l’égard de leurs employeurs et des pouvoirs public ».
Les fréquents mouvements et rapprochements capitalistiques dans le secteur des médias, compromettent parfois la transparence sur l’actionnariat des groupes concernés. Elle constitue
pourtant un élément essentiel de nature à renouer un lien de confiance avec le public. La loi Bloche de 2016 s’étant révélée inefficace ou non respectée, il importe de créer de nouvelles
dispositions.
Les orientations stratégiques d’une entreprise de médias exercent une influence majeure sur l’information diffusée. Trop souvent, les journalistes en sont exclus. Ils doivent pouvoir participer activement à la gouvernance de leur média, sans être soumis aux décisions stratégiques du seul actionnaire. Ces modèles vertueux, à l’image par exemple de celui du groupe Le Monde, doivent être généralisés. Ils passent par l’intégration d’une représentation du personnel salarié dans les organes de gouvernance en leur attribuant des droits de vote au même titre que les autres membres et l’exercice d’un « droit d’agrément » au personnel salarié sur tout changement d’actionnaire entrainant un changement de contrôle du média.
En réaction aux menaces sur la liberté d’exercer le métier de journaliste, la Scam s’est ainsi associée au collectif « Informer n’est pas un délit » qui portait plusieurs revendications fortes lors d’un communiqué publié en décembre 2022, notamment :
✓ La création d’un statut juridique des rédactions, pour ancrer leur indépendance et limiter l’interventionnisme de leurs actionnaires ;
✓ La création d’un délit de trafic d’influence en matière de presse, pour sanctionner tout interventionnisme abusif des propriétaires et dirigeants de médias quand ils ont pour objectif de favoriser leurs intérêts ou ceux d’un tiers ;
✓ De meilleures garanties pour la protection de l’honnêteté, de l’indépendance et du pluralisme de l’information, notamment par la clarification du rôle de chaque entité dans l’écosystème de régulation et de protection de la liberté d’information (Arcom, comités d’éthique, de déontologie…)
Secret des sources
En France, les récents éléments d’actualité qui mettent en cause le secret des sources de façon récurrente ou portent atteinte à la liberté d’informer peuvent être relevés avec inquiétude. C’est ainsi que la Scam, aux côtés de l’Association Albert Londres, a souhaité, à l’occasion de la perquisition et de la garde à vue de la journaliste Ariane Lavrilleux, et dans le cadre d’une information judiciaire pour compromission du secret de la défense nationale, rappeler le caractère fondamental du secret des sources.
Le recours à la loi sur le secret de la défense nationale pour justifier l’utilisation de moyens de surveillance d’exception destinés en principe à la lutte antiterroriste, soulève des inquiétudes en matière d’Etat de droit.
Ces dérives sont permises par la rédaction actuelle de la loi du 4 janvier 2010, dite loi « Dati » qui légitime l’atteinte directe ou indirecte au secret des sources des journalistes au motif de « l’impératif prépondérant d’intérêt public ». Une notion vague et imprévisible qui laisse à l’appréciation du seul gouvernement de décider ce qui relève de l’intérêt supérieur de la nation.
Sur ce sujet, l’EMFA contient de nombreuses garanties censées permettre aux journalistes l’exercice de leur profession. Le texte final, qui a fait l’objet d’intenses tractations, ne devrait finalement permettre la surveillance des journalistes que de manière exceptionnelle et sur décision judiciaire. Nous regrettons que le gouvernement français ait fortement œuvré pour une disposition beaucoup plus souple, qui aurait justifié la surveillance par un impératif flou de « sécurité nationale ». Il faudra être attentif dans l’avenir à ce que les principes du règlement bénéficient d’une juste application.
Il faudra dans l’avenir modifier la loi et la mettre en conformité avec le droit européen pour mieux articuler et hiérarchiser les règles applicables et définir clairement ce que recouvre la notion d’« ’impératif prépondérant d’intérêt public » voire subordonner à une décision du juge, l’autorisation d’appliquer l’exception.
Carte de presse
Un grand nombre de journalistes se heurte depuis plusieurs années, à la difficulté d’obtenir ou de renouveler l’attribution de leur carte de presse auprès de la commission compétente. En effet, la CCIJP apprécie, en conformité avec le code du travail (art. 711-3)2, si le candidat tire de son activité de journaliste « le principal de ses ressources ». Or, le même code du travail attribue une présomption de salariat (existence d’un lien de subordination) à tout journaliste travaillant régulièrement dans le domaine de la presse écrite ou de l’audiovisuel (Loi Brachard 1935 et loi Cressard 1974 qui l’étend aux pigistes).
Ainsi, dans la pratique, pour délivrer la carte de presse, la commission réclame que la majorité des revenus du demandeur soit perçue en salaires, sans que cette règle ne soit toutefois appliquée de manière inflexible. Les journalistes qui s’illustrent dans le secteur audiovisuel sont parfois auteurs-réalisateur.ices de reportages et documentaires ou photojournalistes, et nombre d’entre eux sont amenés à percevoir une majorité de leurs revenus en droits d’auteurs : soit parce que les droits versés par la Scam (de première diffusion, de rediffusion, de copie privée…) dépassent les autres rémunérations perçues, soit, malheureusement, parce que certains commanditaires les rémunèrent majoritairement en droits d’auteur. Ils et elles ne sont pas responsables de cette situation qui les privent trop souvent de leur capacité à obtenir la carte de presse, ou à en obtenir le renouvellement.
Il semble aussi exister un problème de fond : la difficulté d’admettre que le travail de certains réalisateurs de documentaires puisse aussi être celui d’un journaliste : même salariée, la prestation d’un auteur-réalisateur de documentaire est directement estampillée « qualification professionnelle non-journaliste » par la CCIJP, à tout le moins en première instance. Or, si les deux métiers s’avèrent être différents lorsqu’il s’agit de réaliser des documentaires ou des reportages qui ne portent pas sur l’Information ni sur un travail d’enquête ou d’investigation, il est indispensable, pour un certain nombre de documentaristes indépendants qui mènent un véritable travail de journaliste, de pouvoir disposer d’une carte de presse.
La détention de la carte de presse, si elle n’est pas du tout obligatoire pour être journaliste, est un sésame précieux : un outil qui permet à son titulaire de franchir les frontières pour couvrir une zone de conflits, d’accéder à un événement réservé aux accrédités ou à des contacts institutionnels, et plus généralement d’être immédiatement identifié comme « journaliste professionnel ».
Si chacun s’accorde aujourd’hui à reconnaître qu’il ne faut pas remettre en cause le cadre légal du statut protecteur des journalistes (loi Brachard et loi Cressard), sur lequel s’appuie la CCIJP, il parait urgent de réfléchir à d’autres moyens de délivrer la carte de presse, qui n’auraient d’incidence ni sur le plan social ni sur le plan fiscal. Les droits d’auteurs pertinents doivent pouvoir être clairement et officiellement pris en compte dans l’enveloppe des revenus examinés par la CCIJP.
Il serait opportun d’étudier la piste d’une évolution du fonctionnement de la commission de la carte.
Dès le stade de la demande auprès de la CCIJP, pour faciliter et accélérer le travail des instances d’examen du dossier, il conviendrait d’opérer deux couloirs/formulaires distincts assortis d’une période de délivrance propre :
– celui des journalistes-salariés (CDI/CDD/Pigistes) : ils fourniraient comme aujourd’hui sans changement les éléments justifiant de leur activité professionnelle ;
– celui des journalistes « indépendants » qui fourniraient la preuve que leurs revenus sont issus majoritairement de leur activité journalistique, laquelle serait attestée par un « CV » illustré
par les documents écrits sonores ou audiovisuels qu’ils ont écrits et réalisés. Et ce sur une période de deux ans ; avec communication des preuves de rémunération (notes de droits
d’auteur, factures, fiches fiscales).
Une telle réforme ne porterait aucune atteinte au statut actuel des journalistes salariés et préserverait les acquis législatifs légitimement défendus pas les organisations syndicales. Mais elle ouvrirait en quelque sorte une « seconde voie » respectueuse du travail journalistique absolument incontestable effectué par nombre d’auteurs qui vivent sans aucune contestation de leur activité de journaliste. Il s’agit d’une mesure d’équité indispensable.
Compte tenu de l’importance de cette problématique dans l’exercice des professions que nous défendons, la Scam demande aux EGI de faire des propositions constructives permettant de sortir de l’ornière et d’assurer pour tous ceux et toutes celles qui, à l’évidence font du journalisme, des conditions de travail équitables.
Droits voisins des éditeurs et agences de presse
Ensemble, éditeurs, agences de presse et journalistes ont combattu pour instaurer au niveau européen, un droit voisin pour la presse afin de garantir la liberté de l’information en rééquilibrant le partage de revenus avec les GAFAM.
Or, quatre ans après l’adoption de la loi sur le droit voisin, force est de constater que cet instrument juridique ne se présente toujours pas comme l’outil espéré de rééquilibrage de la valeur entre grandes plateformes et éditeurs. Des accords se concluent en ordre dispersé en fonction des différentes familles de presse.
Afin d’assurer aux auteurs journalistes la part qui leur est due sur cette utilisation particulière et massive de leurs œuvres, une application effective de la loi doit impérativement être mise en œuvre aujourd’hui et, compte tenu de la forte asymétrie des acteurs en présence impose que le pouvoir politique s’implique pleinement en prenant des positions fortes en faveur des ayants droit. En France, les syndicats représentatifs des journalistes, en lien étroit avec la Scam, ont exprimé officiellement leur préférence pour une gestion collective5 et un partage proportionnel aux recettes des sommes collectées.
Afin d’assurer aux ayants droit, journalistes et autres auteurs, la juste part qui leur revient, la Scam recommande que les évolutions législatives et / ou réglementaires nécessaires mettent en place un principe de gestion collective obligatoire.
En tout état de cause, la SCAM, en accord avec les syndicats de journalistes, considère que la rémunération à verser aux journalistes par les éditeurs, ne doit pas être inférieure à 35% des sommes perçues auprès des plateformes en ligne.
Financement de l’audiovisuel public
Dans ce contexte de crise de l’information, il est essentiel que les médias audiovisuels publics, premiers pourvoyeurs de programmes à caractère documentaire, et régulièrement cités dans les enquêtes d’opinion comme médias de confiance, puissent continuer de les proposer au public. Les économies imposées aux diffuseurs publics depuis de nombreuses années ont déjà affaibli leur capacité à couvrir certains sujets, comme les actualités de l’Union européenne, en comparaison avec leurs homologues européens. Si la loi de finances 2024 a bien concédé une augmentation de 6% au financement de l’audiovisuel public, correspondant au niveau de l’inflation, son avenir n’est pas assuré au-delà du 31 décembre de cette année. En effet, à la suite de la suppression de la contribution à l’audiovisuel public, il a été décidé qu’une part du produit de la TVA serait affectée à ce financement, sans que ce dispositif ne puisse continuer de s’appliquer en 2025 et après. Une proposition de loi organique pour le pérenniser a bien été déposée à l’Assemblée nationale en juin 2023 mais n’est pour l’instant pas à l’ordre du jour de la chambre basse.
Dans le cadre d’un financement désormais assuré par une dotation publique sans contribution citoyenne dédiée, il semble urgent de pérenniser le choix fait sur l’affectation d’une part du produit de la TVA pour assurer à l’audiovisuel public les moyens qu’il mérite.
Intelligence Artificielle
Chat-GPT, Midjourney, Dall-E … les logiciels d’intelligence artificielle (IA) sont entrés dans le quotidien des citoyens et s’immiscent dans les entreprises de médias.
Le développement d’une intelligence artificielle non-régulée soulève des craintes légitimes chez les journalistes.
D’une part certains voient leurs professions directement menacées par le remplacement par des outils d’IA, comme l’ont expressément annoncé certains titres de presse.
D’autre part, des contenus « d’hypertrucage » (deepfakes) ont fait entrer les infoxs et la manipulation de l’information dans un nouvel âge. Un rapport de l’ONU publié en juin dernier a qualifié de danger « sérieux et urgent » la génération de contenus de médias par des intelligences artificielles et amené les Etats à prendre des mesures de régulation. Le Forum économique mondial, qui se réunit mi-janvier, s’inquiète des risques de la désinformation, portées notamment pour les élections à venir, un danger particulièrement préoccupant en 2024, « hyper-année » électorale. Ces informations, fausses ou manipulées par les intelligences artificielles, sont classées comme premier risque mondial pour les deux années à venir par un rapport du Forum.
La promotion des IA génératives dans la presse sans délimitation claire de son périmètre d’usage banalise le pillage des données travaillées et publiées par la profession. C’est pourquoi la transparence sur les données d’entraînement et sur les contenus générés par les outils d’IA permettrait d’apporter les garanties minimales aux journalistes comme aux citoyens.
Le projet de règlement sur l’intelligence artificielle encore en négociation à Bruxelles, doit absolument intégrer des obligations de transparence solides, et dans un format suffisamment détaillé. Le secteur reste mobilisé malgré un soutien atone voire une hostilité des pouvoirs publics français sur ce texte.
Respect des droits d’auteur des photographes
La Scam, avec les autres organisations représentatives du secteur de l’image fixe, souhaitent alerter les pouvoirs publics sur le constat désarmant d’une véritable paupérisation du secteur du photojournalisme. L’enquête Photojournalistes : une profession sacrifiée, conduite par la Scam en 2015 est toujours d’actualité. Cette dégradation des conditions de travail se manifeste par plusieurs points dont certains ont été mis en exergue par de récents rapports remis au ministère de la Culture à savoir : le recours abusif par les éditeurs de presse à la mention « droits réservés », l’absence de respect des crédits photographiques et l’écrasement des métadonnées. A ces éléments s’ajoutent des problèmes structurels concernant, notamment, l’absence de réévaluation des barèmes de pige devenus inadaptés à la réalité du secteur et la syndication des contenus sans rémunération supplémentaire.
Par ailleurs, les éditeurs de presse nouent avec l’Etat des conventions-cadre concernant l’octroi d’aides à la presse. Ces conventions font peser sur les éditeurs de presse le respect d’obligations réglementaires ainsi que de bonnes pratiques professionnelles et prévoient un mécanisme de malus en cas de non-respect de ces obligations. A ce titre, une entreprise de presse qui signe une convention cadre avec l’Etat s’engage à respecter les dispositions du Code Brun-Buisson et certaines obligations comme le respect des métadonnées et des crédits photographiques.
La Scam, ainsi que les autres organisations représentatives du secteur, demandent que leur soient communiquées le contenu de ces conventions et un meilleur encadrement de leur application, principalement par la mise en place du malus prévu lorsque l’éditeur de presse ne respecte pas ses obligations quant à la mention des crédits et le recours à la mention droits réservés par exemple.