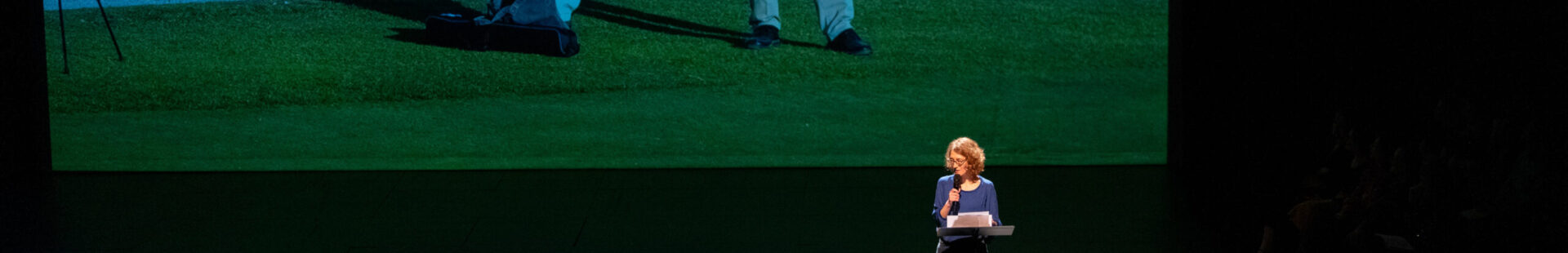
2 mai 2025
Comment transposer le réel ? #23
« Chercher le romanesque »par Pauline Horovitz
Comment tout a commencé
Un jour, j’ai débarqué chez un garçon qui était avec moi à l’école primaire. J’avais 28 ans, je faisais un court-métrage pour une revue documentaire d’Arte dont le thème était l’amour. J’avais proposé de faire quelque chose sur ma malchance sentimentale, principalement due à ma prédilection pour les amours à sens unique. J’avais d’abord demandé à des amis de jouer à faire semblant d’être d’anciens béguins. Cela ne marchait pas, cela sonnait faux. Alors, j’avais cherché ce qu’étaient devenus mes authentiques béguins de jeunesse, et c’est comme ça que je m’étais retrouvée devant la porte de David. Il s’est exclamé en me voyant arriver, caméra (massive) sur le dos – c’était une P2 -, trépied (massif également) en bandoulière : « Je t’imaginais devenir scientifique, toute seule dans un laboratoire, derrière un microscope. Je ne te voyais pas faire des films. »
Moi non plus, je ne me voyais pas faire des films. Je suis myope et j’ai peur de tout. Résultat, en plus d’être nulle au ballon prisonnier, comme me l’a rappelé David lors nos retrouvailles, je passe mon temps à me cogner : aux murs, aux choses, aux autres. Pourtant, j’ai choisi de faire des films documentaires, soit un métier collectif, qui m’oblige à sortir de chez moi et à parler à des inconnus.
A la recherche du « trop beau pour être vrai » (mais quand même vrai)
Quand je vois mes films, je me dis que cela ne passerait jamais dans une fiction – par exemple, mon père sur la scène du Cours Florent, en train d’imiter une poule ou d’enlacer une jeune femme. Ou lorsque j’avoue à David que j’avais le béguin pour lui en CM2. Ou quand l’historien Tal Bruttmann me renvoie dans les cordes quand je m’évertue à lui faire résumer en deux mots la bande dessinée Maus (« Est-ce qu’on résume Primo Levi ? Est ce qu’on résume Charlotte Delbo ? Non ! »).
Ce que je recherche dans le réel, ce sont ces moments où il se fait romanesque, où il devient aussi étincelant que la fiction.
J’ai développé un tempérament de chien truffier pour repérer dans la vie ce qui est romanesque. J’entends par là les aspérités, les incongruités, le grain de sel qui relève la monotonie du quotidien, l’équivalent du punctum dont parlait Barthes à propos de la photographie, pas forcément spectaculaire, l’accroc dans la toile. Tantôt l’inquiétante étrangeté, tantôt le grain de folie ou le burlesque.
Je suis bluffée par les absurdités de la vie, qui a plus d’imagination, de fantaisie ou de perversité que n’importe quel scénariste. Je les affronte mieux quand je peux en faire un film. Avec la caméra, je me sens capable d’aller partout, de poser toutes les questions, même et surtout les plus bêtes. Que ce soit aux supporters ultras dans un stade bondé (alors que j’ai horreur de la foule), à mon père (à qui je suis incapable de livrer le fond de ma pensée en temps ordinaire) ou à un éleveur de crocodiles en appartement (j’ai horreur des bêtes). Derrière la caméra, je suis à ma place.
Ce que je recherche dans le réel, ce sont ces moments où il se fait romanesque, où il devient aussi étincelant que la fiction.
Pauline Horovitz
Des films en forme de contes
Je voudrais que mes films soient aussi captivants que Les enfants du paradis ou Les sentiers de la gloire. Pour captiver le spectateur, à partir d’un matériau documentaire, j’ai recours aux artifices de la fiction : unité de temps, de lieu et de personnage, et un argument simple. Soit le contraire de la vie, dans laquelle on est bien obligé d’accepter tous les encombrements, et où on n’a pas la boussole d’un film à faire. Pendant un film, on est obsessionnel : tout ce qui ne concerne pas le film, on l’écarte. Et comme on est obsessionnel, tout ce qu’on traverse fait sens par rapport au film. Barthes dit que l’amoureux voit des signes partout. C’est pareil quand on réalise un film. Pour Papa s’en va, dans lequel mon père part à la retraite et monte sur les planches, les textes qu’il joue sur scène parlent de la mort et de la solitude. Je n’ai jamais su si le professeur les avait choisis exprès pour le film, ou si c’était seulement une coïncidence.
Ce matériau documentaire a beaucoup à faire avec ma propre famille. Il y a des raisons pratiques : je les ai sous la main, je les connais par coeur (ou presque), et notre lien fait qu’ils acceptent de se prêter au jeu devant ma caméra, même s’ils ne sont pas d’accord avec le résultat, et me demandent régulièrement quand est-ce que je fais un « vrai » film, avec des acteurs, une histoire imaginée et imaginaire, bref, quelque chose de plus sexy qu’un documentaire ! Cela me complexait à une époque ; quand on me demandait sur quoi portaient mes documentaires, j’avais honte de dire que je faisais principalement des films avec ma famille, et surtout mon père – bonjour le cliché de la relation oedipienne. Mais après tout, la famille est le premier cercle. Un cercle avec ses rôles, ses archétypes, que tout le monde reconnaît. Comme dans les contes.
Je me suis aperçue que la plupart de mes films commencent par « Un jour ». Un jour, mon père est parti à la retraite (Papa s’en va). Un jour, un garçon est parti en disant je vais tuer Hitler (Je vais tuer Hitler). Ce sont des sortes de contes. Je fais parfois l’analogie avec les films de Claude Sautet : mes films sont des formes closes, des bulles, des univers, qui sont imparfaits mais qui ont une cohérence que le réel n’a pas. Ainsi, dans la vraie vie, mon père n’est pas aussi audacieux que dans Papa s’en va, la rédemption par le théâtre n’a eu lieu que partiellement – et la vraie tragédienne de la famille, c’était ma tante Suzanne, mais elle est morte.
Ce sont aussi des contes, parce que je montre des personnages qui ont leurs défauts, mais des défauts inoffensifs, qui rentrent dans ma comédie documentaire. Je me sentirais très démunie à l’idée de filmer des gens qui feraient vraiment le mal, parce que mes films reposent sur l’humanité des gens que je filme, leurs défauts sympathiques.
Ce sont aussi des contes parce que mes personnages, qui sont aux prises avec l’horreur de l’existence (l’angoisse, la maladie, la mort), opposent des stratégies absurdes et attendrissantes, dans l’espace de jeu que leur offre ma caméra. Dans la vraie vie, on n’est pas protégé par la fabrication d’un film (soit comme personnage, soit comme réalisateur), le réel cogne plus fort.
La direction d’acteurs
Pister le romanesque, cela passe essentiellement par la recherche et le choix des personnes que je filme, que ce soit dans ma famille ou en général, puis par un travail de direction d’acteur au tournage, et d’assemblage et d’écriture au montage, pour faire d’eux des personnages. Je les choisis parce qu’ils ont pour la plupart quelque chose d’extraordinaire, et la générosité (ou l’inconscience) d’accepter de se laisser diriger par moi et de devenir partie prenante de mon récit. C’est la partie la plus délicate de mon travail, les convaincre d’accepter, celle où je me ronge les ongles à côté du téléphone ou devant mes mails, quand j’attends leur réponse.
Ensuite, je les dirige comme des acteurs à qui on proposerait des exercices d’improvisation : je leur donne un thème (pour mon père dans Papa s’en va, la retraite), et je les guide avec une grille de questions, souvent brèves et pragmatiques. J’accueille les digressions. Parfois cela donne lieu à des dialogues savoureux, que je serais incapable d’inventer. Ainsi, ma soeur, à propos de la différence entre les garçons et les filles (Pleure ma fille tu pisseras moins) : « Francis Lalanne, il a les cheveux longs et des bottes, mais c’est pas une fille ! ».
L’idée n’est pas tant de recueillir une parole inédite (encore que), mais vivante et incarnée. Ce sont leurs mots, et en même temps c’est autre chose, quelque chose de plus brillant que la vie ordinaire, de plus coloré, de plus incandescent, d’exacerbé. La concentration et l’attention produites par le tournage créent un précipité, comme en chimie (je reviens au labo auquel David me croyait vouée). Par exemple, la scène de la dispute entre ma tante Suzanne et mon père au milieu de Papa s’en va, qui choque certains. C’est rare de voir une vraie dispute dans un film documentaire (tout comme de voir des gens faire l’amour). D’une certaine façon, cette dispute, je l’ai provoquée, parce que j’étais en train de faire un film. Dès que la caméra s’est éteinte, les relations sont redevenues plus paisibles, et, d’un point de vue cinématographique, beaucoup plus plates.
A mon grand dam, je suis souvent en retard sur mes personnages, je rate des moments, n’étant pas comme l’homme à la caméra de Dziga Vertov. Une fois, sur un tournage, j’ai été là au bon moment : quand Fred, l’animalier passionné de serpents de Peur sur la ville, me dit à propos de son python récemment décédé : « Barjot, je l’ai toujours, il est au congélateur. Je n’ai pas pu le jeter, ni l’enterrer. Alors je l’ai mis au congélateur. Un jour, je l’enterrerai. » Est ce qu’une telle réplique ne passe qu’en documentaire, parce qu’elle est sincère et qu’on sait que c’est authentique ?
Fred, je l’ai filmé dans plusieurs films. Il a, comme ma tante Suzanne, un naturel sans filtre, sans surmoi, et un vrai tempérament de comédien. Les gens comme eux sont rares. Quand on se croise dans la vie, il est toujours content de me voir, mais ce n’est pas la même chose que lorsqu’on tourne. Le tournage densifie l’extraordinaire.
Le tournage densifie l’extraordinaire.
Pauline Horovitz
Faire sentir le hors champ
« C’est pas fait pour être vu, c’est fait pour être là » : je reprends les paroles de Jacotte, modèle d’un des Portraits XL d’Alain Cavalier, à propos du bazar qu’elle entrepose hors de vue dans le grenier de sa maison.
On a tous un monde intérieur, plus ou moins perceptible, qu’on ne voit pas mais qui est là, comme les reliques de Jacotte. Je ne raconte pas tout, je ne montre pas tout – et je ne sais pas tout -, mais je cherche à faire sentir le hors champ des personnes que je filme. Pour ne pas en rester au brillant, au bon mot, à l’anecdote ou au sketch. Qu’on sente qu’il y a autre chose, et que cette autre chose fasse ressortir le brillant.
Ainsi, de Papa s’en va : feel-good movie au premier abord, mais avec tout un arrière-plan morbide, celui de mon père, empêché et « destiné à travailler », préoccupé de sa finitude imminente, et celui de sa famille, obsédée par la survie à tout prix.
J’essaie de faire sentir ce hors champ par mon travail sur le cadre et le décor, que je m’efforce de styliser sans l’aseptiser. Dans Papa s’en va, l’appartement paternel est filmé comme une scène de théâtre, mais une scène dont on devine le capharnaüm en limite de cadre, un capharnaüm à la fois burlesque et inquiétant, reflet de la psyché du personnage de mon père dans le film.
Que je filme d’éminents historiens devant leur bibliothèque (Récit de l’enfer d’Auschwitz), des philosophes au Musée de la chasse et de la nature (Ma guerre des mondes) ou mon père sur fond de papier peint psychédélique, j’essaie de sortir du cadre conventionnel et convenu, de composer mon plan. Qu’il produise un tableau, non pas un simple instantané, et un tableau signifiant. Le plus difficile, c’est quand mes personnages habitent ou travaillent dans des lieux « sans qualités », par exemple des bureaux modernes où rien n’accroche le regard ou des intérieurs bien rangés où rien ne dépasse, faciles à vivre, mais peu photogéniques. Comme dans Ma guerre des mondes, quand je filme un entomologiste réputé dans son bureau à l’hôpital. J’ai joué sur les aplats de couleur de la pièce (mur jaune, armoire marron), et avec le vert vif d’une plante que j’ai placée dans le cadre, pour le rendre plus théâtral.
Le hors champ passe aussi par mon récit en voix off à la première personne, un récit tout en litote, avec une première personne très forte, dont j’aimerais parfois arriver à me passer.
Dans la vraie vie, on n’est pas protégé par la fabrication d’un film (soit comme personnage, soit comme réalisateur), le réel cogne plus fort.
Pauline Horovitz
Donner de soi-même
Souvent, mes personnages montrent qu’ils ne sont pas d’accord avec moi, qu’ils ne sont pas à l’aise, que mes questions leur cassent les pieds, comme mon père quand il déclare : « Ce film, je ne le fais pas par amour du théâtre, je le fais pour que tu gagnes des sous ».
Leur résistance fait partie du film, je ne la cache pas. Elle permet au spectateur d’avoir une place : je ne lui demande pas d’adhérer à ce que je pense, ni de s’identifier aux personnages, il pense ce qu’il veut. Il est libre de trouver mon père formidable ou monstrueux (ce que m’a dit un jour une spectatrice, qui a ajouté que j’avais dû avoir une enfance très malheureuse !).
Je reviens à mes retrouvailles avec David. Quand il me dit qu’il m’imaginait en savant fou dans un labo, ce n’est pas très flatteur. Quand je lui avoue mes sentiments passés pour lui, s’ensuit un moment encore plus pénible, fait de gêne réciproque, moment que j’ai gardé au montage. Evidemment j’ai l’air ridicule, et tant mieux : cela me remet à ma place, met David sur un pied d’égalité, donne au spectateur la bonne distance.
Il y a une sorte de sincérité brutale dans ce que je donne à voir, et de mes personnages, et de moi-même, de la crudité des relations familiales. Raconter nécessite d’habiter son récit. Cela demande beaucoup d’énergie, une livre de chair par film. À chaque film, malgré l’expérience, je repars de zéro, sans aucune assurance d’y arriver.


