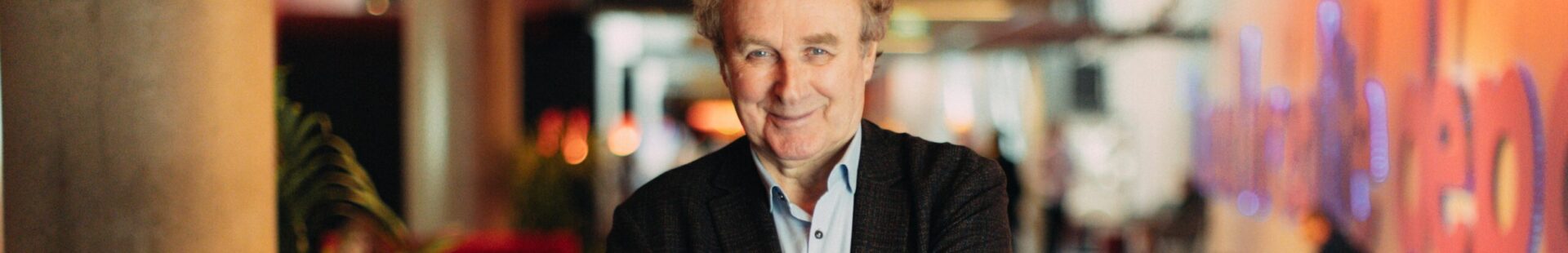
31 octobre 2025
Comment transposer le réel ? #26
« Mettre en œuvre une sidération critique »par Jérôme Prieur
Vous avez fait votre cette phrase de William Faulkner : « Le passé n’est jamais mort. Il n’est même pas passé ». Lieux, lettres, journaux intimes, photographies, images d’archives, fiches de police, reliques se conjuguent afin d’observer – notamment – l’époque autour des deux guerres mondiales qui vous préoccupe intimement.
La peur du vide, elle nous saisit, nous cinéastes, surtout quand on évoque les époques passées. Combien de fois m’a-t-on répondu quand je défendais un projet : mais il n’y a pas d’images ! Sous entendu : pas d’images animées. Bien sûr qu’il y a toujours des images possibles. À chacun de concevoir les solutions. Nous sommes comptables d’abord devant nous et il faut savoir exactement ce que l’on veut et ce que l’on ne veut pas.
Le rôle des réalisateurs de documentaires est de partir de ce que la réalité leur propose. La question des matériaux est primordiale. C’est même le déclencheur d’un film. Les matériaux, ce peut être un paysage ou des gens à questionner. Dans le cas de Corpus Christi et des séries qui ont suivi, il n’y avait quasiment rien d’autre à filmer que des lecteurs, les chercheurs et exégètes de tous les pays qui étudient les textes chrétiens de multiples poins de vue. Ils sont les acteurs de l’enquête que nous avons réalisée avec Gérard Mordillat au fil de plus de 20 ans de travail, ils offrent au fond une galerie de portraits. Pour d’autres films c’est tout le contraire qu’il faut suivre. Rien ne peut être figé.
Je vais confier une impression un peu polémique : très souvent le documentaire d’histoire a tendance à ressembler à un bric-à-brac. On met tout ce que l’on a trouvé sur la table, sur la table de montage. C’est assez déprimant. Ce qui est exaltant et excitant, ce sont les contraintes que l’on se fixe, n’utiliser, par exemple pour Les Suppliques que les lettres adressées au Commissariat général aux questions juives ou au maréchal Pétain, car ce sont les seuls testaments de ceux et celles qui ont lancé ces sortes de bouteilles à la mer. Et puis mettre en scène leur contrechamp grâce à des objets familiers qui en deviennent inquiétants, ou grâce au contrepoint avec la propagande officielle et sa bondieuserie, et c’est tout. Il faut jouer de la raréfaction. Rien à faire, il y a toujours des images manquantes. Il n’y a même que cela. Mon dernier film, Le cas Léon K. je l’ai réalisé parce que presque rien n’existait sur la vie de ce jeune homme que je cherchais à retrouver. C’est le presque rien au bout du compte (pourtant fruit d’une patiente investigation) qui m’a donné l’envie du film. Un spectateur dans un débat à Limoges m’a demandé : « Ce monsieur dont vous faites le portrait, si vous aviez pu le rencontrer, est ce que vous l’auriez filmé ? » Je ne m’étais jamais confronté à cette question toute simple. D’instinct j’ai répondu que j’aurais tout mis en œuvre pour le rencontrer, mais certainement j’aurais abandonné le projet du film. Il n’y aurait plus eu l’incertitude, le flou, le brouillard qui composent le mystère de cet être humain, de ce revenant. De toute façon chercher à tout dire est l’un des pires dangers qui soient.
Si j’ai choisi de réaliser des films documentaires et si le documentaire est pour moi l’une des formes du cinéma, c’est qu’il s’agit moins de transmettre et d’apporter du savoir que de nouer un dialogue avec l’intelligence et avec l’imagination du spectateur, avec ce qu’il peut ressentir.Jérôme Prieur
Parallèlement aux films, vous menez une œuvre d’écrivain, vous faites aussi dialoguer cinéma et littérature, vous aimez filmer les archives écrites, les manuscrits. On dirait même qu’avec vous le papier parvient à être vivant.
Le mot écriture est un mot sacré pour moi. Il faut être payé d’une certaine façon par le travail que l’on fait, par la recherche. Si tout est cuit, cela est sans intérêt. Le travail d’écriture fait partie prenante du film. Il ne s’arrête pas après la rédaction du projet, cette étape transitoire qu’est le « scénario ». Sans compter que je n’écrirai jamais un scénario où je vais raconter ce qui va se passer à la troisième minute, à la dixième minute, etc. C’est inimaginable, c’est antinomique avec ma conception du documentaire. Le documentaire suppose à la fois d’avoir des idées très préconçues, le plus organiques possible, et en même temps de laisser place à la découverte, à l’inattendu, à l’imprévu.
Je voudrais rappeler les quelques mots de l’archéologue Laurent Olivier qui terminent votre livre commun Où est passé le passé, une discussion que vous avez tenue par écrit : « Rendre la parole à ceux qui ne l’ont pas eue, leur faire un tombeau : j’ai l’impression que nous nous rejoignons là dessus, sur ce que sont les vestiges, je veux dire ce qui reste du passé. Plus exactement, nous nous rejoignons sur ce qui sauve le passé de l’oubli, ce qui le tire de cette accumulation infinie de destruction et de chagrin pour le ramener vers nous au prix d’efforts incroyables. » Dans Les sentinelles de l’oubli, vous construisez un tombeau pour ces soldats morts de la guerre de 14-18. Mais aussi de toutes les guerres, j’ai l’impression. Qu’est ce qui vous a attiré vers la question de l’Histoire ?
Les Sentinelles de l’oubli, cela faisait des années que je voulais réaliser un film dont les acteurs seraient les sculptures des monuments aux morts que l’on peut voir à travers la France. Mes interlocuteurs m’expliquaient très sérieusement que c’était impossible car les statues ne bougent pas. La remarque était certes des plus pertinentes, mais avouons que cela ne m’aidait pas beaucoup, d’autant que j’expliquais avec précision comment je voulais m’y prendre pour les rendre « vivantes »… Il faut une quantité immense d’obstination pour faire un film, il faut tenir envers et contre tout, car personne ne le veut autant que nous.
C’est surprenant peut-être mais j’ai très peu abordé la guerre de 14 dans mes films avant Les Sentinelles de l’oubli, alors que c’était le premier « livre » que j’ai voulu écrire, j’avais douze ou treize ans et il m’a fallu attendre plusieurs dizaines d’années pour publier, en 2018 seulement, La Moustache du soldat inconnu. Cela prouve assez combien ce fut un désir difficile mais fondateur. De façon moins biographique, j’avoue être porté par une espèce de révolte devant le fait que l’Histoire, à la télévision, ne nous touche pas. On a pris l’habitude de la regarder selon une lumière zénithale, comme si, aujourd’hui, nous avions tout compris de ce que nos prédécesseurs n’avaient pas compris…
Le documentaire suppose à la fois d’avoir des idées très préconçues, le plus organiques possible, et en même temps de laisser place à la découverte, à l’inattendu, à l’imprévu.Jérôme Prieur
Je me souviens d’un cinéaste italien qui avait réalisé un pot-pourri de discours de Mussolini. Dans la salle les gens s’esclaffaient en disant mais qu’est ce qu’il était ridicule, comment les gens ont pu y croire ! Ce n’est que plus tard que j’ai commencé à comprendre que l’on se croyait plus forts, plus intelligents. Ce qui me frappe dans beaucoup de vos films comme dans Ma vie dans l’Allemagne d’Hitler c’est que vous nous obligez à regarder les archives autrement. Chez vous, elles nous parlent du passé autant que de nous, de notre actualité.
En règle générale, les archives d’actualités ressemblent à des images qui seraient tombées du ciel. Il suffirait de les nettoyer de leurs commentaires ou de leur musique pour les rendre « historiques ». Ainsi sont-elles utilisées comme des illustrations, comme des vignettes qu’on colle dans un album. On les a vues cent fois, et après on les regarde sans les voir. Celles qui m’intéressent n’ont peut-être aucun rapport direct avec le sujet, sauf que certaines contiennent un peu de l’essence du cinéma : du temps. Et lorsque l’on arrive à percer le mur du temps qui nous sépare du passé, alors le miracle peut avoir lieu.
Je crois que je cherche à produire une sorte de sidération critique. Je veux que le spectateur soit sidéré, comme je suis sidéré par ce que je découvre du passé, et, tout à la fois je veux comprendre ce passé, mettre en alerte l’esprit critique du spectateur. Ce double jeu, c’est le geste fondateur du cinéma, ce qu’a compris Etienne-Gaspard Robertson, l’inventeur de la fantasmagorie à l’extrême fin du XVIIIe à qui j’ai consacré un livre (Lanterne magique) et à qui, des années plus tard, j’ai fait raconter l’invention des images animées dans Vivement le cinéma. Y croire et ne pas y croire, être dedans et être dehors. On revient toujours à cette question essentielle, la question du point de vue, la question du rapport au spectateur – sans compter que la figure de rhétorique à laquelle je tiens beaucoup est, pour employer un terme savant, l’oxymore. C’est la juxtaposition de deux images, de deux états de sensations, que tout oppose en apparence. Par là, le spectateur peut entrer dans la danse, la danse des fantômes.
« C’est une question qui m’a toujours angoissé : le passage du présent au passé, la mort de tant de choses vivantes. De penser à l’avenir donne le vertige. », comme l’écrivait Hélène Berr dans son journal.
En dehors de toute préoccupation métaphysique, chaque film est évidemment une tentative de résurrection. Que les êtres qui ont vécu jadis aient disparu à tout jamais, même ceux que je n’ai pas connus, René Char ou Antonin Artaud mais aussi les artisans égyptiens d’un millier d’années avant notre ère dont j’ai pu filmer les tombes en Egypte et dont je connais le nom, m’est une idée insupportable. Comme l’écrivait Montaigne, que citait encore la jeune Hélène Berr, il faut réussir à « jouer un tour au temps ».
Si j’ai choisi de réaliser des films documentaires et si le documentaire est pour moi l’autre grande expression du cinéma par rapport à la fiction, c’est qu’il ne s’agit pas tant de transmettre et d’apporter du savoir, le but est de nouer un dialogue avec l’intelligence et avec l’imagination du spectateur, avec ses yeux, avec ses émotions, avec ses propres questions et ses doutes, avec ce qu’il ressent. C’est pourquoi je souffre quelquefois qu’il n’y ait pas davantage de documentaires dont les formes soient plus ouvertes, qu’elles ne transgressent pas les routines, les clichés, les codes. J’aime voir ce à quoi je ne m’attends pas.


