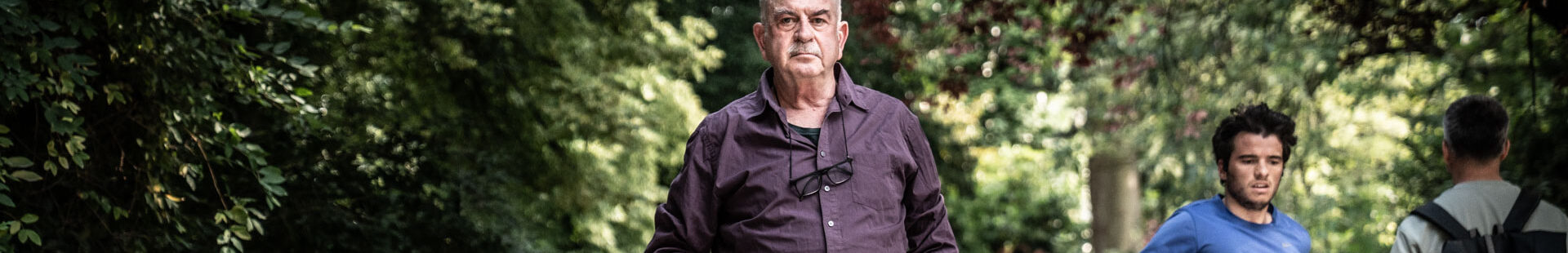
11 juillet 2025
Avi Mograbi, cinéaste en résistancepar Camille Ménager, autrice et réalisatrice
« Normalement je ne fais pas de déclarations, je fais des films… » En novembre 2024, Avi Mograbi profite de sa présence sur la scène de la cérémonie de clôture du festival international du documentaire de Leipzig pour demander à ses « amis internationaux d’exhorter [leurs] gouvernements à cesser d’armer et de soutenir Israël en ce moment dévastateur et d’encourager le gouvernement israélien à ouvrir la voie vers un Moyen-Orient pacifique où tout le monde sera libre entre la mer et le Jourdain ». Leipzig, ville natale de sa mère et où, comme il le raconte ce soir-là, sa grand-mère avait été battue par des hitlériens dans la rue sans que personne ne lui vienne en aide. Elle avait alors décidé de quitter sa vie confortable en Allemagne et de partir avec son mari et ses deux filles en Palestine.
Si ce soir-là il prend la parole, c’est que les films ne suffisent pas. Voilà trente-cinq ans qu’il en fait, décortiquant l’histoire et le présent d’Israël où il est né en 1956. C’est l’essence même de son métier de cinéaste : il ne saurait raconter autre chose que sa relation à son pays natal. Pas de neutralité, pas d’irréaliste objectivité, Avi Mograbi met en scène la réalité qui se présente à lui dans toute la complexité qu’elle revêt. Homme profondément de gauche élevé dans une famille sioniste dont il s’éloigne des opinions politiques à l’adolescence, il aime son pays autant qu’il le critique.
Même quand on est déjà d’accord, on se parle, on s’encourage, on se soutient, on manifeste de la solidarité. C’est ça qui fait que les films sont toujours importants, et encore plus aujourd’hui.
Avi Mograbi
Mémoire à l’œuvre
Quand on l’interroge sur un éventuel cinéma qui l’aurait influencé, Avi Mograbi ne peut s’empêcher de sourire : sa réponse ne va-t-elle pas nous surprendre ? Il pense à deux films. Le premier est signé Chantal Akerman. Jeanne Dielman, 23 quai du Commerce, 1080 Bruxelles, l’a estomaqué, à la fois dans son contenu et dans le langage cinématographique que la réalisatrice belge y déploie en 1975. Le second ? The conversations, de Francis Coppola, Palme d’Or en 1974. Autre genre, même claque.
Il faut dire qu’il a la culture de l’image chevillée au corps : sa jeunesse, il l’a passée dans une salle de cinéma, et pas n’importe laquelle. Le grand-oncle Jacob, commerçant aisé de Damas, venu s’installer à Tel-Aviv en 1930, avait remarqué que les ouvriers qui construisaient sa maison préféraient ne pas déjeuner pour économiser leur argent et aller au cinéma. Qu’à cela ne tienne : il achète un terrain avec son frère pour construire un cinéma au bord de la mer. Ce sera le célèbre Cinema Mograbi. Les fondateurs comprennent l’air du temps : à l’heure où le cinéma se met à parler, ce sera la première salle du Moyen-Orient équipée pour le son. Le père d’Avi Mograbi en prend la direction à la fin des années 50. Deux salles, deux ambiances : dans la grande, Avi y découvrira les grands films hollywoodiens. Dans la petite, les Fellini, Bergman, et autre Antonioni.
Naissance du style Mograbi
En 1981, il achève ses trois années de service militaire obligatoire et commence par étudier la philosophie à l’Université de Tel Aviv. Puis il suit une formation artistique en arts plastiques à l’école d’art de Ramat Hasharon. Son premier film, Deportation, court métrage de 12 minutes, est primé au festival de Cracovie en 1989. Dans son deuxième film, The Reconstruction, prix du meilleur documentaire de l’Institut du film israélien en 1994, il décortique une affaire criminelle sordide en dénonçant les manipulations policières ayant conduit à la condamnation de jeunes Arabes israéliens.
Le troisième film le fera connaître à l’international. En 1997, Comment j’ai appris à surmonter ma peur et à aimer Ariel Sharon marque le début d’une œuvre singulière traversée par une opiniâtreté à raconter et un sarcasme séduisant, mêlant autofiction et cinéma direct. Dès le début du film il se raconte à l’image, sourire narquois, s’appliquant à se ridiculiser un brun comme un Jacques Tati qu’il admire, pour être sûr qu’on ne le prendra pas trop au sérieux. Le commencement de la méthode Mograbi ?
Le postulat de départ semble pourtant classique : jeune réalisateur revendiqué de gauche, Avi Mograbi veut faire un portrait très critique d’Ariel Sharon, alors en pleine campagne pour faire élire le Likoud aux élections législatives de 1996. Sharon n’est-il pas celui qui a précipité Israël dans la guerre au Liban en 1982, cette « sale guerre » qu’Avi a refusé de faire, ce qui lui a valu de passer 35 jours en prison ? Au fur et à mesure du tournage, le réalisateur devenu lui-même personnage semble tomber de haut : et si Ariel Sharon était contre toute attente un homme bonhomme, drôle et charismatique, qu’il se mettait à apprécier ? Réflexion politique, geste cinématographique, tout se mêle dans cette comédie documentaire qui nous en apprend autant sur Mograbi que sur son pays.
L’évolution d’une œuvre politique
Invité en France à projeter le film au festival de Lussas, qui deviendra son préféré, il rencontre le producteur Serge Lalou. C’est le début d’un rapport privilégié avec le public français et d’une amitié professionnelle au long cours. « Je suis sûr qu’on trouve les empreintes de Serge dans chacun de mes films », s’amuse-t-il. Les Films d’ici coproduiront ses sept long-métrages suivants, à commencer par Happy Birthday, Mr. Mograbi, en 1999. Poussant encore plus loin le mélange des genres, le réalisateur y tourne en dérision la coïncidence d’une triple célébration. En mai 1998 ont lieu les célébrations du cinquantenaire de l’État d’Israël. Pour les Palestiniens, c’est la commémoration de la Naqba, littéralement « la catastrophe » consécutive à la guerre de 1948. Et pour Mograbi ? L’anniversaire de ses 42 ans. Dans un road-movie mêlant fausse production et vraie quête sur traces des villages palestiniens engloutis par l’occupation militaire, il dissèque l’histoire son pays en embarquant le spectateur dans une aventure où le burlesque confine au désespoir.
Les années passent, les convictions s’enracinent, les films se suivent et ne se ressemblent pas. En 2002, une vague d’attentats-suicide pendant la Seconde Intifada pousse Avi Mograbi à interroger les mythes fondateurs de la culture israélienne, notamment ceux de Massada et de Samson, figures bibliques utilisées pour forger l’identité militaire et nationale d’Israël. En découlera Ne vengez qu’un seul de mes deux yeux (2005). Mograbi s’emploie à démontrer comment l’instrumentalisation des mythes dans l’éducation israélienne pousse la jeunesse à s’identifier à des figures de sacrifice et de violence, alimentant l’aveuglement moral des soldats et justifiant, sous couvert de sécurité, l’oppression des Palestiniens. L’une des dernières scènes raconte autant l’homme que le documentariste. Il filme de près des soldats israéliens empêchant des écoliers palestiniens de rentrer chez eux. Hors champ, sa voix d’abord calme les exhorte à ouvrir la barrière. Le dialogue est sourd, la voix de plus en plus énervée. Il crie de les laisser passer. En vain. La comédie est finie, là, elle a laissé place à un cinéma direct qui nous touche au cœur.
Avec Z 32 (2009), Avi Mograbi imagine une nouvelle façon de raconter. Un jeune soldat, ancien tireur d’élite de l’armée israélienne, a participé à un crime de guerre en assassinant deux policiers palestiniens. Il a accepté de raconter son histoire mais seulement si le réalisateur lui assure l’anonymat. Pas d’Avi Mograbi à l’image, pense-t-on d’abord, le film s’ouvrant sur un long dialogue entre le jeune soldat et sa compagne, lui voulant son pardon à elle, elle cherchant à le comprendre et à continuer à l’aimer. Mais c’est mal le connaître. Il surgit, assis dans son salon, cagoulé. Dans une magistrale mise en abyme, Mograbi s’interroge sur le processus d’anonymisation de son personnage et plus largement sur sa propre éthique à raconter l’histoire d’un criminel. À donner refuge à un assassin, ne l’absout-il pas de son crime ? Ce dilemme, il décide de le chanter, réalisant un rêve vieux de 25 ans : « Je rêvais d’être une rock-star, là je chante accompagné de huit musiciens dans mon salon ! » L’équipe du film s’est étoffée, avec notamment le compositeur Noam Enbar, qui signe les textes et la musique et sera à nouveau à la manœuvre pour Dans un jardin je suis entré (2012) puis pour Entre les frontières (2016). La partition musicale est soignée. Avi Mograbi, tel un coryphée inspiré, chante ses états d’âme dans son salon, érigeant sa femme en sage conscience comme il s’était déjà amusé à le faire dans Comment j’ai appris à surmonter ma peur et à aimer Ariel Sharon. Extrait choisi : « Il se lave à ton regard, tu t’en tires avec un film encore percutant ! Alors cesse de flirter avec le mal, toi et lui vous n’êtes pas dans la même barque, et promets-moi de ne plus le filmer ici au salon ! »
Le cinéma d’Avi Mograbi ne donne pas de leçon. Il déplace notre regard, rend alerte, pousse à la curiosité de l’autre.
Camille Ménager
Filmer malgré la désillusion
En 2022, il compose avec Les 54 premières années, manuel abrégé d’occupation militaire une œuvre à première vue plus classique, au ton plus docte. Les années sont passées sur le visage et les cheveux désormais blancs d’Avi Mograbi. Pour lui, le mécanisme de l’occupation des territoires palestiniens obéit à une planification structurée depuis des décennies. Puisqu’il n’existe pas de manuel officiel, il va l’inventer lui-même, utilisant une vaste collection de témoignages filmés par « Breaking the silence », organisation de soldats vétérans israéliens qui ont servi dans les territoires occupés et qui ont décidé de témoigner de ce qu’ils ont vécu afin de visibiliser l’occupation. De 1967 à 2021, 54 années sont couvertes par des générations de soldats d’époques différentes mais d’expérience similaire. Pour coudre entre eux ces témoignages et des images d’archive choisies avec soin, il fallait un narrateur un peu machiavélique qui, à l’image, endossait le rôle d’un guide dans le manuel : ce sera Mograbi himself. Il s’est même laissé pousser la barbe, après tout, ça fait plus sérieux !
Si dans sa jeunesse il caressait quelques illusions quant à sa capacité à changer le monde avec ses films, l’homme de 69 ans les a enterrées. « Quand vous pensez aux vidéos des désastres qui ont lieu partout dans le monde et que les gens peuvent regarder sans fin sur les réseaux sociaux… Si toutes les atrocités, toutes les horreurs que vous voyez en vidéo à Gaza, n’ont pas poussé la communauté internationale à stopper le génocide que commet Israël à Gaza, alors que peut bien faire un film ? » Pour autant, il ne compte pas s’arrêter d’en faire. Il connaît son public, déjà converti à la cause. Et puis celles et ceux qui le tiennent pour un dangereux gauchiste ne les regardent pas, de toute façon. La raison est ailleurs. Les films doivent être support de discussion, de progrès, de soutien : « Même quand on est déjà d’accord, on se parle, on s’encourage, on se soutient, on manifeste de la solidarité. C’est ça qui fait que les films sont toujours importants, et encore plus aujourd’hui ». Le cinéma d’Avi Mograbi ne donne pas de leçon. Il déplace notre regard, rend alerte, pousse à la curiosité de l’autre. Merci, Monsieur Mograbi.
Retrouvez les films d’Avi Mograbi en accès libre sur Youtube :
La Reconstitution (1994)
Comment j’ai appris à surmonter ma peur et à aimer Ariel Sharon (1997)
Happy Birthday Mr. Mograbi (1999)
Pour un seul de mes deux yeux (2005)
Z32 (2009)
Dans un jardin je suis entré (2012)
Entre les frontières (2016)
Les 54 Premières Années – Manuel abrégé d’occupation militaire (2022)


