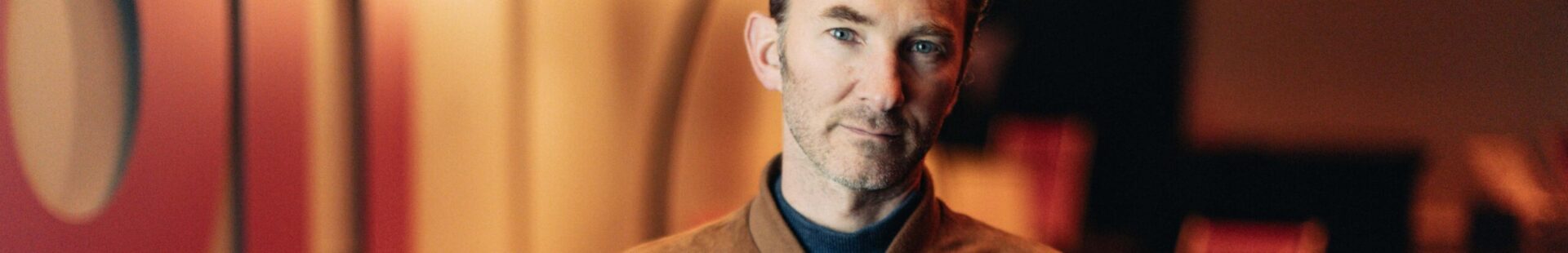
7 mars 2025
Comment transposer le réel ? #20
« Transformer les relations autour de la caméra en matériau d’écriture »par Mathias Théry
Le réalisateur Mathias Thery livre une réflexion approfondie sur le documentaire, qui repose sur un pacte entre filmeur, filmé et spectateur. Un film n’est donc pas un accès libre au réel, mais une œuvre où donner forme à l’éthique des relations entre ces trois protagonistes est au cœur du travail du cinéaste.
J’avais vingt ans, j’étais étudiant aux Arts Décoratifs de Paris et je voulais me faire la main avant d’entamer mon premier cours de cinéma documentaire. J’ai donc décidé, le temps d’un été à l’île d’Yeu où je travaillais comme pizzaïolo, de réaliser une série de portraits filmés. J’avais de l’amitié pour le patron de la pizzeria, je décidai donc de lui consacrer un portrait. Mais chaque fois que je sortais mon camescope dans le restaurant, je le voyais disparaître. Timide, il craignait la caméra, et m’échappait. J’insistais, au nom de notre amitié. Il finit par céder, à condition de circonscrire le tournage loin des foules. C’était gagné. Le lendemain, nous partîmes en forêt et autour d’un feu, quelques bouteilles de vin aidant, je parvenais enfin à le faire parler. Soulagé, je rentrai à Paris, montai le portrait et le soumis à mes camarades de classe. Les commentaires furent unanimes : quel pédant bavard ! J’avais transformé mon timide ami en un antipathique fanfaron. Pour me faire plaisir, il s’était travesti. J’avais raté toutes les étapes de la fabrication d’un documentaire, ignorant que les relations tout au long de la conception, font partie de l’objet final.
Le cinéma documentaire n’est pas un accès libre au réel
Il vous suffit de lire tous les articles de cette rubrique pour constater l’unanimité : le cinéma documentaire est une construction, une série de choix au tournage comme au montage, au service d’un point de vue. En voulant transposer le réel on le provoque, on le manipule, on le transforme.
Transposition ou création ?
Alors que cette artificialité semble assumée par tous, la distinction d’avec la fiction fait toujours l’objet de discussions interminables et enflammées au sein même de la profession. Car il y a plus de mise en scène qu’on ne le croit dans ces films et certains d’entre nous ne veulent pas entendre parler de différence mais uniquement de liberté de création. Et pourtant le documentaire est bien un genre en soi, avec ses festivals, ses grilles de programmation, ses financements, ses sociétés d’auteurs. Alors qu’est-ce qui le distingue ?
Le pacte
Je peux tenter la définition la plus simple : il est tout ce qui n’est pas de la fiction. Il n’est pas fabriqué à partir d’un scénario pré-écrit, interprété par des comédiens et des comédiennes. Quand toute fiction repose sur un mode d’emploi connu du spectateur « on va vous jouer une histoire, à vous de faire semblant d’y croire », un film documentaire repose sur un autre pacte : « cet objet a été construit en filmant des personnes qui ont une existence indépendante du film, ce qu’elles y vivent n’a pas été inventé ». Tout film qui s’annonce documentaire demande au spectateur de croire a priori en ce pacte. Mais les manières de se positionner avec une caméra dans le réel sont si nombreuses qu’on peut voir presque en chaque film de non-fiction une proposition de démarche et de mode d’emploi unique.
Chaque documentaire présente ses règles du jeu. Il énonce les conditions de captation des scènes, et il demande au spectateur de croire à la sincérité de la démarche. C’est le pacte documentaire.
Mathias Thery
Agir dans le réel
Essayons de résumer la démarche de quelques œuvres connues.
Je suis allé faire parler des témoins de l’Holocauste (Shoah de Claude Lanzmann). J’ai partagé un an de la vie d’une petite école de campagne (Être et avoir de Nicolas Philibert). J’ai piégé un grand groupe industriel (Merci Patron, de François Ruffin). J’ai demandé aux membres d’une famille de jouer des scènes de leur histoire pour provoquer un dialogue (Les filles d’Olfa, de Kaouther Ben Hania). Je suis allée à la rencontre des gens qui récupèrent les denrées abandonnées (Les glaneurs et la glaneuse de Agnès Varda). J’ai fait réagir différents témoins à des images de violences policières (Un pays qui se tient sage de David Dufresne). J’ai proposé à une grande entreprise de filmer une de ses séances de recrutement (La gueule de l’emploi de Didier Cros). J’ai décidé de ne me nourrir que de fast-food (Super size me de Morgan Spurlock).
Je pousse l’exercice sur certains de nos films réalisés avec Étienne Chaillou.
Nous avons accompagné ma mère, sociologue engagée, pendant l’élaboration de la loi du « mariage pour tous », ce faisant nous avons enregistré nos conversations téléphoniques et les avons mises en scène avec des marionnettes (La Sociologue et l’ourson). Nous avons suivi un jeune militant d’extrême-droite le temps d’une élection présidentielle, nous avons ensuite rédigé cette période de sa vie à la manière d’un roman et nous lui avons soumis le texte pour critique (La Cravate).
Chaque documentaire présente ses règles du jeu. Il énonce les conditions de captation des scènes, et il demande au spectateur de croire à la sincérité de la démarche. Bref, il précise son propre pacte avec le spectateur, le pacte documentaire. Cette spécificité du documentaire (partager une démarche avec le spectateur) fait que, même s’il s’efface le plus possible, le cinéaste ne peut pas s’abstraire de l’équation, il ne peut pas disparaitre du film, il en est forcément l’un des acteurs.
Quand je regarde un film documentaire, je ne regarde jamais uniquement les protagonistes qui sont à l’écran. Les scènes que j’observe incluent un personnage hors-champ et qui tient une caméra.
Les personnages et les cinéastes ne partagent pas forcément les mêmes raisons de faire un film, un tournage est un espace de négociation, voire de pouvoir.
Mathias Thery
Nous ne pouvons pas sortir de nos films
Dans le film Cherche Toujours, nous avons partagé le quotidien d’une équipe de physiciens travaillant sur les formes dans la nature. Nous voulions décrire les différents états psychologiques qui font avancer un chercheur (et donc la science). Pour cela, nous avons usé de plusieurs grammaires : cinéma direct, dessin animé, théâtre d’objets, auto-filmage, etc. Nous avons effacé notre présence des scènes pour privilégier le sentiment d’immersion, mais tous les dispositifs utilisés et le travail de montage racontent au spectateur notre intervention dans le laboratoire.
Dans le film La Sociologue et l’ourson, il nous a paru important d’affirmer un peu plus notre présence, car il fallait que le spectateur sache où nous nous positionnions dans le débat qui déchirait la France, et pourquoi nous n’allions pas en interroger toutes les parties. Nous voulions assumer un poste d’observation clair. La place du fils nous en donnait un : curieux de sa mère, il pouvait rester à ses côtés, lui tendre une oreille bienveillante tout en osant la couper, et assumer de ne pas partager exactement les mêmes motivations à faire le film. C’est ainsi que nous avons décidé d’inclure le personnage du fils (qui incarne en fait les deux réalisateurs) sous la forme d’une voix et d’une marionnette. Cela permettait d’indiquer au spectateur qu’il assistait non pas à un état des lieux journalistique, pas à un tract politique, mais à une conversation familiale, voire une transmission filiale.
Dans le film La Cravate, nous avons été amenés à assumer plus encore ce qui se passe dans les coulisses de tout documentaire. À savoir qu’un tournage est un espace de négociation, que les personnages et les auteurs ne partagent pas forcément les mêmes raisons de faire un film, bref que cela peut être un lieu de pouvoir.
Nous avons proposé à Bastien, jeune militant RN (FN à l’époque) de le suivre le temps d’une campagne. Notre désir était de comprendre l’intérêt renouvelé de la jeunesse pour l’extrême-droite tout en espérant, avouons-le, pouvoir contrer la dédiabolisation d’un parti que nous condamnions. Bastien, lui, voulait participer au film pour se faire bien voir de sa hiérarchie qui voyait là un moyen de faire campagne. Il était flatté et espérait monter en grade. Conseillé par ses supérieurs, son but était de séduire le spectateur. Conscients de ce projet prosélyte, nous devions choisir notre posture face à ce militant. Faux ami ? Ennemi assumé ? Contradicteur ? Opposant ? Nous avons choisi celle du romancier, qui tente de peindre les émotions et les situations avec force détails, se retenant de trop donner son avis, convaincu que les scènes parlent d’elles-mêmes. Le passage par les mots, l’écrit et la voix off, nous permettait de ne pas laisser « micro ouvert » au parti en pleine propagande, voire même de couper le son de certaines images. Mais en plaquant nos mots sur les scènes, le risque était de prendre trop de pouvoir, de ne plus laisser de place à l’altérité, de retirer au spectateur tout espace de liberté. Nous avons donc décidé de proposer à Bastien de lui soumettre le texte en créant un espace de discussion. Ainsi le film s’ouvrirait sur la découverte du manuscrit par Bastien, puis accompagnerait sa lecture. Bastien aurait le pouvoir d’arrêter le récit à tout moment pour le commenter ou le critiquer. Une manière de mettre à l’épreuve le pacte entre nous.
Nous avons mis du temps à comprendre que la relation complexe que nous entretenions avec Bastien devait être assumée, racontée dans le film, faire partie du pacte documentaire partagé avec le spectateur. Nous avons redéfini le sujet du film, estimant que notre relation avec Bastien incarnait la difficulté d’une partie de notre pays à réagir à la montée de l’extrême-droite. Et qu’il fallait que le spectateur puisse en juger les réussites, les maladresses, les manipulations et les violences.
Bastien a lui aussi évolué dans ses motivations à participer au film. Déçu par le parti au bout de quelques mois, il a investi dans le film ce qu’il avait été chercher en politique : l’envie d’être considéré et de compter pour les autres, voire d’être aimé. C’est alors qu’il a pris un risque important en nous dévoilant à l’ultime étape du tournage une partie de sa vie qu’il avait cachée à tout le monde. Il espérait alors que le film serait enfin un endroit où il pourrait être compris, allant jusqu’à nous demander si le film allait changer sa vie.
Le spectateur se retrouve tiraillé entre un Bastien qui cherche à le séduire et des réalisateurs qui cherchent à montrer les mécanismes de l’extrême-droite.
Si vous trahissez votre personnage, le spectateur devient témoin, voire complice. Si vous rompez le pacte documentaire, c’est le spectateur qui se sentira trahi.
Mathias Thery
Le spectateur acteur
Imaginons une scène où un personnage se noie en gros plan. En fiction, c’est la mort d’un personnage, en documentaire, c’est une pièce à conviction de non-assistance à personne en danger. Le spectateur n’est pas convoqué de la même manière, il n’est pas à la même place, il ne vit pas la même chose.
S’engager dans un film documentaire, c’est s’engager dans des relations qui sont soumises à des questions éthiques, entre le filmeur et le filmé, mais aussi entre le cinéaste et le spectateur et parfois entre le personnage et le spectateur. Si vous trahissez votre personnage, le spectateur devient témoin, voire complice. Dans Shoah, Claude Lanzmann promet à l’ancien nazi qu’il n’apparaitra pas dans le film, alors qu’il est en train de l’enregistrer. Il le piège puis le livre au spectateur. En assumant son geste Lanzmann accrédite le témoignage, le spectateur devient un juré à qui on propose une preuve.
Si vous rompez le pacte documentaire, si vous mentez sur la nature de vos images et que le spectateur le découvre (par exemple que les personnages sont en fait des comédiens), il se sentira trahi. À moins de le faire en conscience. Dans Isaac Asimov, a message to the future, je construis le film autour d’une fausse archive que j’ai fabriquée, truquage que je révèle finalement au spectateur, assumant que cette tromperie vient renforcer le message d’Asimov et le propos du film. Dans Faites le mur de Banksy, plus le film avance, plus le spectateur se demande si ce à quoi il assiste n’est pas une vaste arnaque. Il est pris de vertige, il ne sait plus ce qu’il regarde, un documentaire ou une nouvelle œuvre de l’artiste qui, une fois de plus, se joue de nous et questionne la finalité de l’art. Les films qui s’amusent avec le pacte ou flirtent avec les limites du genre sont souvent jubilatoires.
Le privilège documentaire
Seul le documentaire permet ce type de relations à trois bandes filmeur-filmé-spectateur. Ces relations font partie des films et on ne peut les en effacer. C’est unique. C’est ce qui fait la grande singularité d’un genre où l’on ne peut séparer le cinéma de la vraie vie. Y-a-t-il une manière plus engagée, plus risquée, plus vivante de faire du cinéma ? Un cinéma où les films sont des propositions de manières d’agir dans le monde. Un art où l’ensemble des relations engendrées par la présence d’une caméra deviennent le matériau même de la dramaturgie des œuvres.
Diplômé des Arts Décoratifs de Paris, Mathias Théry réalise des films où les inventions formelles permettent d’explorer différents modes de narration. Ses films Cherche Toujours* (2008), La Sociologue et l’ourson* (2016), La Cravate* (2019), Isaac Asimov, a message to the future (2022) ont été récompensés d’une Étoile de la Scam. La Sociologue et l’ourson a également reçu en 2017 le prix du public au festival des Étoiles du documentaire de la Scam.
*films co-réalisés avec Étienne Chaillou


