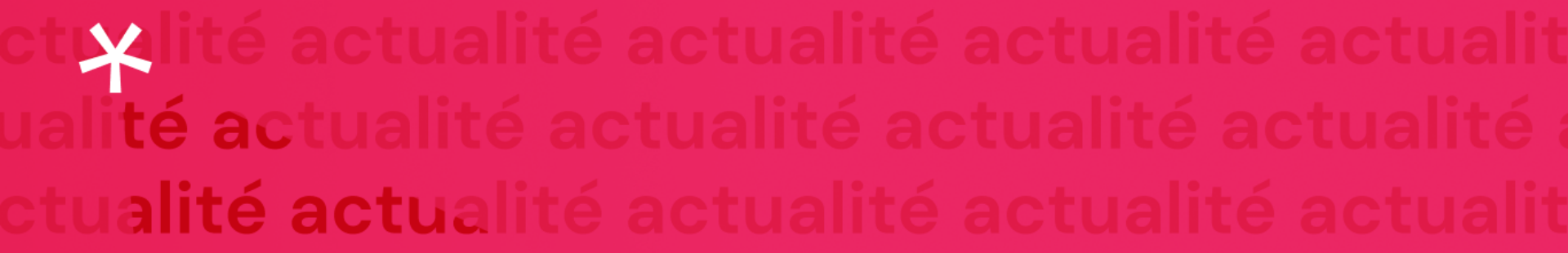
(vidéo) Le documentaire : matière à penser #6
La comédie documentaire, le 2 octobre 2024Cycle de rencontres Scam, ARTE, CNC, La Fémis
À la suite de l’Année du documentaire 2023, la Scam, ARTE, le CNC et La Fémis ont le plaisir de vous convier à ce sixième volet de la série de rencontres « Le Documentaire : matière à penser ».
La comédie documentaire
Un Graal. Rare au sein d’un genre qui est souvent perçu comme particulièrement austère ou auquel on attribue d’abord des vertus de « pédagogie » et/ou « d’information ». Mais justement la comédie documentaire ne réfute-t-elle pas ces dimensions réductrices ? Par sa nature même ne souligne-t-elle pas le primat d’un regard ?
Sans vouloir cloisonner la comédie documentaire dans une définition stricte, la journée propose des pistes de réflexion. La promesse comique implantée, l’implication du spectateur se trouve bouleversée, creusant les travers d’un personnage ou guettant la situation qui va déraper. Une autre fois, l’élément comique crée une rupture et sort le spectateur du récit auquel il était préparé. Qu’il apparaisse dans la mise en scène, le traitement des personnages, le ton ou les situations, quels effets le comique a-t-il sur le traitement du réel ?
Et si la rencontre du documentaire avec la comédie n’est pas si fréquente, lorsqu’elle a lieu, elle produit aussi une salve émancipatrice singulièrement puissante. Qu’il s’agisse de célébrer l’irrévérence ou de donner la parole à ce qui est réprimé, comme une décharge affective spontanée, le rire provoque aussi une sorte de communion en complicité avec d’autres spectateurs, et c’est là que réside aussi son pouvoir d’émancipation, de subversion.
Cette journée de réflexion va tenter d’interroger les différentes manières selon lesquelles le genre documentaire et celui de la comédie se sont associés pour élargir les champs du possible du cinéma.
Programme
11h : Keynote par Hervé Le Tellier, autour de la question « Comment rire du réel ? ».
11h30 : Dialogue entre Marco Lamensch et Sonia Kronlund autour de l’émission « Strip-tease ».
14h30 : Étude de cas autour des projets « Il faut ramener Albert » avec Michaël Zumstein et « Proche Paris, charme atypique » avec Marion Angelosanto et Juliette Guigon (Squawk).
16h : Masterclass de Luc Moullet avec projection de son court-métrage « Foix », au côté d’Aurélie Sfez.
Hervé Le Tellier
Mathématicien de formation, puis journaliste, diplômé du Centre de formation des journalistes à Paris (promotion 1983), Hervé Le Tellier est linguiste et spécialiste des littératures à contraintes. Auteur de romans, nouvelles, poésies, théâtre, il est aussi l’auteur de formes très courtes, souvent humoristiques, dont ses variations sur La Joconde. En 1992, il a été coopté à l’Oulipo (Ouvroir de Littérature Potentielle), un groupe de recherche en littérature expérimentale, fondé en 1960, par Raymond Queneau et François Le Lionnais (simultanément au poète allemand Oskar Pastior), et a publié sur l’Ouvroir un ouvrage de référence : Esthétique de l’Oulipo (2006). Il participe également à l’aventure de la série Le Poulpe, avec un roman, La Disparition de Perek (1997), adapté également en bande dessinée, dessinée par William Henne, en 2001. Éditeur, il a fait publier plusieurs ouvrages au Castor Astral comme What a man!, de Georges Perec, et Je me souviens de Je me souviens, de Roland Brasseur. Il a aussi collaboré quotidiennement, à partir de 2002, à la lettre électronique matinale du journal Le Monde, par un billet d’humeur intitulé « Papier de verre ». Il est, avec Frédéric Pagès, l’un des fondateurs des Amis de Jean-Baptiste Botul (1896-1947), philosophe de tradition orale. Son roman, L’Anomalie (2020), publié aux éditions Gallimard, obtient le prix Goncourt le 30 novembre 2020. Son dernier ouvrage, Le Nom sur le mur, toujours chez Gallimard, est sorti en 2024.
© Babelio
Sonia Kronlund
Normalienne et agrégée de lettres, Sonia Kronlund a collaboré à l’écriture de nombreux scénarios, réalisé des documentaires et dirigé plusieurs collections pour la télévision. Après un bref passage aux « Cahiers du cinéma », elle entre à la radio en 1995 sur France Inter. Elle produit, depuis 2002, l’émission quotidienne de documentaires « Les Pieds sur Terre » sur France Culture. Pour ARTE et France Culture, elle tourne plusieurs films et documentaires sonores sur l’Iran et l’Afghanistan, pays qu’elle parcourt depuis une quinzaine d’années. En 2012, elle publie chez Actes Sud un recueil de récits « Les Pieds sur terre – Nouvelles du réel ». Son premier long-métrage en tant que réalisatrice, « Nothingwood », a été sélectionné par la Quinzaine des réalisateurs à Cannes et a été récompensé par les Étoiles de La Scam en 2018. En 2024 sort son deuxième long-métrage documentaire, « L’Homme aux mille visages », film éponyme de son livre-enquête publié aux éditions Grasset.
Marco Lamensch
Après ses études et quelques années d’enseignement comme professeur de physique, Marco Lamensch entre en 1973 à la RTBF au service Sciences. Il réalise ses premiers films, dont le docu-fiction sur la pataphysique (À la recherche de Mélanie Le Plumet, 1976). En 1977, il rejoint l’équipe du magazine d’enquêtes et de reportages À Suivre, dirigé par Henri Mordant. C’est là qu’il rencontre le chef opérateur Jean Libon avec qui il va commencer à travailler régulièrement. Après plusieurs enquêtes de société et de grands reportages internationaux, il imagine, conçoit et lance avec Jean Libon, le magazine de société Strip-tease. Parallèlement au début des années 1990, le duo se rapproche de VF films, société de production, dans le dessein d’installer le programme sur une chaîne française. La première intéressée, Canal+, renonce, et c’est finalement France 3 qui diffuse le « magazine qui vous déshabille » à partir de 1992 et durant vingt ans. Les créateurs mettent fin à Strip-tease à la RTBF en 2002 et élaborent dans la foulée Tout ça (ne nous rendra pas le Congo), un nouveau programme d’unitaires de longs formats sans commentaire. Outre avoir assuré la codirection éditoriale et artistique des émissions (jusqu’en 2005 en France), composé les quatrains, ainsi que tous les textes promotionnels et théoriques concernant Strip-tease, Marco Lamensch a réalisé une soixantaine de documentaires au fil d’une carrière jalonnée de prix et de récompenses.
© Wikipédia
Marion Angelosanto
Après des débuts d’autrice au sein de la direction artistique de Canal+, Marion Angelosanto se forme à la caméra et passe à la réalisation. Elle signe une quinzaine de récits d’affaires criminelles. Puis viennent des documentaires d’auteur : une erreur judiciaire (Rachel, l’autisme à l’épreuve de la justice, 2019), le portrait d’un hôpital (La Fabrique du soin, primé au FIGRA 2022) et un village qui se déchire pour une poignée d’éoliennes (Quand le vent tourne, 2023).
Michaël Zumstein
Michaël Zumstein est réalisateur, photojournaliste et cameraman, diplômé de l’École supérieure de photographie de Vevey. Depuis son premier voyage au Zaïre il y a plus de vingt ans, il travaille sur les relations ambiguës entre l’Afrique et l’Occident. Son travail s’inscrit dans la tradition du photojournalisme d’enquête associant réalisme documentaire et écriture graphique pour révéler des interactions entre les individus. En 2010, il rejoint l’agence VU’. En 2014, il effectue un projet sur la crise en République centrafricaine, « Centrafrique. De terreur et de larmes ». Exposé au festival Visa pour l’Image la même année, ce travail est récompensé par les prix Picture of the Year, Visual Story Telling et Swiss Press Award. En 2018, il reçoit une bourse Scam pour son projet photo « Le Meilleur Joueur du monde », publié par « M, le magazine du Monde ». En 2019, il participe activement au long-métrage de Boris Lojkine, « Camille », et fait l’image du documentaire « Une caravane en hiver » de Mehdi Ahoudig ; en 2020, il réalise « Les Mange-1000 », un reportage sur le tribunal militaire d’Abidjan et obtient la première bourse Canon du documentaire vidéo court-métrage. En 2021, il réalise « Il faut ramener Albert », en compétition au Fipadoc.
Juliette Guigon
Depuis 2017, Juliette Guigon est productrice chez Squawk . Elle a notamment produit « Il faut ramener Albert » de Michaël Zumstein, Étoiles de la Scam 2023 ; « Papa s’en va » de Pauline Horovitz, Étoiles de la Scam 2021 ; « Moi, Christiane F, 13 ans, droguée, prostituée… – Une génération perdue » de Claire Laborey ; « Green Boys » d’Ariane Doublet. Elle a également produit des séries web et de grandes enquêtes (« Insecticide : comment l’agrochimie a tué les insectes » de Sylvain Lepetit, Miyuki Droz Aramaki et Sébastien Séga, primé au Figra en 2022. Précédemment, elle fût productrice associée chez Quark Productions avec plus de 110 films produits dont les films de Marion Gervais (« Anaïs s’en va-t-en guerre ») ou de Thomas Balmès (« Happiness », primé à Sundance en 2014), de longs-métrages, « La Sociologue et l’Ourson » et « La Cravate » (sélectionné au César) d’Étienne Chaillou et Mathias Théry. En 2020, elle reçoit le prix Procirep du producteur, partagé avec Patrick Winocour, et totalise 22 Étoiles de la Scam avec 12 films de réalisatrices et 10 films de réalisateurs.
Luc Moullet
Luc Moullet est né le 14 octobre 1937. Iconoclaste, hors normes, tels semblent être les termes qui définissent le mieux son œuvre. Après des débuts de critique aux Cahiers du Cinéma au milieu des années 1950, il passe à la réalisation au début des années 1960 notamment avec Terres noires (1961), alternant sans vergogne courts et longs-métrages. Ses films atypiques se caractérisent par leur style décalé, parfois quasi expérimental, allant toujours à l’encontre des codes du cinéma narratif classique. Le réalisateur joue ainsi souvent sur les canons du récit traditionnel ou sur les différents genres. Parmi ses films marquants, on retrouve Les Contrebandières (1966), Une aventure de Billy le Kid (1971), parodie de western avec Jean-Pierre Léaud, Anatomie d’un rapport (1975), film auscultant la relation entre les sexes, ou encore Genèse d’un repas, documentaire au constat amer sur la production alimentaire au tiers-monde. En 1987, Luc Moullet reçoit le prix Jean Vigo pour La Comédie du travail, satire insolite sur le thème du chômage. Néanmoins, c’est à travers ses nombreux courts-métrages qu’il fait preuve de la plus grande originalité. Partant de sujets ancrés dans le quotidien, il parvient à produire de véritables envolées surréalistes, comme dans Barres où il étudie les comportements de chacun face aux tourniquets de métro. À ses qualités de cinéaste s’ajoute celle de comédien. Ainsi, on a pu le voir apparaître ces dernières années dans de petits rôles, comme dans J’ai horreur de l’amour de Laurence Ferreira Barbosa. En 2002, il met en scène Les Naufragés de la D17, l’histoire d’un groupe de personnes, tous aussi excentriques les unes que les autres, qui se croisent et s’entrecroisent dans la région la plus désertique de France avec, entre autres, Sabine Haudepin et Mathieu Amalric. En 2010, il fait son retour derrière la caméra avec un documentaire insolite, La Terre de la folie, où il s’interroge sur les causes de phénomènes psychiques (un très grand nombre de troubles mentaux) dans sa région natale, les Alpes du Sud.
© ACID
Aurélie Sfez
Musicologue de formation, Aurélie Sfez est premier prix du concours national de France de piano.
Elle est réalisatrice de documentaires pour la télévision, productrice et réalisatrice pour la radio, autrice et compositrice.
Entrée à Radio France en 1999, elle officie à France Culture, produit et réalise des séries documentaires autour de toutes les musiques. Entre autres, « Où sont passées les musiques yiddish ? », « La musique dans les campagnes présidentielles », « À Paris avec Sonic Youth ». Puis, elle s’installe à New York, explore et développe des méthodes de travail et d’enregistrement proches des situationnistes autour de l’errance, la dérive, la psycho-géographie, le jeu et le hasard. Elle produit pour France Culture et France Inter des reportages et documentaires de plus en plus expérimentaux et personnels sur les musiques underground, les modes de consommations américains, les syndromes post-traumatiques liés aux attentats du 11-Septembre. En 2005, elle produit avec son acolyte Julien Cernobori la série « Village People » (prix Scam de la meilleure série documentaire) sur France Inter, rencontres faussement improvisées avec les gens des villages de France. Poétique, tendre, sociale et drôle, la série sera adaptée sur France 5 sous le nom de « En campagne ».
Depuis 2021, elle réalise pour ARTE la série de portraits de poche intitulée « Fragments ».
Elle écrit et produit toujours des documentaires musicaux pour France Culture. En parallèle, elle compose des musiques de films, des créations sonores, des pièces de théâtre et des performances musicales.

