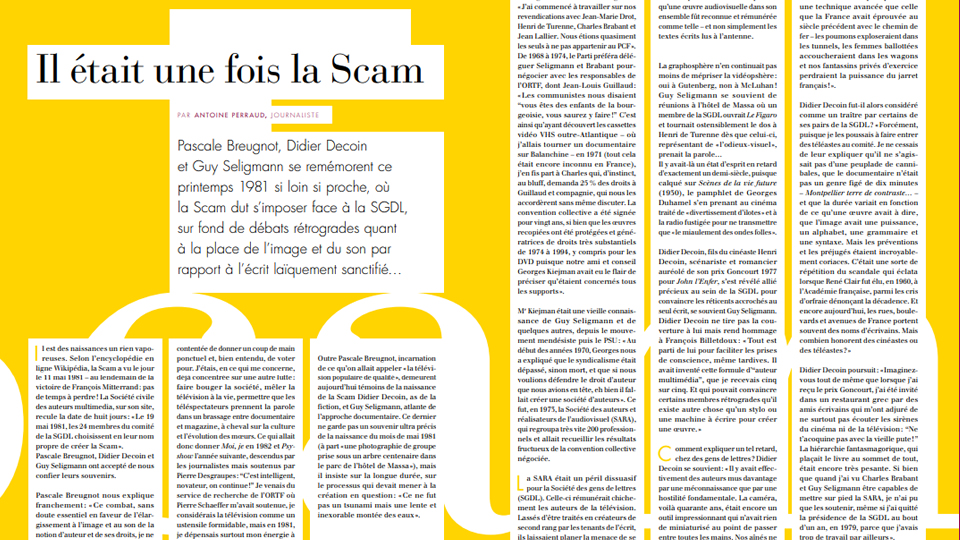Pascale Breugnot, Didier Decoin et Guy Seligmann se remémorent ce printemps 1981 si loin si proche, où la Scam dut s’imposer face à la SGDL, sur fond de débats rétrogrades quant à la place de l’image et du son par rapport à l’écrit laïquement sanctifié… Par Antoine Perraud, journaliste, pour la lettre Astérisque n°67.
Il est des naissances un rien vaporeuses. Selon l’encyclopédie en ligne Wikipédia, la Scam a vu le jour le 11 mai 1981 – au lendemain de la victoire de François Mitterrand : pas de temps à perdre ! La Société civile des auteurs multimedia, sur son site, recule la date de huit jours : « Le 19 mai 1981, les 24 membres du comité de la SGDL choisissent en leur nom propre de créer la Scam ». Pascale Breugnot, Didier Decoin et Guy Seligmann ont accepté de nous confier leurs souvenirs. Pascale Breugnot nous explique franchement : « Ce combat, sans doute essentiel en faveur de l’élargissement à l’image et au son de la notion d’auteur et de ses droits, je ne l’ai pas vraiment mené. Je me suis contentée de donner un coup de main ponctuel et, bien entendu, de voter pour. J’étais, en ce qui me concerne, déjà concentrée sur une autre lutte : faire bouger la société, mêler la télévision à la vie, permettre que les téléspectateurs prennent la parole dans un brassage entre documentaire et magazine, à cheval sur la culture et l’évolution des mœurs. Ce qui allait donc donner Moi, je en 1982 et Psyshow l’année suivante, descendus par les journalistes mais soutenus par Pierre Desgraupes : “C’est intelligent, novateur, on continue !” Je venais du service de recherche de l’ORTF où Pierre Schaeffer m’avait soutenue, je considérais la télévision comme un ustensile formidable, mais en 1981, je dépensais surtout mon énergie à faire évoluer l’outil… »
Outre Pascale Breugnot, incarnation de ce qu’on allait appeler « la télévision populaire de qualité », demeurent aujourd’hui témoins de la naissance de la Scam Didier Decoin, as de la fiction, et Guy Seligmann, atlante de l’approche documentaire. Ce dernier ne garde pas un souvenir ultra précis de la naissance du mois de mai 1981 (à part « une photographie de groupe prise sous un arbre centenaire dans le parc de l’hôtel de Massa »), mais il insiste sur la longue durée, sur le processus qui devait mener à la création en question : « Ce ne fut pas un tsunami mais une lente et inexorable montée des eaux ».
Tout est né du mouvement de Mai 68 aux Buttes-Chaumont et d’une AG dans le grand studio qui hissa, sur proposition d’une scripte, Guy Seligmann au poste de secrétaire général du comité de grève : « J’ai commencé à travailler sur nos revendications avec Jean-Marie Drot, Henri de Turenne, Charles Brabant et Jean Lallier. Nous étions quasiment les seuls à ne pas appartenir au PCF ». De 1968 à 1974, le Parti préféra déléguer Seligmann et Brabant pournégocier avec les responsables de l’ORTF, dont Jean-Louis Guillaud : « Les communistes nous disaient “vous êtes des enfants de la bourgeoisie, vous saurez y faire !” C’est ainsi qu’ayant découvert les cassettes vidéo VHS outre-Atlantique – où j’allais tourner un documentaire sur Balanchine – en 1971 (tout cela était encore inconnu en France), j’en fis part à Charles qui, d’instinct, au bluff, demanda 25 % des droits à Guillaud et compagnie, qui nous les accordèrent sans même discuter. La convention collective a été signée pour vingt ans, si bien que les œuvres recopiées ont été protégées et génératrices de droits très substantiels de 1974 à 1994, y compris pour les DVD puisque notre ami et conseil Georges Kiejman avait eu le flair de préciser qu’étaient concernés tous les supports ».
Me Kiejman était une vieille connaissance de Guy Seligmann et de quelques autres, depuis le mouvement mendésiste puis le PSU : « Au début des années 1970, Georges nous a expliqué que le syndicalisme était dépassé, sinon mort, et que si nous voulions défendre le droit d’auteur que nous avions en tête, eh bien il fallait créer une société d’auteurs ». Ce fut, en 1973, la Société des auteurs et réalisateurs de l’audiovisuel (SARA), qui regroupa très vite 200 professionnels et allait recueillir les résultats fructueux de la convention collective négociée.
La SARA était un péril dissuasif pour la Société des gens de lettres (SGDL). Celle-ci rémunérait chichement les auteurs de la télévision. Lassés d’être traités en créateurs de second rang par les tenants de l’écrit, ils laissaient planer la menace de se servir de leur nouvelle société pour négocier directement leurs droits auprès de l’ORTF. D’autant qu’ils pouvaient se réclamer de la loi du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire et artistique. Elle avait enfin permis qu’une œuvre audiovisuelle dans son ensemble fût reconnue et rémunérée comme telle – et non simplement les textes écrits lus à l’antenne.
La graphosphère n’en continuait pas moins de mépriser la vidéopshère : oui à Gutenberg, non à McLuhan ! Guy Seligmann se souvient de réunions à l’hôtel de Massa où un membre de la SGDL ouvrait Le Figaro et tournait ostensiblement le dos à Henri de Turenne dès que celui-ci, représentant de « l’odieux-visuel », prenait la parole…
Il y avait-là un état d’esprit en retard d’exactement un demi-siècle, puisque calqué sur Scènes de la vie future (1930), le pamphlet de Georges Duhamel s’en prenant au cinéma traité de « divertissement d’ilotes » et à la radio fustigée pour ne transmettre que « le miaulement des ondes folles ».
Didier Decoin, fils du cinéaste Henri Decoin, scénariste et romancier auréolé de son prix Goncourt 1977 pour John l’Enfer, s’est révélé allié précieux au sein de la SGDL pour convaincre les réticents accrochés au seul écrit, se souvient Guy Seligmann. Didier Decoin ne tire pas la couverture à lui mais rend hommage à François Billetdoux : « Tout est parti de lui pour faciliter les prises de conscience, même tardives. Il avait inventé cette formule d’“auteur multimédia”, que je recevais cinq sur cinq. Et qui pouvait convaincre certains membres rétrogrades qu’il existe autre chose qu’un stylo ou une machine à écrire pour créer une œuvre. »
Comment expliquer un tel retard, chez des gens de lettres ? Didier Decoin se souvient : « Il y avait effectivement des auteurs mus davantage par une méconnaissance que par une hostilité fondamentale. La caméra, voilà quarante ans, était encore un outil impressionnant qui n’avait rien de miniaturisé au point de passer entre toutes les mains. Nos aînés ne savaient pas faire marcher la bête, ils n’avaient pas la moindre idée du fonctionnement de la télévision, outil intrusif et mystérieux à leurs yeux. Cela n’était pas sans provoquer chez eux la même panique face à une technique avancée que celle que la France avait éprouvée au siècle précédent avec le chemin de fer – les poumons exploseraient dans les tunnels, les femmes ballottées accoucheraient dans les wagons et nos fantassins privés d’exercice perdraient la puissance du jarret français ! ».
Didier Decoin fut-il alors considéré comme un traître par certains de ses pairs de la SGDL ? « Forcément, puisque je les poussais à faire entrer des téléastes au comité. Je ne cessais de leur expliquer qu’il ne s’agissait pas d’une peuplade de cannibales, que le documentaire n’était pas un genre figé de dix minutes – Montpellier terre de contraste… – et que la durée variait en fonction de ce qu’une œuvre avait à dire, que l’image avait une puissance, un alphabet, une grammaire et une syntaxe. Mais les préventions et les préjugés étaient incroyablement coriaces. C’était une sorte de répétition du scandale qui éclata lorsque René Clair fut élu, en 1960, à l’Académie française, parmi les cris d’orfraie dénonçant la décadence. Et encore aujourd’hui, les rues, boulevards et avenues de France portent souvent des noms d’écrivains. Mais combien honorent des cinéastes ou des téléastes ? »
Didier Decoin poursuit : « Imaginez-vous tout de même que lorsque j’ai reçu le prix Goncourt, j’ai été invité dans un restaurant grec par des amis écrivains qui m’ont adjuré de ne surtout pas écouter les sirènes du cinéma ni de la télévision : “Ne t’acoquine pas avec la vieille pute ! ” La hiérarchie fantasmagorique, qui plaçait le livre au sommet de tout, était encore très pesante. Si bien que quand j’ai vu Charles Brabant et Guy Seligmann être capables de mettre sur pied la SARA, je n’ai pu que les soutenir, même si j’ai quitté la présidence de la SGDL au bout d’un an, en 1979, parce que j’avais trop de travail par ailleurs ».
L’indépendance de la Scam par rapport à la SGDL, le 19 mai 1981, ne s’apparenterait-elle pas à une décolonisation – à l’instar des États- Unis d’Amérique se soustrayant à la tutelle britannique le 4 juillet 1776 ? Guy Seligmann ne va pas chercher si loin : « Ce fut tout simplement un coup d’État : nous avons mis la main sur la SGDL. À l’époque, le nombre de pouvoirs n’était pas limité. Nous sommes donc arrivés avec non pas les pleins pouvoirs, mais avec plein de pouvoirs. Nous avons fait entrer nos copains pour imposer la gestion collective des droits d’auteur. Puis nous avons créé la Scam avec une majorité très confortable. Jean Blot – né Alexandre Blokh à Moscou (1923-2019) –, secrétaire international du Pen Club de 1981 à 1997, nous a donné un sacré coup de main. Mais c’est Didier Decoin qui a été le plus efficace : il a eu l’intelligence d’expliquer aux esprits réfractaires et fermés que si les droits des auteurs de l’audiovisuel n’étaient pas défendus, les droits afférents aux livres risquaient d’être attaqués. Les deux étaient liés, en définitive. Mais jamais nous n’aurions imaginé, nous les 24 auteurs de 1981, que nous serions 49 000 quarante ans plus tard et que les vidéastes rejoindraient les téléastes ! »
Dans cette lutte des Modernes contre les Anciens, la SGDL souffrait de trois défauts dans sa cuirasse. D’abord, nous l’avons vu, la SARA qui menaçait de se substituer à elle dans la négociation et la perception des droits. Ensuite, la création de la Société civile des auteurs multimedia s’est apparentée à une opération mains propres. Dans un historique subjectif et vivant, Charles Brabant vendait naguère la mèche en ces termes : « Certains membres du comité de la SGDL avaient acquis la certitude que le délégué administratif se livrait à des détournements financiers. Ces détournements étaient de nature diverse : tantôt le délégué administratif faisait consentir à des auteurs des avances sur droits, puis leur empruntait de l’argent qu’il ne remboursait pas ; tantôt, ce même délégué confectionnait de fausses déclarations de droits signées au nom d’Homère, de Sophocle, de Racine et à d’autres plus ou moins célèbres, puis ces comptes ayant été crédités, il s’en faisait payer le produit en liquide ; ces versements ne pouvant évidemment pas apparaître en comptabilité. Il y avait “faux et usage de faux” ; le délit était grave. »
Guy Seligmann se souvient aujourd’hui que le prévaricateur a été arrêté, jugé et qu’il a tâté de la paille humide du cachot. La Scam a participé au renflouement d’une SGDL financièrement sur le flanc. Charles Brabant, dans le texte cité, précisait : « Pour donner une idée de la situation d’alors, la SGDL ne pouvait rémunérer la catégorie 1 de l’œuvre documentaire qu’à 20 % de la catégorie 1 de la fiction. Et encore, à ce taux-là, elle ne parvenait pas à réduire le trou déjà creusé ». De surcroît, la Scam engageait alors, en la personne de Laurent Duvillier, un secrétaire général élu à l’unanimité : « Tout le monde était content que nous fassions le ménage », sourit Guy Seligmann.
Enfin, troisième défaut dans la cuirasse, la SGDL était entravée par la loi du 4 janvier 1978 sur les sociétés civiles, qui interdisait qu’une association de type « loi de 1901 » à but non lucratif reçût, gérât et redistribuât des sommes importantes voire considérables : seule une société civile pouvait désormais y pourvoir. Or la Société des gens de lettres est une association « loi de 1901 ». Elle occupe à ce titre l’hôtel de Massa en vertu d’un bail emphytéotique et reçoit, toujours à ce titre, legs et dons lui permettant de distribuer des prix littéraires ou de venir au secours d’autrices et d’auteurs nécessiteux. « La SGDL a longtemps eu le pouvoir spirituel et temporel, mais il lui fallut abandonner ce dernier », résume aujourd’hui Didier Decoin. La vieille dame créée en 1838 ne pouvait plus demeurer une société perceptrice et répartitrice de droits dans cette nouvelle économie législative : la Scam arrivait à point en 1981…
En créant son sigle à partir de la trouvaille géniale de François Billetdoux (la notion d’auteur multimedia), la Scam a-t-elle jamais pensé que sa raison sociale signifie, en anglais argotique, « arnaque » ? Guy Seligmann s’esclaffe : « Nous n’avions rien vu venir, jusqu’à notre première participation à un congrès international de sociétés d’auteurs à Londres. Dès que nous tendions notre carte à un interlocuteur, celui-ci se fendait d’un sourire goguenard entendu. Nous avons compris quand un Anglais francophone compatissant nous en a donné la raison : scam désigne une escroquerie dans la langue de Shakespeare ! »
En Amérique comme en Angleterre, il n’y a pas de regroupements éparpillés d’auteurs en fonction des répertoires, mais une unité qui peut s’avérer efficace – même s’il n’y règne pas le droit d’auteur à la française, mais le copyright. La Scam a-t-elle tenté de jouer la carte unitaire à ses débuts ? Guy Seligmann répond par l’affirmative : « À la suite d’une suggestion de Georges Kiejman, nous sommes allés voir la SACD, Paul Seban, Jean Lallier, Henri de Turenne, Jean-Marie Drot, Jean-Pierre Marchand, d’autres aussi et moi. Armand Lanoux, qui présidait alors la SACD, a refusé de nous rétribuer normalement : le documentaire, nous a-t-il asséné, serait rémunéré 60 % du prix de la fiction. Je lui ai alors demandé si, concernant Flaherty, cela donnait 60 % pour Nanouk l’Esquimau et 100 % pour Tabou ! C’est précisément à la sortie de cet entretien qui n’avait rien donné que nous avons créé la SARA. »
Guy Seligmann ajoute : « L’histoire se répète puisque la Sacem s’est constituée, en 1851, face au refus de la SACD de reconnaître et de défrayer les auteurs de musiques légères et de chansons. Ce mouvement fut déclenché par un fameux incident : en 1847, dans un café-concert de la capitale, Ernest Bourget, Paul Henrion et Victor Parizot refusèrent de payer leurs consommations, estimant ne rien devoir puisque le propriétaire de l’établissement faisait jouer leurs œuvres sans qu’il y ait la moindre rétribution en retour ».
Le premier président de la Scam, au lendemain de sa création en mai 1981, fut Charles Brabant (1920- 2006). Après sa mort et jusqu’à la sienne, Jean-Marie Drot (1929-2015) marchait en s’aidant de la canne de son ami disparu : « J’ai l’impression de lui donner la main ». Guy Seligmann, qui fut par trois fois président de la Scam, ne prononce jamais le prénom « Charles » sans une vibration étouffée dans la voix. Charles Brabant avait vécu l’occupation nazie dans sa chair et jamais n’en parlait. Didier Decoin se souvient avec émotion de cet être admirable, dont il se sentait si proche en dépit de leurs différences politiques : « Respect automatique pour Charles. Il avait ses secrets, ses blessures. Il faut respecter le silence de l’ami : c’est peut-être l’une des plus belles choses, entre deux êtres humains, que ces points de suspension… »
> Lien vers l’article – pdf
> Lien vers la lettre Astérisque n°67 – pdf