Ksenia Bolchakova, prix Albert-Londres 2022, a eu conscience très tôt de son désir de devenir journaliste. Elle n’imagine pas son existence autrement. Aujourd’hui elle dit surtout cette nécessité d’informer coûte que coûte, sans jamais flancher, celles et ceux qui n’ont d’autres oreilles attentives que les siennes, et dont elle peut restituer les histoires. Témoignage d’une femme engagée.
Je devais avoir vingt ans, tout au plus. Nichée à l’arrière de la grande Volvo 240 Classic blanche familiale, je regardais Paris défiler par la fenêtre, s’engager dans une énième nuit. Les lumières des quais de Seine, les vieilles pierres de ses ponts, les touristes feignant la flânerie à l’heure où pointe la fatigue, où les pieds lourds invitent au repos.
J’étais fatiguée moi aussi. Mon père au volant, ma mère à sa droite, France Info à la radio. Leurs voix, les R roulés de la langue russe que nous parlions entre nous se mêlaient aux flashs d’information de la soirée. Je n’ai gardé aucun souvenir des événements de ce jour-là. Enfin, des événements qui secouaient le monde extérieur, celui qui glissait sur la carrosserie lisse et rassurante de la voiture. Je me souviens en revanche de la discussion animée que j’ai provoquée.
Après deux années en classe préparatoire, une année magnifiquement paresseuse sur les bancs de la fac de philo à la Sorbonne, j’avais passé plusieurs concours pour intégrer une école de journalisme et, ce soir-là, j’annonçais à mes parents en avoir réussi trois sur quatre, haut la main. J’étais prise, et j’avais décidé d’intégrer le tout nouveau master créé par Sciences Po Paris. Qu’elle n’était pas la fierté de mon paternel. Lui-même du métier, dans un genre certes différent, puisqu’encarté jusqu’à la moelle au parti communiste soviétique durant une grande partie de sa carrière (il avait travaillé pour la Pravda, la « vérité » en russe, le grand quotidien du PCUS).
Dans un coin de sa tête, j’imagine que mon père nous voyait déjà en pionniers d’une grande dynastie de gratte-papier ou de grands reporters. Il savait quel avait été son rôle pour moi dans le choix de cette profession…
Ksenia Bolchakova
« Ma fille sera journaliste ! », cria-t-il à gorge déployée, couvrant les voix des présentateurs radio qui n’arrivaient plus à en placer une. « Ma fille sera journaliste ! », répéta-t-il encore une fois, un sourire gigantesque aux lèvres, des lumières dans les yeux que je n’y avais jamais vu, des yeux qui fixaient ceux de ma mère avec un air de défi. Dans un coin de sa tête, j’imagine qu’il nous voyait déjà en pionniers d’une grande dynastie de gratte-papier ou de grands reporters. Il savait quel avait été son rôle pour moi dans le choix de cette profession… Il brillait dans l’obscurité de l’habitacle. Son excitation et sa joie tranchaient avec le calme inquiet de ma mère. « Félicitations », glissa-t-elle enfin, après un long silence. Avant d’ajouter : « Mais si tu fais ce métier Ksenia, tu risques de finir vieille fille. »
Ses mots avaient la brutalité d’un coup de massue sur la tête d’un nouveau-né. À peine avait-il eu le temps d’entrouvrir les yeux, qu’on tentait déjà de les lui refermer. L’impression de me trouver à la frontière entre deux mondes, le mien — celui du métier que je m’apprêtais à apprendre, et celui où les femmes n’avaient qu’une destinée possible : le ménage, le devoir conjugal et la maternité. « Tu as déjà vingt ans, poursuivit-elle, et tu n’es toujours pas mariée. Si tu pars tout le temps en reportage, comment vas-tu faire pour avoir une vie de famille ? » Ces questions-là, je ne me les étais évidement jamais posées. Elles n’avaient aucun sens à mes yeux, mais le reproche profond qu’elles impliquaient m’ébranla.
Moi qui avais toujours réponse à tout dans les disputes familiales, je me retrouvais sans voix, sans repartie, blessée d’être réduite à un rôle reproducteur qui ne me tentait absolument pas. Et bizarrement, je ne sais par quel miracle de synchronisation des esprits, mon père fut tout autant blessé que moi. « Elle aura des enfants SI elle veut, QUAND elle veut. Et si elle n’en VEUT PAS, ça sera son choix. Oui, être journaliste, ça implique quelques sacrifices, mais c’est le plus beau métier du monde. Plus qu’un métier, c’est une vie ! » Et se tournant vers moi, il me dit avec force et confiance : « Tu seras journaliste, ma fille ! » Et je le suis devenue.
Notre rôle est d’être des réceptacles attentifs aux sombres histoires des autres, aux peines invivables des autres.
Ksenia Bolchakova
Cet épisode a été déterminant dans mon rapport au « métier ». Pour moi, être journaliste, ce n’est pas un travail. C’est une vocation, un mode de vie, une voie. J’en ai eu conscience très tôt. Il n’a jamais été question d’argent, de poste, de carrière. Mais toujours de vivre par la pratique du journalisme. Mon existence sans elle n’a plus aucun sens, et le sens que je lui donne est le suivant : notre rôle est d’être des réceptacles attentifs aux sombres histoires des autres, aux peines invivables des autres ; d’être les révélateurs des mensonges de certains, des témoins honnêtes de notre temps. Notre responsabilité est de relater des faits que nous avons compris, analysés, vérifiés. Notre tâche est de faire rempart aux faux par tous les moyens possibles, de dompter notre curiosité naturelle, de la structurer, de la transformer en méthode pour fabriquer de l’information.
Alors, pour qui travaillons nous ? Pour ceux dont nous racontons les histoires, pour ceux qui nous font confiance et nous aident à décrypter le monde, pour les malheureux qui n’ont pas d’autres oreilles que les nôtres pour les entendre ; contre les criminels qui voudraient tous nous faire taire. Pour qui travaillons nous ? Pour ceux qui ont encore un peu de compassion pour l’humanité, de la bienveillance pour leur voisin, de la colère et de l’indignation pour ceux qui n’en ont plus. Nos lecteurs, nos auditeurs, nos spectateurs exigent de nous toujours plus de preuves de droiture et d’impartialité ; ils cherchent aussi en nous des miroirs de leurs propres angoisses et de leurs faiblesses.
Ne pas crever, ne pas sombrer, se tenir droit, ne pas mentir, dire la vérité, montrer aussi nos propres émotions, nos fêlures, puisqu’elles ne sont pas si différentes de celles des personnages réels qui peuplent nos récits.
Ksenia Bolchakova
Notre vie est parfois semblable à celle des équilibristes qui marchent sans filet au-dessus du vide. Ne pas crever, ne pas sombrer, se tenir droit, ne pas mentir, dire la vérité, montrer aussi nos propres émotions, nos fêlures, puisqu’elles ne sont pas si différentes de celles des personnages réels qui peuplent nos récits. Le tout, sans jamais se casser la gueule.
Pour qui travaillons nous ? Pour nous tous. Pour vous. Car plus nous partons au cœur des tragédies qu’il nous échoit de couvrir, moins nous en revenons indemnes. Plus nos existences se transforment, plus les larmes étrangères deviennent les nôtres et donnent tout leur sens à nos réveille-matin.
Ksenia Bolchakova est une journaliste franco-russe, lauréate du prix Albert-Londres en 2022, au côté d’Alexandra Jousset, pour le film « Wagner, l’armée de l’ombre de Poutine » sur les enjeux de la géopolitique du Kremlin.
La commission des journalistes de la Scam demande la libération immédiate du journaliste franco-afghan Mortaza Behboudi. Ce reporter est détenu par les Talibans à Kaboul depuis plus de quatre mois. Mortaza Behboudi n’a rien à faire en prison. C’est un journaliste reconnu, respecté et apprécié, avec qui certains d’entre nous ont eu la chance de travailler. Par son engagement sans faille, il a toujours honoré notre profession. Son incarcération est incompréhensible et insensée.
Mortaza Behboudi a commencé sa carrière comme photoreporter à l’âge de seize ans dans son pays natal.
Réfugié en France du fait de menaces, il est accueilli à la Maison des journalistes à Paris. Il a alors vingt-et-un ans. Avec des confrères exilés, il crée le site d’information Guiti News.
Très vite, il collabore avec de nombreux médias français et francophones et notamment France Télévisions, TV5 Monde, Arte, Radio France, Mediapart, Libération, La Croix.
Il est coauteur de la série de reportages À travers l’Afghanistan, sous les talibans, publiée sur Mediapart et primée en 2022 par le prix Bayeux des correspondants de guerre et le prix Varenne de la presse quotidienne nationale.
Il a contribué au reportage Des petites filles afghanes vendues pour survivre, diffusé sur France 2, qui a été également récompensé en 2022 au prix Bayeux.
Nous vous invitons à signer la pétition de demande de libération de notre confrère et à relayer cet appel sur les réseaux #FreeMortaza.

Une perquisition domiciliaire à l’aube. Un placement en garde à vue par la DGSI. Le tout pour une journaliste qui a enquêté sur l’opération SIRLI en Égypte. Une opération qui met gravement en cause la France.
D’évidence, il s’agit de percer à jour le secret des sources qui ont alimenté le travail d’Ariane Lavrilleux pour le site Disclose.
L’association du Prix Albert Londres, qui avait présélectionné cette enquête l’année dernière, et la Scam, tiennent à exprimer tout leur soutien à leur consœur, de même que leur totale solidarité. Le journalisme d’investigation n’a d’autre projet que de répondre à l’intérêt du public.
Contacts presse
Prix Albert Londres > Stéphane Joseph : 06 82 90 01 93
La Scam > Cristina Campodonico : 06 85 33 36 56
Arman Soldin était né à Sarajevo. Il avait fui, enfant, avec ses parents, sa ville natale assiégée. Il a été rattrapé en Ukraine par une autre guerre.
Il était journaliste reporter d’images, coordinateur vidéo en Ukraine. Au plus près des combats, il savait ce que la guerre veut dire.
Il faisait partie de l’équipe de l’AFP qui avait couvert les premiers jours de l’invasion russe. Ses collègues pleurent la disparition d’un généreux et sympathique confrère au sein de l’Agence France Presse qui sait ce que la guerre veut dire.
Le Prix Albert Londres et la Scam s’associent à la douleur de tous ses proches.
Il est le troisième français à tomber dans ces affrontements qui font des milliers de morts. Les chiffres disent si peu le sacrifice de celles et ceux qui travaillent pour que nous sachions ce que la guerre veut dire…
Information > Stéphane Joseph : 06 82 90 01 93

Rendez-vous à Saint-Malo au festival Étonnants Voyageurs pour notre traditionnel temps fort consacré au grand écrivain-reporter Joseph Kessel à l’occasion de la remise du Prix Joseph Kessel 2023 à Sybille Grimbert.
Témoigner, un devoir moral des écrivains, des auteurs, des journalistes, passeurs de la destruction pour faire exister celles et ceux qui ne sont plus.
En présence de Samar Yazbek, Aliyeh Ataei et Justine Augier
Projection de Barayé de Shervin Hajipour
Depuis le début du soulèvement en Iran, « Barayé » est devenu un hymne à la liberté. Le jeune chanteur iranien Shervin Hajipour a écrit cette chanson en s’inspirant de tweets d’internautes iraniennes et iraniens. Arrêté, puis libéré sous caution, il est depuis réduit au silence.
Le jury présidé par Olivier Weber et composé de Tahar Ben Jelloun, Catherine Clément, Annick Cojean, Colette Fellous, Pierre Haski, Isabelle Jarry, Michèle Kahn, Pascal Ory, Guy Seligmann et Patrick Deville (lauréat 2022) remet son Prix à Sybille Grimbert pour Le Dernier des siens (Editions Anne-Carrière).
La sage d’une famile iranienne sur trois générations dans une maison de Téhéran
1h40’ – Prix Mitrani, FIPADOC 2023
La commission audiovisuelle de la Scam a décerné le prix Charles Brabant au cinéaste Avi Mograbi, pour l’ensemble de son œuvre. Son engagement pour la justice au Moyen-Orient et sa contribution innovante au langage cinématographique en font une figure majeure de la création documentaire.
Avi Mograbi naît en 1956 à Tel Aviv, dans une famille sioniste dont il va s’éloigner politiquement à l’adolescence. Après trois années de service militaire obligatoire, il étudie la philosophie à l’Université de Tel Aviv, puis se forme aux arts plastiques à l’école d’art de Ramat Hasharon.
Depuis la fin des années 1980, il décortique dans ses films l’histoire et le présent d’Israël : son métier de cinéaste ne saurait être dissocié de sa relation intime et critique à son pays natal. Refusant toute neutralité ou objectivité feinte, il porte à l’écran toute la complexité du réel, en s’incarnant à la fois comme auteur et personnage de ses films.
Son œuvre explore des réalités politiques et sociales souvent occultées : l’expulsion de Palestiniens (Deportation, 1989 – primé au festival de Cracovie), les manipulations policières ayant conduit à la condamnation de jeunes Arabes israéliens (The Reconstruction, 1994 – Prix du meilleur documentaire, Institut du film israélien), ou encore le culte des figures politiques (Comment j’ai appris à surmonter ma peur et à aimer Ariel Sharon, 1997). Avi Mograbi montre l’instrumentalisation des mythes fondateurs de l’Etat hébreu dans l’éducation israélienne (Ne vengez qu’un seul de mes deux yeux, 2005), met en scène son dilemme moral à raconter l’histoire d’un criminel (Z32, 2009) et expose la mécanique de l’occupation israélienne, à travers les témoignages de soldats vétérans (Les 54 premières années, manuel abrégé d’occupation militaire, 2022).
Son style singulier, mêlant autofiction et cinéma direct, est toujours traversé par une opiniâtreté à raconter et un sarcasme séduisant. En utilisant sa propre image comme espace de doute, de réflexion, de confrontation, Avi Mograbi déplace notre regard, rend alerte, et pousse à la considération de l’autre.
Prochainement sur le site de la Scam, un grand portrait du lauréat et des liens d’accès libre à quelques-uns de ses films.
Le Prix Charles Brabant, créé en 1981, honore la mémoire du président fondateur de la Scam, Charles Brabant. Il consacre le parcours d’un auteur ou d’une autrice dont l’exigence a laissé son empreinte sur la création documentaire.
Il est doté de 8 000 €.
Contact : presse@scam.fr – 01 56 69 64 34
La commission audiovisuelle de la Scam est heureuse d’annoncer que le prix Charles Brabant pour l’ensemble d’une oeuvre sera remis à la cinéaste Simone Bitton.
De Palestine : histoires d’une terre (1993) ; Mur (2004) ou Rachel (2009) à Ziyara (2021), la documentariste n’a cessé de filmer celles et ceux qui témoignent de l’infinie complexité du réel et de sa douleur. Ses films sont des voyages dont on ne revient pas indemnes. Ils resteront.

Simone Bitton naît en 1955 à Rabat (Maroc) dans une famille juive marocaine, qui émigre en Israël lorsqu’elle a onze ans. En 1972, elle fait son service militaire ; la guerre avec l’Egypte éclate un an après. La violence du conflit la marque profondément. Elle s’installe à Paris en 1981, et commence à réaliser des films documentaires, tissés de récits individuels et empreints de sa propre histoire. Sa vision de cinéaste est forgée par une identité riche et complexe – Simone Bitton se définit comme juive arabe – et un engagement pacifiste.
Elle explore, pour la télévision, les questions historiques, politiques et culturelles qui traversent la région du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord. Films d’archives (Palestine : histoire d’une terre, 1997) ; portraits d’artistes (Les Grandes voix de la chanson arabe, 1990 ; Mahmoud Darwich : et la terre, comme la langue, 1998) ou biographie politique (Ben Barka, l’équation marocaine, 1998). Elle passe ensuite au cinéma avec L’Attentat (1998) ; Le Mur (2004), et Rachel (2009). Des films où elle met en lumière la folie du conflit israélo-palestinien, et donne voix à celles et ceux qui résistent aux discours de guerre. Dans son dernier film, Ziyara (2021), la réalisatrice va à la rencontre des gardiens musulmans de sa mémoire juive.
Son engagement est aussi celui de la rigueur formelle et de l’exigence artistique. Son travail a été sélectionné et récompensé dans de nombreux festivals prestigieux et plusieurs de ses films sont considérés comme des ouvrages de référence et sont régulièrement rediffusés.
Contact : presse@scam.fr – 01 56 69 64 34
Le Prix sera remis à Mathias Enard le dimanche 8 juin à 14h au Grand Auditorium du Palais du Grand large, dans le cadre du Festival Étonnants Voyageurs à Saint-Malo.
L’âme vagabonde chez Mathias Enard s’accompagne souvent d’un sentiment de mélancolie. Celle qui sourd de ce livre est joyeuse, festive, et le chagrin devient porte ouverte sur un sentiment d’espoir. Grand voyageur, de l’Europe à l’Orient, polyglotte, traducteur à ses heures, l’orientaliste et Prix Goncourt 2015 nous entraîne pour un automne à Berlin, première escale d’un long périple aux quatre points cardinaux, et dans un espace à la fois géographique et imaginaire, une plongée dans l’intime et dans le temps – « De toutes les frontières que franchissent les voyageurs, celle du temps est la plus courante. » Sous sa plume, il est vrai, les confins deviennent encore plus flous, donc à portée de rêve.
Dans ce long cheminement vers les lointains où l’érudition et de savoureuses anecdotes sont au rendez-vous, on apprend que les larmes sont un précipité de l’Histoire, on éprouve la folie de Jakob Lentz, on se transforme en pantin de neige, à l’instar de l’auteur, à la moindre bourrasque de neige, et on voyage en compagnie de Goethe, Nerval, Heine ainsi que de quelques poètes arabes, jusqu’au bout de la nuit. Les amis d’ici ou de là-bas sont omniprésents, au gré des célébrations littéraires ou des desseins d’ailleurs. Et le spleen se dissout au gré des chemins de traverse. Pérégrin de l’ancienne Prusse au regard humaniste, chantre d’une Europe artistique qui se renouvelle sans cesse, Wanderer à l’ancienne en quête des mondes de demain, Enard ne cesse d’étonner. Et de plonger dans l’altérité.
Olivier Weber, président du jury
Cette année, le jury présidé par Olivier Weber était composé de Tahar Ben Jelloun, Annick Cojean, Velibor Čolić (lauréat 2024), Simonetta Greggio, Pierre Haski, Isabelle Jarry, Michèle Kahn, Pascal Ory, Hubert Prolongeau, Guy Seligmann.
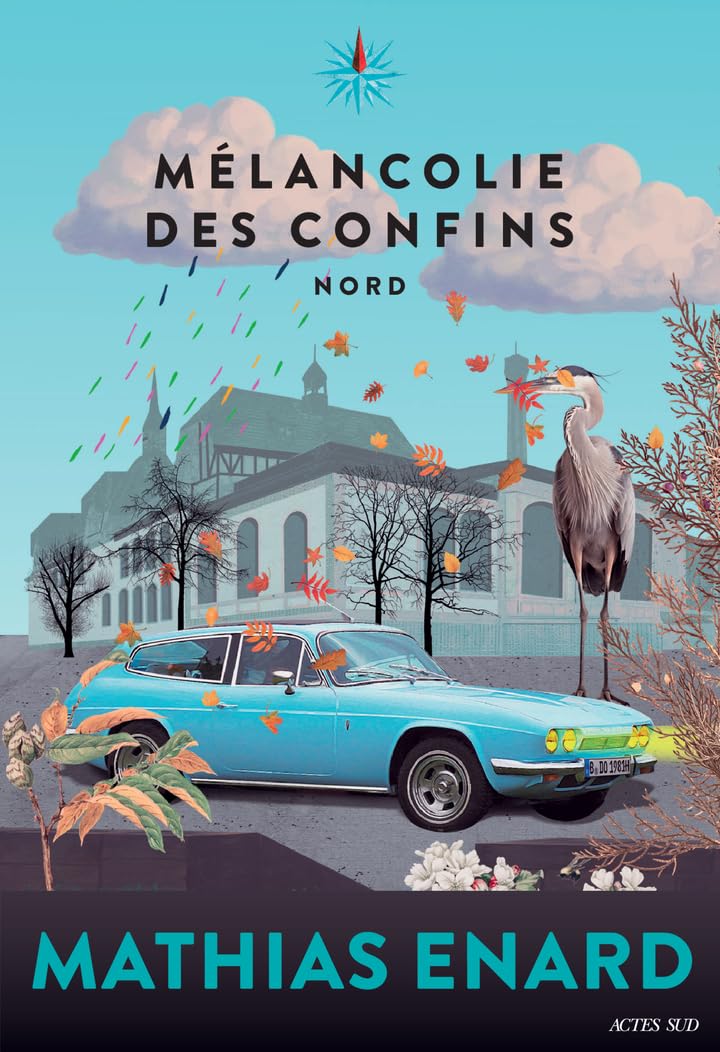
Né en 1972, écrivain et traducteur, Mathias Enard a étudié le persan et l’arabe et fait de longs séjours au Moyen-Orient. Il vit entre Barcelone et Berlin. Il a reçu le prix Goncourt pour Boussole en 2015. Mélancolie des confins – Nord est son dernier ouvrage.


Ce Prix récompense l’auteur ou l’autrice d’un ouvrage littéraire en langue française, dans l’esprit des écrits de Joseph Kessel.
Il est doté de 5 000 €.
Contact : presse@scam.fr – 01 56 69 64 34
Présidé par Olivier Weber et composé de Tahar Ben Jelloun, Virginir Bloch-Lainé, Annick Cojean, Simonetta Greggio, Sybille Grimbert (lauréate 2023), Pierre Haski, Isabelle Jarry, Michèle Kahn, Pascal Ory et Guy Seligmann, le jury a attribué le Prix Joseph Kessel 2024 à Velibor Čolić.
Il lui sera remis le dimanche 19 mai à 15h au Palais du Grand Large, dans le cadre du Festival Étonnants Voyageurs à Saint-Malo.
Comment oublier les fantômes de la guerre ? Par quel sortilège peut-on s’extraire des pluies d’acier qui irriguent la mémoire longtemps après que les canons se sont tus ?
Romancier originaire de Bosnie, Velibor Čolić a choisi la plume pour raconter sa sortie de guerre. Enrôlé dans l’armée croato-bosniaque lors de la guerre de 1992, l’écrivain, qui a alors vingt-huit ans, ne rêve que de déserter afin de fuir le conflit fratricide, cette « beuverie macabre ». Dans les tranchées, là où la morale disparaît peu à peu et où les valeurs humaines se noient dans la boue, il raconte la survie, le désespoir, le tragique. À l’abri du regard des gradés, il écrit sur des carnets, recompose un monde qui serait en paix avec lui-même, tente de contrer la mitraille par le verbe. « La poésie ne peut pas arrêter la guerre. Mais la guerre ne peut pas non plus arrêter la poésie. C’est déjà ça. »
Après son Manuel d’exil, l’auteur qui écrit en français depuis 2008, poursuit dans la veine de l’humour délirant pour surmonter l’effroi. Les réminiscences des champs de bataille sont cruelles. Elles transforment un corps et un esprit. Le temps retrouvé et recomposé par des élucubrations, digressions et hallucinations devient une plaie qui a du mal à cicatriser, mais l’écriture permet précisément de panser certaines blessures.
Exilé en France avant de s’installer à Bruxelles, Velibor Čolić nous livre un roman à la fois drôle et grinçant, caustique et parfois joyeux, afin d’avancer « vers la lumière ». Avec force et talent, ce Vaclav Havel errant sur un champ de bataille rappelle la dérision des écrivains de l’Est et le théâtre de l’absurde. Un livre puissant sur la guerre, cette geste « tellement stupide.
Olivier Weber, président du jury
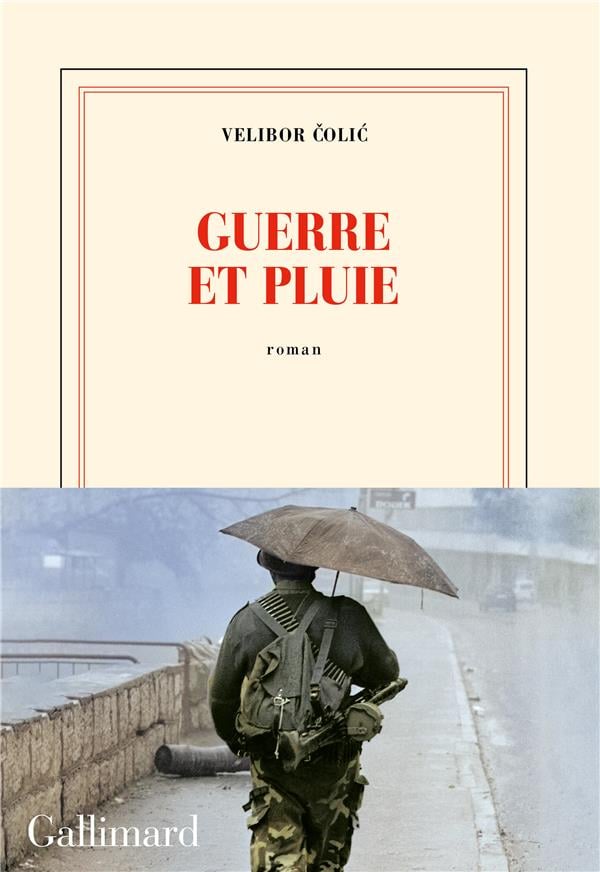
Velibor Čolić est né en 1964 dans une petite ville de Bosnie où il perdra sa maison et ses manuscrits, réduits en cendres pendant la guerre.
Inspiré par sa propre histoire, il revient dans ses romans, publiés aux éditions Gallimard, sur les années de violence qui ensanglantèrent les Balkans : Guerre et pluie (2024) ; Le livre des départs (2020) ; Manuel d’exil. Comment réussir son exil en trente-cinq leçons (2016) ; Sarajevo Omnibus (2012).


Doté de 5 000 € par la Scam, ce Prix récompense l’auteur ou l’autrice d’un ouvrage littéraire en langue française, dans l’esprit des écrits de Joseph Kessel.
Contact : presse@scam.fr – 01 56 69 64 34
Présidé par Olivier Weber et composé de Tahar Ben Jelloun, Catherine Clément, Annick Cojean, Colette Fellous, Pierre Haski, Isabelle Jarry, Michèle Kahn, Pascal Ory, Guy Seligmann et Patrick Deville (lauréat 2022), le jury a attribué le Prix Joseph Kessel 2023 à Sibylle Grimbert
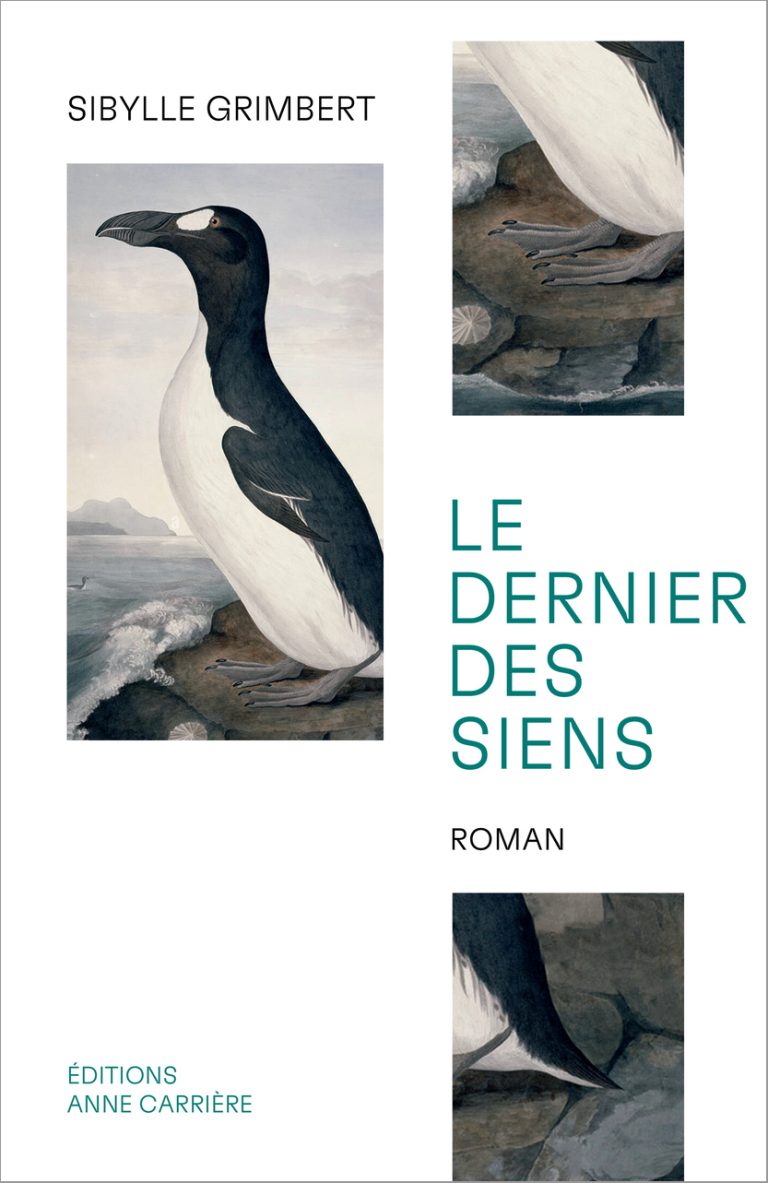
Romancière et éditrice, Sibylle Grimbert dans Le Dernier des siens, questionne l’humain dans son approche du monde sauvage.
1835. En une époque où l’homme exploite la faune sans le moindre scrupule, le musée d’histoire naturelle de Lille envoie le jeune zoologiste Gus dans le nord de l’Europe. Lors d’une traversée, Gus assiste impuissant au massacre d’une colonie de grands pingouins (Alca impennis), et sauve l’un d’eux sans se douter qu’il vient de récupérer le dernier spécimen vivant de l’espèce. Bec de rapace, cri rauque, œil méchant, l’oiseau n’a rien d’un animal de compagnie. Et pourtant, une relation étonnante prendra forme peu à peu, mais comment aimer ce qui est en train de disparaître…
Ce superbe récit d’une amitié improbable raconte aussi l’amère découverte qu’une espèce, si proliférante soit-elle, peut s’éteindre à jamais. En filigrane se lit une question essentielle : l’homme restera-t-il ce prédateur qui détruit la Terre à petit feu, ou trouvera-t-il l’intelligence et la force de se ressaisir ?
Le dernier des siens donne à voir, sentir et imaginer une folle aventure rappelant le regard empathique de Joseph Kessel sur les êtres humains ou les créatures animales, telle son célèbre Lion. Le jury a salué l’originalité de ce douzième roman de Sibylle Grimbert, soutenu par une écriture précise, dense et un style d’une simplicité élaborée.
Michèle Kahn
Ce Prix Joseph Kessel de la Scam, doté de 5000 €, sera remis à l’autrice lors du festival Etonnants Voyageurs, dimanche 28 mai 2023 à Saint-Malo, en présence des membres du jury.

cristina.campodonico@scam.fr – 06 85 33 36 56