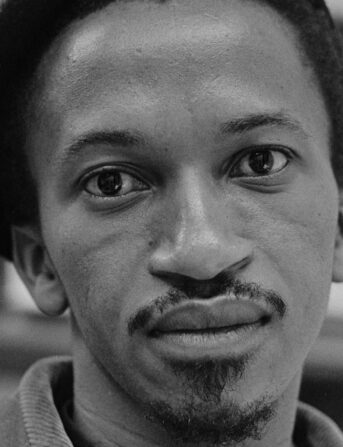Quel a été votre premier contact avec l’oeuvre d’Ernest Cole, et à quand remonte votre besoin de lui consacrer un film ?
Probablement, comme beaucoup de gens de l’époque, à travers le combat anti-apartheid. Ses photos étaient utilisées avant tout dans un but politique, dans des articles, des pamphlets, tout ce qui avait trait à la critique de ce régime. Ça n’était pas un temps où l’on célébrait forcément l’artiste. Ce n’est que bien plus tard que j’ai découvert son livre House of Bondage, et que j’ai pu remettre son travail dans son contexte. Pour ce qui est du film, c’est sa famille qui m’a contacté, après I am Not Your Negro. Ils sortaient un peu déçus de deux tentatives précédentes qui n’avaient pas abouties. A l’époque, j’étais contacté par pas mal d’entités, et j’étais déjà engagé dans Exterminez toutes ces brutes. Le projet était alors trop lourd pour moi, mais je leur ai dit que j’étais intéressé par la préservation de ce patrimoine. Je les ai donc aidés dans la protection, la classification et la numérisation des négatifs, qu’ils étaient en train de rapatrier en Afrique du Sud, à l’Université Wits. Ce n’est que deux ans après que je me suis rendu compte qu’il y avait matière à faire non seulement un film biographique mais surtout un vrai film de cinéma avec différentes couches de récits : le contexte politique, historique, intime…
Vous êtes-vous, en tant qu’exilé, reconnu dans son parcours ?
Dès le départ, quelque chose m’a irrité : cette propension, dans les articles qui lui étaient consacrés au cours des années, à dire « Il était un grand artiste, il a fait un livre incontournable, et puis il a disparu, il est devenu sans-abri, paranoïaque, a sombré dans la drogue… ». Comme si une sorte de destin s’était acharné sur lui, comme s’il n’y avait aucune raison autre que pathologique pour expliquer sa déchéance, sans compter toutes les arrières-pensées autour de la figure de l’artiste maudit… Tout ça n’avait pour moi aucun sens. Très rapidement, je me suis rendu compte que c’était l’exil qui le tuait. Ce même exil que j’ai connu à travers mes parents, à travers les gens que j’ai côtoyé toute ma vie. Je viens d’un pays qui a été sous dictature pendant plus de 35 ans. Je sais ce que c’est de ne pas avoir la possibilité de s’exprimer, je sais ce qu’est la peur, que j’ai également connue au Congo, où j’ai aussi vécu… J’ai très rapidement compris ce qu’il s’était passé dans sa vie. Dans les années 1960, il n’y a pas beaucoup de Sud-Africains, voire d’Africains tout court dans une ville comme New-York. Pourtant, vous vivez au quotidien ce qu’il se passe chez vous. De la même façon que je vis au quotidien ce qu’il se passe au Congo en ce moment, ou en Haïti. Ce ne sont pas des choses que vous mettez à distance, surtout si vous êtes politisé et que le sort de votre pays vous est important. Personne ne quitte son lieu de naissance avec joie, ni ne regarde ce qu’il va trouver ailleurs comme un paradis ! C’est une extrême douleur qui ne disparait jamais. À New-York, j’ai vu des haïtiens qui faisaient leurs valises chaque semaine car chaque semaine ils pensaient qu’ils allaient pouvoir rentrer chez eux. Et ils faisaient ça pendant 30 ou 40 ans, car bien sûr, ils ne rentraient jamais. C’est le sujet de mon premier film de fiction, Haitian Corner, où je parle de cette communauté et de ces gens qui pensent tous les jours à ce qu’ils ont laissé derrière et qui n’arrivent pas vraiment à s’adapter, à cause du poids de la douleur, de l’arrachement de là d’où ils viennent. Je n’ai donc pas eu de mal à comprendre ce qu’il se passait pour Ernest Cole.
Dans I am Not Your Negro, la parole de James Baldwin se déploie à travers de nombreuses interviews. Pourtant, ici, il n’y a pas de dialogue, juste un long monologue intérieur. Un parti-pris qui rejoint une phrase centrale de votre livre J’étouffe, écrit à la première personne : « Je n’ai plus aucun dialogue à initier ».
Il s’agissait de laisser enfin à nouveau la parole à Ernest Cole, puisqu’on lui a supprimé à la fois son mode d’expression et le résultat de son travail. Je n’avais pas envie de recourir à ce procédé qu’on appelle les « talking heads ». Je n’avais pas envie de laisser cette parole se faire accaparer de nouveau par des experts. Cette phrase tirée de mon livre J’étouffe, c’était pour dire aussi que les « talking heads » ne m’apportaient rien du tout. Aujourd’hui, on peut aller à la radio et dire ce que l’on veut, n’importe quoi. Toute opinion semble aussi solide que toute recherche de 50 ans par un vrai spécialiste. C’est du nombrilisme, des discussions qui n’ont ni queue ni tête, qui n’amènent aucun changement. Ce ne sont pas des dialogues. Ce sont des joutes totalement vides d’impact et de résonances. Voilà pourquoi j’ai voulu concentrer le film dans la parole d’Ernest Cole.
La parole d’Ernest Cole justement : le film est construit autour de ses textes existants, mais aussi de paroles en partie réinventées, même si elles sont parfaitement documentées et sourcées. Pourquoi avez-vous décidé de franchir cette barrière, de subvertir en quelque sorte le pacte documentaire avec cette hybridation ?
C’est un risque que je prends, mais en faisant en sorte de ne jamais faire dire à Ernest Cole quelque chose qu’il ne dirait pas. Le grand avantage que j’avais, c’est que le livre House of Bondage est un sacré paquet… Avec des textes incroyables, bien écrits, dans lesquels on peut lire la façon dont il parle, son humour, sa poésie, et comment il déconstruit l’apartheid d’une manière clinique. J’ai tous les instruments pour me mettre dans sa peau à partir d’informations factuelles, précises. Par exemple, quand j’écris « J’ai pensé parfois au suicide, et pas qu’une fois », c’est parce que j’ai recueilli le témoignage d’une femme qui travaillait à l’agence Magnum dans les années 1960, qu’Ernest Cole appelait presque tous les jours de la côte est des USA quelques mois avant sa mort. Elle nous a raconté ses pensées noires, sa frustration de disparaitre comme ça… Je n’invente absolument rien. Parfois, je prends même des bribes de phrases réelles. Par exemple quand il parle, ou plutôt quand je le fais parler de ces deux jeunes filles dans cette chambre à Stockholm, c’est parce que nous les avons retrouvées, elles qui sont maintenant des dames de 85 ans. Quand l’une d’elles dit « I don’t remember, my memory fails me », c’est sa phrase exacte. C’est une licence poétique, artistique, mais qui est très précise, ce n’est pas de la spéculation. En mettant ces mots dans la bouche d’Ernest Cole, je m’approche le plus possible de son style, de sa manière d’écrire, de la précision et de la brièveté de son langage.