Attentive au respect de la parité dans son offre de programmes et conscient de son rôle moteur en tant que premier financeur de la création audiovisuelle, France Télévisions porte l’ambition, en lien avec la Scam et la GARRD, de renforcer la place des femmes dans le documentaire.
Les études menées par France Télévisions, la Scam et la GARRD font apparaître une situation de déséquilibre entre réalisateurs et réalisatrices. En 2021, la part des réalisatrices dans les documentaires de France Télévisions a atteint 41%. Il existe cependant de fortes disparités selon les thématiques. Ainsi, les documentaires scientifiques, d’histoire et de découverte comptent seulement environ 20% de réalisatrices.
France Télévisions partage donc le constat dressé par la Scam – dont 38% des membres sont des autrices – et la GARRD, d’une trop lente progression des opportunités données aux réalisatrices. Parce que le documentaire n’a pas de genre, il est temps d’enrichir nos récits d’un regard pluriel, mixte et paritaire.
France Télévisions se fixe donc pour objectif d’atteindre 50% de réalisatrices dans le documentaire dès 2023, avec un point de vigilance particulier pour les documentaires scientifiques, historiques ou de découverte, ces domaines d’expertise étant par ailleurs marqués par une relativement faible présence féminine.
La Scam et la GARRD soutiennent les engagements de France Télévisions et s’engagent à les communiquer largement auprès de leurs adhérentes, afin de les encourager à investir l’ensemble des genres du documentaire.
France Télévisions, la Scam et la GARRD entendent ainsi accompagner, soutenir et promouvoir la place des femmes dans la création documentaire.
L’égalité est un combat qui impose de compter et de se fixer des objectifs : c’est la ligne de conduite du groupe, depuis plusieurs années et dans tous les genres de programmes. Je suis donc très fière de cet objectif d’atteindre, dès 2023, la parité parmi les réalisateurs et réalisatrices de documentaires. Nous réalisons aujourd’hui un nouveau pas décisif vers une meilleure valorisation de tous les talents, à tous les rôles et sur toutes les thématiques.
Delphine Ernotte Cunci, Présidente-directrice générale de France Télévisions
Jusqu’en 2013, la Scam n’avait été présidée que par des hommes. Est-ce un hasard, si, après que trois femmes leur ont succédés, la Scam est entrée dans l’ère de la maturité ? Neuf ans plus tard en tout cas, notre société porte belle avec ses 50 000 autrices et auteurs. Parité dans les instances, adaptation du vocabulaire usuel, exigence de gages de diversité pour tous nos soutiens financiers, dénonciation des incongruités persistantes… Il reste encore beaucoup à faire. Nous y œuvrons chaque jour et je sais que nous sommes sur la bonne voie d’une indispensable égalité, c’est « une simple question de justice ».
Rémi Lainé, réalisateur et président de la Scam
La GARRD se réjouit de l’exemplarité de France Télévisions quant à l’objectif de parité qui représente une avancée majeure pour les réalisatrices de documentaire. Il faut maintenant que ce combat soit porté par l’ensemble de notre secteur, qu’il se décline sur toutes les chaînes de télévision et sur toutes les cases. Réalisatrices et réalisateurs doivent avoir un égal accès à la production et à la diffusion de leurs films. La parité, c’est maintenant !
Vincent de Cointet, réalisateur et président de la GARRD
France Télévisions : Jennifer Armand – 01 56 22 22 90 – jennifer.armand@francetv.fr
Scam : Astrid Lockhart – 06 73 84 98 27 – astrid.lockhart@scam.fr
GARRD : Perle Schmidt-Morand – 06 32 14 78 44 – perle.schmidt-morand@garrd.fr
La Scam et LCP-Assemblée nationale, partenaires depuis 2000 pour la rémunération des auteurices, décident de renforcer leurs relations.
Lors du Sunny Side of the Doc, les deux institutions annoncent la création de la Bourse Premier Rêve LCP-Assemblée nationale / Scam
Depuis 1992, les bourses Brouillon d’un rêve de la Scam aident les auteurices à développer leur projet documentaire en cours d’écriture.
Parmi l’ensemble des projets de premiers films documentaires soutenus par la Scam sur une année, une bourse complémentaire dotée par LCP-Assemblée nationale est désormais attribuée par un jury LCP-Assemblée nationale / Scam.
En qualité de coproducteur et primo-diffuseur, LCP-Assemblée nationale s’engage à faire un apport de 25.000 euros en numéraire sur un projet déjà accompagné d’une société de production.
Cette bourse 1er rêve obéit à deux impératifs : En premier lieu, permettre à LCP, en tant que diffuseur, de soutenir le travail de La Scam auprès des auteurs.
En second, grâce à ce formidable vivier de nouveaux talents, offrir aux téléspectateurs de LCP une sélection de programmes exigeante et sans cesse renouvelée, qui trouvera naturellement sa place parmi l’offre documentaire de LCP.
Pour l’attribution de cette première bourse 1er rêve, la Scam et LCP ont décidé de récompenser Orage de Clément Pérot-Guillaume.
En assurant la diffusion de ce film, LCP permet à ce qui n’est que le brouillon d’un rêve, aujourd’hui, de rencontrer un public. LCP est ainsi, grâce à ce partenariat, fidèle à son ambition de rester un dénicheur de talent.Bertrand Delais, directeur général de LCP-Assemblée nationale
Je me réjouis de ce partenariat qui met en avant ce à quoi la Scam tient tout particulièrement, à savoir l’aide à l’écriture des films documentaires, tant il est vrai que les auteurices ont les plus grandes difficultés à pouvoir écrire leur projet en étant rémunéré. Et je remercie Bertrand Delais et LCP de leur engagement tout à fait remarquable pour que les lauréats des bourses Brouillon d’un rêve voient leur rêve devenir réalité et trouver leur public.
Hervé Rony, directeur général de la Scam
Un après-midi de fin d’été dans un quartier de banlieue, quelque part dans le nord de la France, en périphérie de la mer. Des enfants et des adolescents errent en bas des tours, entre les immeubles et les terrains vagues, sous le soleil et les cris des mouettes. Ils tuent le temps qui s’écoule, se parlent d’amour, de doutes et d’espoirs, tentent de comprendre ce qui les anime.
LCP-Assemblée nationale : c.lambret@lcpan.fr – 06 47 27 56 23
Scam : astrid.lockhart@scam.fr – 06 73 84 98 27
Les prix sonores de la Scam récompensent dans leur diversité les plus belles écritures radiophoniques. Cette mise en valeur encourage les jeunes talents et rend hommage aux autrices et auteurs confirmés. Ces trois prix ont été remis en ouverture de la Nuit de la radio, le mardi 17 juin à la Scam.
Colette Fellous est productrice radio, romancière (mêlant poésie, autobiographie et documentaire) et éditrice (à l’origine de la collection Traits et portraits au Mercure de France).
Elle rejoint France Culture en 1980 en tant que productrice et de 1989 à 1999 elle anime les Nuits magnétiques. Elle crée ensuite Carnet nomade, qu’elle produira jusqu’en 2015 : une émission faite de récits de voyage et de rencontres, où elle dialogue avec des peintres, scientifiques, jardiniers ou simples passants. C’est cette grande voix radiophonique que le jury récompense aujourd’hui.

48’ – diffusion le 4 novembre 2024, sur RTBF (Par Ouï-dire)
Dernier documentaire de Yasmina Hamlawi, Pleuvoir sur les morts explore poétiquement les rites, la transmission et la mort. En Algérie, Yasmina cherche à faire ses adieux à son père, un moment dont elle a été exclue par les rites traditionnels. Sa fille Kenza, munie de crayons de couleurs, dessine ce qu’elle voit et remonte le fil de ses origines.
Ensemble, elles vont s’inventer un rituel qui leur est propre, pour renouer avec l’absent.
En Algérie, l’enterrement est une affaire d’hommes, les pleurs sont une affaire de femmes.
Yasmina Hamlawi est autrice sonore et journaliste indépendante. Elle collabore avec plusieurs médias comme le Monde Diplomatique ou La libre Belgique et oriente son travail sur l’accès des femmes aux droits fondamentaux. Ses créations radiophoniques donnent voix aux invisibles. Le prix de l’exil (2012) a été nominé au Prix Europa et au Festival Longueur d’Ondes, tandis que Perle, son second documentaire, a reçu plusieurs distinctions internationales.
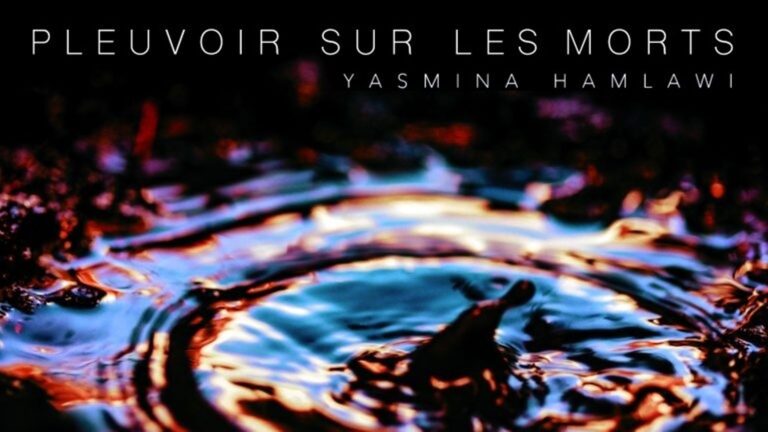
4×55’ – diffusion le 26 février 2024, sur RTBF (Par Ouï-dire)
Dimitri deux fois disparu est l’enquête personnelle de Matthieu Cornélis. Dimitri, enfant placé par le juge de la jeunesse, est confié à la famille Cornélis. Il est enlevé par sa mère biologique. Pendant 40 ans, plus aucune nouvelle. Matthieu part sur les traces de son frère disparu et des dysfonctionnements du système.
Matthieu Cornélis est journaliste et documentariste sonore. Formé à la photographie, il découvre l’écriture radiophonique avec Ainsi brament-ils, son premier portrait sonore (2019). Son documentaire Dimitri deux fois disparu a reçu cette année une mention au festival Longueur d’ondes à Brest.
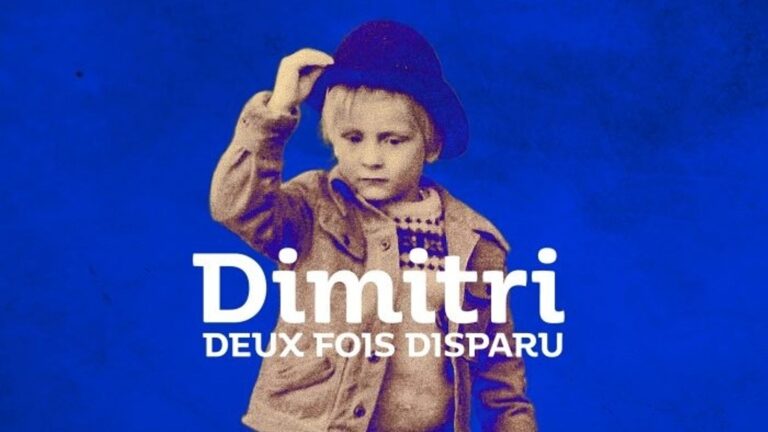
Contact presse : presse@scam.fr – 01 56 69 64 34
Les prix sonores de la Scam récompensent dans leur diversité les plus belles écritures radiophoniques. Cette mise en lumière encourage les plus jeunes et rend hommage aux autrices et auteurs confirmés. Ils seront remis aux trois lauréates, en ouverture de la Nuit de la radio, le vendredi 27 septembre à la Scam.
Aline Pailler est journaliste de radio, de télévision et de presse écrite, écrivaine, et femme politique. Son œuvre radiophonique comprend de nombreux documentaires sonores, des émissions hebdomadaires, des chroniques et des débats. Elle anime sur France Inter une chronique matinale quotidienne, et participe aux émissions Sans tambour ni trompette avec Jean-François Kahn, Chocolatine ; Les Dromomaniaques ; Sens dessus dessous, ou encore L’Oreille en coin. Elle entre à France Culture en 2007 et produit Jusqu’à la lune et retour, rebaptisée Le Temps buissonnier en 2013, une émission hebdomadaire consacrée à l’actualité de la littérature de jeunesse et des spectacles pour le jeune public.

60’ – diffusion le 23 avril 2023, sur France Culture (L’Expérience)
Manon Prigent explore la relation qui s’est nouée dans les années 1990 entre la sculptrice et dessinatrice Mâkhi Xenakis et la plasticienne Louise Bourgeois. Avec l’accord de cette dernière, Mâkhi Xenakis a enregistré leurs échanges. Elles préparent à ce moment-là un livre ensemble. Ce documentaire sonore révèle les liens d’interdépendance affective et artistique entre les deux femmes, et interroge l’influence mutuelle dans le processus créatif. Que va-t-on puiser chez l’autre pour créer à son tour ? Qui dévore ? Qui libère ?

Manon Prigent est autrice et réalisatrice de documentaires sonores. Depuis 2019, elle réalise des documentaires radiophoniques sur ARTE Radio : La moitié du gourou, 2024 ; Tout fout le camp, 2021 et sur France Culture pour les émissions L’Expérience et la série documentaire Non merci, pas d’enfant et Quand la vie privée devient publique, 2022.

56’ – diffusion le 7 octobre 2023, sur France Culture (L’Expérience)
À la suite des attentats de novembre 2015, Nastasia Gandon prend part à l’étude REMEMBER consacrée à la mémoire et au syndrome de stress post-traumatique. Peu de temps après, la mémoire de son père est déclarée défaillante, révélant qu’il est atteint de la maladie d’Alzheimer. Le geste instinctif d’enregistrer son père ce jour-là marque le début de ce documentaire sonore. De la douleur du souvenir à celle de l’oubli, écho de la mémoire.
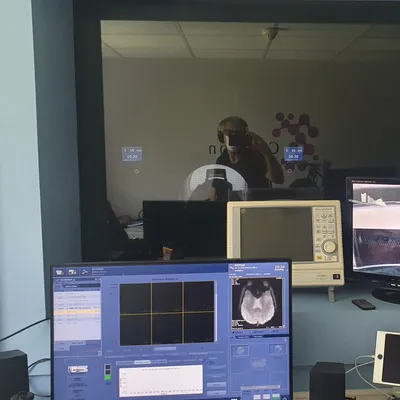
Hippocampe : quand la mémoire défaille est la première réalisation sonore de Nastasia Gandon. Elle a reçu le soutien de Brouillon d’un rêve de la Scam.

Les prix sonores de la Scam récompensent dans leur diversité les plus belles écritures radiophoniques. Cette mise en lumière encourage les plus jeunes et rend hommage aux autrices et auteurs confirmés. Ils seront remis aux quatre lauréates et lauréats, en ouverture de la Nuit de la radio, le vendredi 23 juin à la Scam.
Journaliste et photographe, Alex Dutilh a fêté en avril dernier quarante ans de radio, dont quinze ans consacrés à son émission quotidienne Open Jazz sur France Musique, dans laquelle il reçoit débutants, talents émergents, artistes confirmés, avec toujours la même passion et la même qualité d’écoute.
Alex Dutilh a consacré toute sa vie à transmettre sa passion du jazz. Entre 1972 et 1980 il collabore à la revue Jazz Hot. Il crée en 1984 le Centre d’information du jazz (CIJ), ainsi que le Salon européen du jazz. De 1983 à 1992, il est responsable de la rubrique jazz dans le magazine Le Monde de la Musique et dirige parallèlement le Centre d’information et de ressources pour les musiques actuelles (ex Cenam).
En 1992, il co-fonde le mensuel Jazzman dont il est rédacteur en chef jusqu’en 2009.
De 1989 à 2000, il est le directeur artistique du festival Musiques Croisées à Saint-Sever. De 1990 à 2009, il est nommé à la tête du Studio des variétés, un organisme de formation continue pour chanteurs. Pendant cette même période il est auteur et présentateur d’émissions de jazz pour la chaîne Arte, produites par Agat Films.

4 épisodes de 57’ – diffusion du 19 septembre au 22 septembre 2022, sur France Culture (LSD)
À l’ombre des grands procès médiatiques récents (attentats de Charlie Hebdo et de l’Hyper Cacher, le procès des attentats du 13 novembre 2015 ou de Nice), ce travail documentaire met en exergue un certain nombre de dérives répressives de la justice antiterroriste et de sa gestion politique et médiatique ces dernières années. Il s’efforce de faire la part des choses entre un système de surveillance et d’encadrement nécessaire et les dommages collatéraux d’un relatif emballement punitif.
Formé dans différents champs disciplinaires des sciences humaines (l’histoire, la littérature, la science politique et surtout la philosophie politique contemporaine qu’il a enseignée à l’Université Paris 8 Vincennes/Saint-Denis), Adrien Chevrier produit depuis quatre ans des documentaires radiophoniques pour France Culture (des portraits pour l’émission Toute une vie, des reportages pour La Série documentaire ou des créations radiophoniques pour L’Expérience). Il est également co-organisateur et co-programmateur du festival Tumultes qui se tient, depuis deux ans, dans les Cévennes (Thoiras).

48’ – diffusion le 30 novembre 2022, sur la RTBF (Par Ouï-dire)

Pendant plus d’un siècle, les bains révélateurs des Laboratoires Éclair ont fait apparaître des images sur des milliers de kilomètres de pellicule. Les ouvriers et ouvrières des Laboratoires ont souvent œuvré toute leur vie à finaliser les œuvres des cinéastes. Éclair – Le son révélateur retrace l’histoire commune des travailleurs et travailleuses de l’ombre du cinéma argentique, et fait rejaillir à travers elle la mémoire de sons presque disparus – celui de la pellicule, d’une époque, d’un lieu et d’outils de travail qui lui étaient entièrement dédiés.
Autrice, réalisatrice sonore et architecte, Clara Ries a été formée par le collectif de création sonore Transmission en 2020 et fait depuis activement partie de son organisation. En 2022, elle réalise deux documentaires : La Clarinette de Radko, sur la charge qu’un objet hérité peut avoir, ainsi que Éclair, le son révélateur, co-réalisé avec Sarah Lefèvre, qui retrace l’histoire commune des travailleurs et travailleuses de l’ombre du cinéma argentique des Laboratoires d’Épinay-sur-Seine. Clara Ries anime régulièrement des ateliers radio en milieu scolaire ou dans le cadre d’ateliers socio-linguistiques. Elle est investie dans plusieurs associations locales en Isère où elle réside, notamment pour le maintien d’un petit cinéma rural. Ses expérimentations actuelles se tournent vers des créations sonores collectives – adaptation littéraire, fiction et théâtre radiophonique.

Sarah Lefèvre est documentariste et formatrice radio, cofondatrice de Transmission.
Ses enquêtes écrites et sonores autour des mouvements sociaux (Légitime Violence, Label Convergence, 2019), des conditions de travail et du lien avec les territoires (Là-bas si j’y suis – France Inter ; Si loin Si proche – RFI ; L’Expérience – France Culture) s’accompagnent de réalisations photographiques. Après le court-métrage Lonesome Cowboy – portrait d’un éleveur cajun en proie aux ouragans sur ses terres natales (prix 2019 Diapero et Arte Info), elle co-réalise la suite de l’histoire de Hank Moss avec Édouard Richard (film en cours).

Cristina Campodonico – cristina.campodonico@scam.fr
Les prix sonores de la Scam récompensent dans leur diversité les plus belles écritures radiophoniques. Cette mise en lumière encourage les plus jeunes et rend hommage aux autrices et auteurs confirmés. Ils seront remis aux trois lauréats, en ouverture de la Nuit de la radio, le jeudi 16 juin à la Scam.
Né en 1941 dans les Ardennes, Jean Daive est encyclopédiste, reporter, photographe, romancier, poète, homme de radio et directeur de revues. Il a publié plus de quarante livres et il est traducteur de l’allemand et de l’anglo-américain. C’est en 1975 qu’il entre à France Culture, participant aux Nuits Magnétiques dès leur création en 1978, ainsi qu’à la plupart des programmes de la chaîne confiés aux producteurs tournants, du Pays d’ici à À voix nue, en passant par les émissions spéciales de longue durée comme Un rêve américain, Franz Kafka, William Faulkner-Mississipi, Dylan Thomas. Son oeuvre radiophonique comprend de nombreux Grands Entretiens avec, entre autres, Julien Gracq, Jorge Luis Borges, Jean-Luc Godard, Jean-Marie Straub, Francis Ponge, Christian Boltanski, Marguerite Duras, James Baldwin, Robert Rauschenberg.

52’13 – diffusion le 1er mars 2021, sur la RTBF La 1ère (Par Ouï dire)
Piste animale est un bestiaire subjectif et sonore. Un chassé-croisé intemporel humain/animal, avec un gonflement du réel, un effet de décalage, d’amplification et d’exagération.
Ce sont des histoires à suspens, où l’on arrive ou trop tôt, ou trop tard. Elles racontent ces bêtes qui résonnent dans le bois, ces oiseaux qui s’envolent vers les derniers confins, ou ces petits animaux qui rampent en lisière.
Que l’on entend, sans voir. Que l’on espère, sans vanité. Que l’on connaît à peine.
Péroline Babet-Adda est réalisatrice, créatrice sonore et productrice déléguée pour la radio et différentes structures patrimoniales. Elle assure la production artistique de disques et réalise des documentaires radiophoniques pour France Culture. Elle travaille notamment sur les musiques populaires et traditionnelles et ses productions mêlent archives, collectages et créations sonores. Sa démarche s’ancre dans une recherche ethnologique.

4 x 55’ – diffusion du 18 au 21 octobre 2021, sur France Culture (LSD)
Pour cette série documentaire, Hajer Ben Boubaker replonge dans l’histoire méconnue de l’une des pierres angulaires des luttes antiracistes et sociales de la France, celle du mouvement des travailleurs arabes. Première organisation antiraciste autonome, le MTA et ses membres ont jalonné les luttes des années 1970 portant au cœur du débat public l’égalité entre immigrés et français. À l’heure du débat vivace autour de l’antiracisme, cette série propose de mettre en lumière l’histoire d’une décennie méconnue, entre la fin de la guerre d’Algérie et la marche pour l’égalité et contre le racisme de 1983.
Diplômée en Histoire et Sciences Politiques de la Sorbonne et du Master Genre, Politique et Sexualité de l’EHESS, Hajer Ben Boubaker est actuellement chercheuse indépendante. Elle s’intéresse à l’histoire des musiques arabes et des luttes ouvrières de l’immigrations nord-africaine ainsi qu’aux politiques migratoires européennes et leurs influences dans les pays de la rive sud de la méditerranée. Elle est créatrice du podcast Vintage Arab qui interroge la place des transmissions culturelles et politiques en diaspora et qui s’attache à se réapproprier un patrimoine.

Astrid Lockhart – 06 73 84 98 27 – astrid.lockhart@scam.fr
Les auteurs et autrices de la Scam ont approuvé mercredi 19 juin, à une très large majorité, l’ensemble des résolutions soumises au vote.
Nombre d’associés inscrits : 52 537
Nombre total de votants : 2 248 (soit 4,28 %)
1/ Rapport d’activité et de transparence 2023
Nombre de « Oui » : 4 774 voix soit 99,09 %
Nombre de « Non » : 44 voix soit 0,91 %
2/ Comptes annuels 2023
Nombre de « Oui » : 4 716 voix soit 98,97 %
Nombre de « Non » : 49 voix soit 1,03 %
3/ Affectation de l’excédent de gestion 2023
Nombre de « Oui » : 4 734 voix soit 96,83 %
Nombre de « Non » : 155 voix soit 3,17 %
4/ Utilisation de sommes irrépartissables durant l’exercice 2023
Nombre de « Oui » : 4 412 voix soit 97,03 %
Nombre de « Non » : 135 voix soit 2,97 %
5/ Budget prévisionnel des indemnités, défraiements et rétributions des membres des organes sociaux
Nombre de « Oui » : 4 205 voix soit 95,76 %
Nombre de « Non » : 186 voix soit 4,24 %
6/ Budget culturel 2024
Nombre de « Oui » : 4 641 voix soit 97,28 %
Nombre de « Non » : 130 voix soit 2,72 %
Le budget culturel 2024 est approuvé à la majorité des 2/3.
7/ Convention règlementée avec la SCI 5 Vélasquez
Nombre de « Oui » : 4 115 voix soit 97,30 %
Nombre de « Non » : 114 voix soit 2,70 %
Quand les fils des destinées se croisent… Marguerite Yourcenar fut la première femme admise à l’Académie française le 6 mars 1980. Chantal Thomas, lauréate de notre Prix Marguerite Yourcenar 2022, a rejoint les rangs de l’Académie française, le 16 juin. La romancière Simonetta Greggio nous entraîne dans le sillage de l’œuvre multiple de Chantal Thomas.
Je nageais au milieu des vagues de la Méditerranée lorsque j’ai pensé à vous, chère Chantal Thomas. J’ai pensé qu’il fallait que j’efface ce que j’avais écrit et que je recommence autrement le texte qui parle de vous et de vos livres. J’ai pensé que tout ce qui est convenu ne vous correspond pas.
J’ai pensé que vos yeux sont exactement de la couleur de l’eau de mer dans laquelle j’étais plongée, d’azur avec un liseré bleu.
J’ai pensé que ce prix Marguerite Yourcenar dont la Scam récompense l’œuvre entière d’un écrivain tombe à point pour vous découvrir ou redécouvrir, parce que Yourcenar avait cette même urgence que vous de comprendre, de formuler. De raconter, de s’amuser. D’être libre et de rendre au lecteur sa liberté.
Et puis, j’ai pensé qu’il fallait vous laisser la parole :
S’offrir aux caresses, voir et revoir La Nuit, la Voie Lactée, Profession Reporter, Catherine Deneuve dans Belle de Jour et Humphrey Bogart dans Casablanca, boire du champagne et des margaritas, marcher dans Central Park, y faire du patins à glace, s’ acheter des jacinthes des chaussures et des billets d’avion, essayer des chapeaux, rêver sur des kimonos, emplir sa chambre de fleurs des champs, la livrer au plus grand désordre, en faire l’antre de métamorphoses, changer d’adresse comme de chemise, se souvenir de ses rêves, ne pas s’empêcher de pleurer, parler avec des inconnus, s’enfuir des conférences et des théâtres où l’on s’ennuie, prendre au hasard n’importe quel autobus, lire au lit, se peindre les ongles, descendre en plein soleil dans la poudreuse des pentes qui n’en finissent pas, manger des cerises, nager dans toutes les mers du monde.
Il y a chez vous ce charme de vivre comme on marche, on skie, on glisse, on embrasse, on fait l’amour, on boit de l’eau et du vin ; pour chacune, et à chacune, de ces actions, vous donnez le temps et le sens qui conviennent. Et le respect. Et la dignité. L’acte est un, définitif mais renouvelable tant qu’on foule cette terre, tant qu’on respire – tant qu’on peut – car s’il y a, parmi les merveilles de votre écriture, une vertu qui saute promptement aux yeux, c’est le désir. Un désir qui déborde du cadre, qui saute dans une marelle sur un pied, qui avale le lecteur dans un sourire, gourmandise plus forte que tout.
car s’il y a, parmi les merveilles de votre écriture, une vertu qui saute promptement aux yeux, c’est le désir. Un désir qui déborde du cadre, qui saute dans une marelle sur un pied, qui avale le lecteur dans un sourire, gourmandise plus forte que tout.
Simonetta Greggio
Née à Lyon en 1945, directrice de recherches au CNRS, vous multipliez les facettes d’un répertoire qui vous voit tour à tour romancière, essayiste, scénariste et auteur de pièces de théâtre. Férue du XVIIIe siècle, – votre siècle d’élection, ennemi du pathos et de la morbidité, branché quoi qu’il en coûte sur une musique de Vivaldi ou de Mozart – vous avez écrit sur Sade, Casanova, Marie Antoinette et ses contemporains. C’est d’ailleurs avec Les Adieux à la Reine, roman émouvant sur les derniers jours de Versailles, délicieusement porté au cinéma, que vous avez reçu le Prix Femina et vous avez été connue – ou devrait-on plutôt dire reconnue ? – du grand public.
Mais c’est également au moment où la lumière vous frappe que votre mystère s’épaissît. Comment faites-vous pour suivre pas à pas la jeune Agathe, lectrice personnelle de Marie Antoinette, dans cette quête éperdue de sa Reine, une femme à laquelle elle voue la dévotion que l’on voue aux Saints ? Avez-vous vous eue une autre vie, parallèle ou plus ancienne, dans laquelle vous fouliez les marbres de Versailles en compagnie de ces personnes que vous semblez connaître si bien ?
Tout ce qui se passe dans ces pages est magique, intense, surnaturel. L’on sort de cette lecture avec l’impression exacte d’un visage que l’on aurait, par l’entremise de votre héroïne, connu, et par son biais, adoré.
Simonetta Greggio
L’on en sort les narines à l’affut des fleurs que la Reine affectionnait, les oreilles attentives à l’écho des pas des courtisans dans les nuits d’avant le massacre, le cœur affolé par l’imminence de la Terreur. A la fin, Agathe est sauvée. La Reine est perdue. Gabrielle de Polignac, la favorite de Marie Antoinette, meurt le cœur brisé à Vienne peu de temps après. Nous sommes ravis et en voulons plus. Et nous en aurons plus encore, avec L’Echange des Princesses et le Testament d’Olympe, remarquables de sensualité, où les mots justes voisinent les mots crus – non, vous ne nous laissez pas oublier que vos premières amours, auprès de Roland Barthes à l’époque de votre fréquentation de son séminaire légendaire de la rue de Tournon, furent Sade et les libertins. Dans votre texte Sade, la dissertation et l’orgie, vous disséquez allègrement ces phrases dont vous dites que vous étiez, à l’origine, incapable de les situer dans un contexte d’histoire littéraire ou politique. De l’avoir fait, continuez-vous, n’a en rien diminué, relativisé ou même expliqué la puissance phantasmatique. Vous nous faites partager aussi la réaction de Barthes lorsque vous lui avez fait part de votre projet :
Son visage s’était voilé d’une très grande lassitude, puis, pendant deux ans, nous n’en avons plus jamais parlé. Quand je lui envoyais des chapitres, il me répondait, sur des cartes postales, par quelques mots brefs et délicats, aussi courtois qu’allusifs.
Vous concluez par l’exquis : Barthes n’aidait pas.
La débauche sadienne, l’aventure (masochiste & malicieuse) Casanovienne autour de laquelle vous écrivez par la suite – Casanova, un voyage libertin – vous intriguent et vous réjouissent – vous jouez avec nos nerfs, et avouez que vous prenez plaisir à nous lâcher la main au milieu de vos monstres, à nous mener par le bout du nez – à faire de nous, enfin, vos jouets, avec vos mots à tiroir : (…) cette formule qu’utilise Casanova pour (ne pas) faire l’amour : donner le bonjour ! Un bonjour en passant, si rapide qu’il confine à l’au revoir.
Si on vous connaît plus particulièrement pour vos romans où, parfaitement à l’aise avec dates, repères, usages, étiquettes, noms de familles et petits noms, décors et lieux, vous déroulez le quotidien de vos héroïnes dans un Paris d’antan, dans un Lyon du bord de fleuve, dans un Potager du Roy enchanteur et perdu, vous surprenez ensuite les lecteurs par vos livres et vos essais plus personnels. Dans Souvenirs de la marée basse, un récit intime curieusement fragmenté, vous racontez une enfance, la vôtre, un père et une mère, une meilleure amie. Tout est doux, cruel, tendu, tendre. Sensitif, entre bleu turquoise de l’eau et bleu plus léger du ciel. Bleus, ciel et mer, mer et mère. Vous reprenez ce même fil – rouge dans le bleu – avec De Sable et de Neige, admirable possibilité d’un désastre. Vous passez de Colette à Pontalis, de Barthes (encore et toujours) à Tanizaki, de Sardanapale à Madame Du Deffand, de Delacroix à Proust, des huitres d’Arcachon aux huitres de Kyoto, toutes nues dans des pots transparents. Votre mère est là, votre mère à laquelle vous revenez d’une manière ou d’une autre dans chacun de vos livres, et votre père aussi, qui se meurt trop jeune un 2 janvier de vos seize ans, et nous fait pleurer de votre chagrin, tant vous nous tenez près de vous par le cœur et l’esprit. Ce père mort de silence comme on meurt de solitude ou de faim, père de l’écrivaine que vous êtes devenue – toutes ces photos de la petite fille que vous étiez, de la beauté qui vous entourait, celle de la nature et celle de vos parents, par laquelle les mots vivent, jalonnent et ponctuent les chapitres de vos Traits et Portraits.
Je nageais dans la Méditerranée lorsque j’ai pensé à vous. A vous, qui vous êtes autorisée la première personne avec vos derniers livres – intime enfin légitimé et partagé. Je pensais que, vagabonde adoucie, sensuelle et cérébrale, votre étreinte littéraire s’est faite joyeuse, lumineuse. Transparente comme certaines eaux. J’ai aussi pensé que tout ce qui est conventionnel, n’est pas vous. La passion vous habite comme on nage, comme on respire. Et comme on écrit, bien sûr. Une utopie.
Mais c’est cela qui nous anime, n’est-ce pas ? C’est cela qui nous fait glisser dans les vagues les yeux ouverts, même si ça pique comme des larmes, même si le sel mange la peau.
Merci pour tout cela, chère, très chère, Chantal Thomas.
Simonetta Greggio, romancière est membre de la commission de l’écrit de la Scam.
Elle surplombe la Seine depuis des siècles, telle une vieille dame. Alors qu’elle est plutôt moderne, porte les valeurs piliers de notre République pour en précéder souvent les évolutions, cette image conservatrice lui colle à la peau. Jeune académicien, tout juste élu, bientôt reçu, Pascal Ory nous dresse le portrait de cette grande dame.
« Peux-tu me faire le portrait de Madame L’Académie ? », m’a chuchoté une camarade de la Scam à qui je ne peux rien refuser, « il paraît que tu la connais bien ». Bon, c’est là que ça se complique car on ne peut pas dire que je sois encore dans sa familiarité, a fortiori dans son intimité. Celui qui aurait pu vous en dire beaucoup plus s’appelle René de Obaldia et il vient de nous quitter à l’âge de cent trois ans, toujours vif et joyeux. Moi, je suis un novice, n’ayant encore franchi que la première étape du cursus d’entrée, qui en compte quatre : l’élection, l’installation, la remise de l’épée et, pour finir, la fameuse réception sous la Coupole -qui, en ce qui me concerne, attendra encore le 20 octobre-. Premier constat : la familiarité de Madame L’Académie, ça se mérite.
L’élection elle-même n’est que le résultat d’un protocole issu en ligne droite du XVIIème siècle. Elle commence en effet par l’envoi d’une lettre de candidature manuscrite à chacun des électeurs et se poursuit par une série de visites à celles et ceux d’entre eux qui, en retour, le souhaitent. Madame l’Académie n’est pas conservatrice dans l’âme, contrairement à ce que certains pensent, mais elle est un conservatoire. Et comme c’est un conservatoire de l’ancien régime culturel, ses règles sont essentiellement coutumières, en vertu du principe « À Rome, fais comme font les Romains ». Dans un pays qui s’appelle la France et qu’on reconnaît universellement comme un vieux pays d’État, un vieux pays d’administration, pour ne pas dire un vieux pays d’autorité, l’Académie française se fait remarquer par un trait saisissant : les textes organiques qui président à son fonctionnement sont réduits à la portion congrue. Cette institution éminemment française est un exemple achevé de ce que la culture britannique a inventé à l’époque où la France inventait ses académies : un club. Et l’on connaît les trois qualités qui, depuis les origines, doivent définir un club : liberté, égalité, fraternité.
Madame l’Académie n’est pas conservatrice dans l’âme, contrairement à ce que certains pensent, mais elle est un conservatoire
Pascal Ory
Voilà qui pourrait surprendre, mais qui se vérifiait déjà au Siècle des Lumières, où le secrétaire perpétuel de l’Académie n’était autre que D’Alembert, autrement dit le grand organisateur de l’Encyclopédie et du « parti encyclopédiste », mais voilà surtout qui se vérifie sur la longue durée, dès lors que l’on compare l’histoire de la Française à l’histoire standard des autres institutions françaises. L’égalité en est la qualité la plus évidente. Elle se manifeste de multiples façons -par exemple dans la brièveté et la circularité des fonctions de directeur et de chancelier, bien différentes de celles qui régnaient sous la monarchie absolue, mais jamais mieux que dans les trois mécanismes révolutionnaires qui, depuis le premier jour, assoient le système : l’élection des nouveaux membres, l’égalité entre les électeurs et le vote à bulletins secrets. Pour ne prendre que le domaine politique il faudra dans ce pays attendre 1913 pour que ces trois conditions soient enfin réunies. On objectera qu’il s’agit là d’une égalité entre pairs, au sein d’une société sélectionnée. Assurément, mais on vient de définir là deux procédures qui régissent toujours aujourd’hui de multiples lieux de notre démocratie : la cooptation et le concours.
La liberté peut susciter des objections analogues, à considérer la tutelle initiale sous l’égide d’un « protecteur » (Richelieu, puis le Roi) ou encore les deux moments où le pouvoir d’État a nommé directement une partie de ses membres (sous la Révolution, en 1795) ou en a franchement épuré une autre (sous la Restauration, en 1815). Sauf qu’il en est de cette liberté comme de toutes les autres, proclamées en 1789 : elle se prouve en marchant mais son horizon toujours recule. La tutelle du Protecteur est devenue toute formelle -une visite de politesse du nouvel élu au président de la république- et la dernière intervention, toute indirecte, du pouvoir exécutif dans une décision de l’Académie a été des plus ténues puisqu’il s’est agi, de la part du général De Gaulle, d’une dispense de ladite visite quand, fin 1968, l’Académie a élu en son sein (elle s’y était refusée dix ans plus tôt) Paul Morand, dont le général se rappelait opportunément qu’il avait été ambassadeur du régime de Vichy. Quant à l’épuration qui en 1945 frappera quatre de ses membres -deux remplacés de leur vivant, deux seulement après leur mort-, elle n’entre pas dans ce cadre et confirme, a contrario, la liberté académique puisque c’est la compagnie qui prit cette décision. Au reste, en dehors de ce cas extrême, elle n’envisagea aucune mesure de ce genre à l’occasion de la demi-douzaine de changements de régime que ce pays, gros consommateur de constitutions, a opéré entre 1830 et 1958. S’il n’entre pas dans les traditions académiques de brandir l’étendard de la révolte sa chronique, de Napoléon 1er à Philippe Pétain, est remplie d’épisodes au cours desquels elle a marqué ses distances avec le gouvernement, allant même jusqu’à réélire en son sein certains des épurés de 1815.
Et la fraternité, dira-t-on ? Elle reste aujourd’hui encore, en tous lieux, le principe le plus difficile à définir, et par là à respecter. Pour simplifier on peut dire que l’Académie est à l’aune de toutes les sociétés humaines : animée périodiquement par quelques querelles d’égo et structurée épisodiquement par des effets de réseaux. En tous les cas le signataire de ces lignes peut témoigner de ce que les réseaux que certains esprits paranoïaques s’échinent à supposer, vus de près, ne fonctionnent guère, face au fort sentiment d’autonomie qui anime chacun des membres, et ce d’autant plus qu’on oublie souvent une originalité de la Française par rapport à ses quatre sœurs de l’Institut de France (les Beaux-arts, les Inscriptions et Belles-lettres, les Sciences et les Sciences morales et politiques) : qu’elle est la seule académie généraliste, ce qui a pour conséquence immédiate l’impossibilité pour un parti -religieux ou politique, genré ou disciplinaire- de prendre le contrôle de l’institution. Comme toute démocratie parlementaire qui se respecte l’Académie fonctionne à la coalition : cela en fait, là aussi, une exception en France, pays qui, seul de toute l’Europe occidentale, vit aujourd’hui sous le régime de la monarchie (depuis la constitution de 1958) et de la bipolarité (l’élection du président de la République au suffrage universel, en 1965).
La manière dont la Française a élargi sa fraternité en sororité, à partir de l’élection de Marguerite Yourcenar, en 1980, résume assez bien son mode de fonctionnement. Madame L’Académie est une femme depuis le début mais elle n’a admis les femmes en son sein qu’à la fin du XXème siècle. Elle n’a pas à en être fière -même si, dès son premier siècle, la rumeur (qui n’était pas encore le buzz) chuchotait qu’en élisant Monsieur de Scudéry elle élisait sa sœur, qui avait écrit à sa place la totalité des romans qu’on lui attribuait- mais l’État français non plus qui, sous sa forme pourtant républicaine, aura attendu 1944 pour accorder aux femmes le droit de vote et l’éligibilité. Et, après tout, l’Académie a élu pour la première fois une femme à sa tête, en tant que « secrétaire perpétuel » (et non « perpétuelle », suivant le vœu de sa titulaire) dès 1999, en la personne d’Hélène Carrère d’Encausse, alors qu’on attend toujours dans ce pays la première femme chef d’État.
Madame L’Académie est sérieuse comme le plaisir ; elle prend aussi plaisir à être sérieuse
Pascal Ory
Toute institution se fonde, se perpétue et se transforme à grand renfort de symboles. Haut-lieu du symbolique, Madame l’Académie définit bien comment elle conçoit ses trois valeurs au quotidien, dans la façon qu’elle a eu de gérer la symbolique de l’épée. Celle-ci est, là aussi, une pure tradition. Aucun texte n’oblige un académicien à en porter. Quand Marguerite Yourcenar fut élue, le corps électoral masculin, sans doute étonné de son audace, n’osa pas lui demander si elle souhaitait arborer une épée, anticipant sur une réponse courroucée, supposément féministe. La seconde femme élue, l’helléniste Jacqueline de Romilly, constatant cette absence, n’osa pas en demander une -et en fut récompensée en recevant de ses amis un sac à main brodé : on appréciera la saveur féministe de ce choix-. Elle le regrettera explicitement quand la troisième femme élue, Hélène Carrère d’Encausse, n’hésitant pas une seconde, demanda une épée, en vertu, justement, du principe d’égalité. Depuis lors chaque consœur s’est ingéniée à varier les plaisirs. Assia Djébar a choisi un sabre oriental, Barbara Cassin une épée post-moderne, non létale et hautement électronique. Chantal Thomas, qui vient d’être reçue en juin -la dernière avant moi-, a opté pour un éventail, acheté à Kyoto. L’examen minutieux des symboles choisis par chaque académicien dirait beaucoup sur une époque, comme sur les personnalités qui l’illustrent. Pour qui serait tenté de traiter ces affaires à la légère rappelons seulement ici que sur l’épée de Simone Veil figurait le matricule tatoué sur son bras à Auschwitz.
Madame L’Académie est sérieuse comme le plaisir ; elle prend aussi plaisir à être sérieuse. Mais elle sait, surtout, que si la vie est plus riche avec l’écriture elle est très pauvre sans valeurs.
Pascal Ory
Historien des mentalités, des mouvements culturels et de l’identité nationale, auteur, Pascal Ory a été élu à l’Académie française au fauteuil numéro 32, le 4 mars 2021.
Cap sur La Rochelle pour célébrer les 35 ans du marché international du documentaire ! L’occasion pour les auteurs et les autrices de la Scam de faire le point sur l’actualité du secteur audiovisuel. Avec deux temps forts cette année, la publication du premier baromètre des relations auteurices/producteurices et le palmarès des Étoiles de la Scam 2024. #SSD24
En présence de Rémi Lainé, réalisateur et président de la Scam,
Hervé Rony, directeur général,
Ruth Zylberman, documentariste et écrivaine, présidente du jury des Étoiles 2024
La conférence de presse sera suivie de la présentation du collectif : NousRéalisatricesDoc, par les réalisatrices Karine Dusfour, Virginie Linhart et Hélène Lam Trong.
200 réalisatrices de documentaires tous styles et toutes générations confondues, se fédèrent et s’engagent en faveur de la création du collectif « NousRéalisatricesDoc » pour :
– porter les enjeux de parité, d’égalité des chances et d’accès aux mêmes budgets, sujets, cases et horaires que nos collègues réalisateurs de docs
– prévenir le sexisme et les violences sexuelles dans le milieu du documentaire
– demander au CNC que le bonus parité mis en place dans la fiction soit étendu au documentaire
– signer avec France Télévisions un quota 50/50 dans le domaine du documentaire tel que la présidente Delphine Ernotte l’a signé dans la fiction
Dans un monde en perte de repères, le documentaire est plus que jamais un genre d’utilité publique dont nous voulons continuer à accompagner et anticiper les évolutions. Le secteur a vécu des bouleversements profonds au cours des trente-cinq dernières années qui touchent les métiers, les financements, la diffusion et les modes de consommation du documentaire. C’est pourquoi, à l’occasion de son 35e anniversaire, Sunny Side of the Doc propose à la communauté internationale de réfléchir au futur de notre écosystème ainsi qu’au futur du genre documentaire lui-même et de tenter de le dessiner ensemble.