Le prix Christophe de Ponfilly récompense les fondateurs du média en ligne Les Jours. Talentueux promoteur du concept de la série journalistique, le duo incarne depuis 9 ans un journalisme indépendant, engagé et inventif.

Journalistes à Libération pendant près de seize ans, Raphaël Garrigos et Isabelle Roberts démissionnent en 2015 pour fonder Les Jours, un média en ligne, indépendant, et sans publicité, dont il et elle deviennent respectivement directeur de la rédaction et présidente. Entouré d’une équipe de journalistes, le duo explore l’actualité sur le long cours, à travers des séries, leurs « Obsessions ».
En 2016, les « Garriberts » écrivent ensemble L’Empire, une série de plus de 200 épisodes sur la conquête de Canal+ par Vincent Bolloré. Un an plus tard, ils décryptent les différentes phases des élections présidentielles dans Les grands Primaires de droite, Les grands Primaires de gauche et Volte-face sur la campagne.
Ils sont les auteurs de L’Empire (Le Seuil, 2016) adapté de leur série, et La bonne Soupe (Les Arènes, 2007), consacré au JT de 13 heures de Jean-Pierre Pernaut.
Plusieurs enquêtes publiées par Les Jours ont été récompensées, dont le reportage Piège vert dans le paradis blanc de Lena Bjurström et Thomas Dévényi (Prix Louise-Weiss « Climat » 2023), À la poursuite de l’argent sale de Camille Polloni (Prix éthique Anticor 2019), les enquêtes d’Aurore Gorius sur les coulisses du pouvoir (Prix éthique Anticor 2020), ainsi que la série Les Revenants de David Thomson (Prix Albert Londres 2017).
Le jury 2025 était composé des membres de la commission des journalistes de la Scam : Patricio Arana, Walid Berrissoul, Didier Dahan, Jennifer Deschamps, Émilie Gillet, Éric Lagneau, Cédric Lang-Roth, Thierry Ledoux, Jean-Michel Mazerolle, Sophie Piard, Anne Poiret, Marie-Pierre Samitier, Nathalie Sapena, Isabelle Souquet et Violaine Vermot-Gaud.
Créé en 2014 à l’initiative de la commission journaliste de la Scam, le prix Christophe de Ponfilly couronne pour l’ensemble de son travail un ou une journaliste dont il salue le courage, le sens moral et la ténacité.
Il est doté de 8 000 €.
Contact : presse@scam.fr / 01 56 69 64 34
portrait pour la Lettre Astérisque
Portrait de Pascale Robert-Diard, Prix Christophe de Ponfilly 2024, pour l’ensemble de son œuvre.
La justice ne doit pas seulement être rendue, mais il doit être visible qu’elle est rendue.
Lord Chief Justice Hewart, Chambre des Lords, 1924
On dit d’elle qu’elle est « très Monde ». Là, au quotidien du soir, on l’appelle PRD. Pascale Robert-Diard est de ces rares journalistes qui n’ont jamais connu qu’une maison, lui ont tout donné, continuent de ne vouloir être nulle part ailleurs. Chroniqueuse judiciaire, ses papiers se lisent comme le roman de la France d’aujourd’hui, des hommes en cachemire qui grandissent dans les quartiers dorés à la jeunesse des campagnes qui vote Rassemblement National, de ceux qui volent des millions d’un simple clic à ceux qui lestent des valises pour noyer leurs cadavres. Elle vit son métier tel un voyage à travers la France, des plus belles salles du Palais aux atmosphères froissées d’ennui des tribunaux de la banlieue parisienne, des grands procès médiatiques auxquels les curieux se pressent comme au spectacle aux dizaines d’autres qui déroulent chaque jour, face aux bancs vides, l’ordinaire de l’humanité. Un voyage où le passé qui s’échappe éclaire le présent.
Pascale Robert-Diard est entrée dans la chronique judiciaire comme on entre dans les ordres. Une vocation. Arrivée stagiaire au Monde en 1986, elle profite quelques mois plus tard de la désertion de journalistes au procès de Klaus Barbie, le boucher de Lyon refusant de paraître devant les juges, pour trouver sa place sur les bancs aux côtés de son collègue, le maître de la chronique judiciaire, le prix Albert-Londres, Jean-Marc Théolleyre. Elle lui a dédié son chef d’oeuvre La déposition, l’autre histoire de l’affaire Agnès Le Roux, du nom de l’héritière du palais de la Méditerranée disparue en 1977 et dont le corps ne fut jamais retrouvé. Pascale Robert-Diard a su y mettre en lumière la relation entre l’accusé principal Maurice Agnelet et son fils Guillaume, clé de l’ultime rebondissement d’une bataille judiciaire de plus de 30 ans. De Théollèyre, elle a appris la nécessité du mot juste. De ses papiers, elle a vu naître un monde, celui de la loterie de la justice humaine, celui où aux prénoms des prévenus, on devine trop souvent la manière dont ils vont s’exprimer. Dans l’attente de reprendre le flambeau, la plume de Pascale Robert-Diard a raconté la politique, ses personnages, ses codes, ses coulisses, ses coups bas. Là, elle a pris conscience de la langue du pouvoir, une langue uniforme qui impose et s’impose. Plus tard, en entrant dans un tribunal, elle a entendu les fautes d’accord, les accents.
Le quotidien solitaire de Pascale Robert-Diard est la salle d’audience, ce théâtre où ceux qui n’ont jamais été écoutés sont invités à parler, peuvent dire et se dépasser. Là, assise seule, aux côtés de ses confrères ou au milieu des familles et de dizaines de spectateurs, elle tient son carnet où les mots tombent, ceux des accusés qui racontent l’inévitable lutte entre mensonge et vérité, ceux des parties civiles qui pleurent la douleur excessive, ceux des juges qui recherchent l’intime conviction. Elle restitue cette langue au plus près pour que la vérité des êtres, sa puissance et sa beauté franchissent les barrières érigées par le vécu, dépassent le cercle judiciaire pour parvenir jusqu’à la conscience du lecteur. Elle, qui regrette cette époque où, à coups de stories instagram, tout un chacun livre une intimité mise en scène, ne se lasse pas de celle dévoilée dans les procès. Une plongée dans les ombres des êtres, qui révèle l’indicible et reste sourde à nos constructions bien pensées, bien pensantes.
Il y a les mots des riches, ciselés, travaillés, pensés qui renvoient à leurs univers secrets, feutrés, fermés. Et il y a les mots des pauvres, les pauvres mots des pauvres gens, ceux qui ne sortent pas, ceux qui disent mal, qui trébuchent et vacillent. Les pauvres dont Pascale Robert-Diard sait qu’au fond, ce sont eux que la société juge vraiment, eux dont les journalistes piétinent parfois la vie. Eux dont la justice ordinaire et extraordinaire nous donne à voir la vie qui se débat, la vie qui s’épuise, la vie qui bascule. Dans ses chroniques, il y a cette vie qui souffle et avec laquelle on juge, des lignes et des lignes de dialogues, d’hésitations qui font sentir l’incompréhension, la domination, parfois le mépris de la langue judiciaire vis-à-vis de ceux qui ne la maîtrisent pas. Il y a les mots qu’elle retient et il y a les gestes qu’elle saisit, son regard accroché aux corps qui se lisent et trahissent. Une main qui retient la barre, des yeux qui se perdent dans le vide, un dos qui se voûte, un torse qui plastronne, un sourire qui toise, les yeux qui affrontent, jugent, se dérobent, s’évitent, s’embrasent, embrassent.
La justice a ses codes, ses techniques, ses rapports de force. Un cérémonial que Pascale Robert-Diard connaît finement, parfaitement. Dans cet univers réglé, réglementé, ritualisé, elle a conscience d’être au balcon du crime, de vivre le frisson par procuration et ne cesse de s’interroger sur cette place, sa place qui la voit écouter, regarder, scruter en surplomb la violence. Son intelligence à traduire la vérité des prétoires, leurs artifices et leurs parties d’échecs, sa plume précise et tranchante qui n’oublie jamais les détails et les nuances suscitent l’admiration de tous, lecteurs, journalistes, avocats et magistrats. D’elle, ces derniers redoutent le regard critique sur leur exercice du pouvoir dans un univers où la sanction disciplinaire reste rare.
Elle a fait siennes deux leçons des procès qu’elle a couverts : il faut toujours chercher à comprendre et comprendre que tout ne s‘explique pas. Elle cite aussi Simenon pour qui il faudrait comprendre et ne pas juger. Il y a eu les procès emblématiques, les politico-financiers, ELF, Clearstream, Bygmalion, le Carlton et France Télécom en correctionnelle, ceux d’assises, l’appel d’Outreau, Zyed et Bouna, l’attentat contre Charlie Hebdo, le 13 novembre…. Et tous les autres. Un chômeur serial killer de DRH, un couple surendetté qui tue un de ses enfants, un policier assassiné par la mafia, une influenceuse jugée pour apologie du terrorisme, la folie meurtrière de celui qui croit un trésor imaginaire volé… Des dizaines d’histoires qui disent, elles aussi, la France. Et il y a la première, celle d’une mère infanticide, une jeune femme arrivée d’Algérie à 20 ans, tombée enceinte d’un homme qui l’abandonne. Vingt ans plus tard, les larmes glissent dans les yeux, la mémoire tenace retrouve les mots venus heurter la barre qui séparait le juge et le père de la jeune femme, les mains agrippées à sa honte tandis qu’il roulait nerveusement son bonnet :
– Etes-vous son père ?
– Avant oui, maintenant non.
Un doigt d’honneur de trop un matin fâché, une femme étranglée parce qu’elle voulait aimer, une prostituée qui veut reprendre sa liberté, crimes utilitaires ou passionnels, Pascale Robert-Diard lit dans chaque procès d’assises une histoire de détresse. Deux détresses face à face, celle des accusés, celle des parties civiles, que l’audience peut amener à se regarder et s’écouter à défaut de s’entendre, s’entendre à défaut de se comprendre. Elle ne cesse de questionner le mensonge, d’interroger ses mécaniques, se dit bouleversée par le petit mensonge utilitaire initial. Celui qui est à l’origine de son unique roman La petite menteuse, forme littéraire qu’elle s’est imposée pour raconter ce qu’elle ne pouvait dire autrement.
Pour elle, une justice bien rendue doit apaiser. Aussi, elle ne peut réfréner ce goût âpre qui mêle tristesse et colère lorsque, impuissante, elle assiste à ces procès pressés, où les juges refusent de se laisser surprendre, de penser contre eux-mêmes et contre l’air du temps, où leurs conclusions faites de la lecture du dossier d’instruction ont déjà tout emporté, empêchant le silence de s’installer. Ce silence dont elle dit qu’il est le vrai grand maître de l’audience avec ses épaisseurs qui disent l’insondable.
Pascale Robert-Diard a longtemps pensé que lorsqu’elle se saisissait de son carnet pour une nouvelle audience, elle partait voir la vérité. Elle sait désormais que c’est sa reconstruction qu’(elle) regarde.
Jennifer Deschamps est journaliste, réalisatrice et productrice. En 2005, elle signe Dieu est mort au Rwanda puis se spécialise dans le journalisme d’investigation. En 2018, elle produit et réalise Inside Lehman Brothers (Arte, Étoile de la Scam 2019, sélections Doc NYC 2018 et HotDocs 2019). En 2020, elle produit La Démocratie du dollar (Arte). En 2023, elle signe pour Arte la série documentaire Les poisons de Poutine (sélection HotDocs 2023) puis travaille comme productrice artistique sur la série Outreau, un cauchemar français (Netflix, 2024).
Tout cinéaste documentariste s’engage dans les troubles du réel et c’est aussi un chemin que chacun et chacune emprunte afin de raconter et de témoigner ce qui fait présence, incarnation et trace. Avec Simone Bitton, cet engagement se noue, depuis ses débuts, dans les plis politiques, et donc intimes, des territoires qui nous habitent, aussi déchirants soient-ils. Portrait de Simone Bitton, Prix Charles Brabant 2024, pour l’ensemble de son œuvre.
Être une femme juive, arabe, occidentale, mais aussi française, marocaine et israélienne, qu’est-ce que ces plis et replis ? Une trinité enlacée dans l’histoire contemporaine du colonialisme comme des guerres d’indépendance. De cette filiation quasi cristallisante, la cinéaste en fera sa matière qu’elle ne cessera de malaxer, dans un travail rigoureux de mémorialiste, où le dialogue, comme le questionnement, est au service d’un engagement inaliénable contre toute forme de domination.
Et dès lors, comment renouer ce que le temps de la guerre ne cesse de dénouer ? Ce récit est connu, il remonte même au mythe ravageur d’Abel et Caïn, ce fratricide qui, depuis plus de soixante quinze ans, hante et lacère nos consciences. Et c’est parce que la cinéaste n’a jamais cessé de raconter ces récits de corps et de territoires, tant personnels que géopolitiques, qu’il faut remonter aux origines, comme on tisserait une cartographie du cœur, pour tracer un chemin unique d’existentialisme en cinéma.
1955 est une année cruciale pour le Maroc, c’est aussi la naissance à Rabat de la jeune Simone Bitton, fille d’un bijoutier juif marocain. L’expérience coloniale est inscrite dans l’apprentissage dès langues, car si l’arabe est sa langue maternelle, le français est celle du savoir et du pouvoir. C’est ce « butin de guerre » que tout colonisé connaît, la maîtrise de la langue de l’occupant.
Le 2 octobre 1955 marque les débuts de la guerre contre la colonisation française, jusqu’à la proclamation de l’indépendance du pays en mars 1956, mettant fin à quarante quatre ans de protectorat français. Une autre guerre se jouait déjà, celle qui débuta après la création d’Israël en mai 1948. D’une présence multimillénaire au Maroc, la communauté juive, doublement marquée par ces deux ruptures historiques, va quasiment disparaître en quelques années. En 1948, les Juifs marocains représentaient la plus grande communauté juive du monde arabe et musulman avec près de 265 000 personnes. En 2024, ils sont moins de 800.
C’est ainsi que la jeune Simone, à peine âgée de onze ans, devra quitter son pays natal pour Israël. Nous sommes en 1966, quelques mois avant la Guerre des Six jours. Comment imaginer cette adolescence pour une jeune fille qui doit apprendre une nouvelle langue dans un nouveau pays, où le sionisme, comme les réalités du colonialisme, représente sa vie quotidienne ?
Il y a une ironie de l’histoire dans ce dédoublement de la guerre coloniale qu’aura vécu, à son corps défendant, la jeune fille. Toute assignation identitaire relève du monstrueux et c’est hélas dans l’expérience indicible de la guerre que Simone Bitton la vivra. Comme toute citoyenne israélienne, la guerre est un vécu du présent, une obligation morale quasi phénoménologique. En 1973, à dix huit ans, elle se retrouve dans l’armée lors de la guerre du Kippour – nommée aussi Guerre du Ramadan. Elle vit de trop près la mort de ses camarades, non loin du canal de Suez. Traumatisée, elle sera démobilisée. Ce sera sa première guerre israélo-arabe. Un tournant décisif et radical s’opère en elle. Elle quitte Israël pour vivre bohème en Europe, avant de venir s’installer en France, à Paris.
Elle a vingt ans. La capitale française n’a jamais cessé de recueillir les exilés qui y trouvent une terre d’accueil, dans cette ville du cinéma par excellence. Dans la carte du monde, le cinéma est un pays en soi, un espace qui, à cette époque post révolutionnaire, créait des nouvelles formes de langages, comme autant d’espaces de recherche. En France, des collectifs de cinéastes se créent, tels Dziga Vertov (Jean Luc Godard et Jean Pierre Gorin, 1971), Le Grain de Sable (Jean-Michel Carré, Serge Poljinsky, Yann Le Masson, 1974) ou encore Slon, Iskra et le Groupe Medvedkine, avec entre autres Juliet Berto, Bruno Muel, René Vautier, Mohamed Zinet, Inger Servolin et Chris Marker. Entre l’université de Vincennes et les salles de cinéma parisiennes, son apprentissage la plonge au cœur des récits du monde entier, notamment d’Afrique, d’Amérique latine et du monde arabe. Nourrie par cette effervescence culturelle et politique, elle a aussi été directement touchée par une autre révolution en marche, celle des femmes à la caméra, que ce soit Marguerite Duras, Nelly Kaplan, et surtout Chantal Akerman. Dans un entretien paru dans la revue 24 Images (novembre 2004), elle témoigne de l’importance fondatrice de la cinéaste :
Les premiers films d’Akerman ont réellement changé ma vie, je lui serai toujours reconnaissante d’exister, d’avoir eu le courage un peu insensé, peut-être inconscient, de dire : voici ce qu’une femme peut faire. Et une femme, vous savez, pour exister doit être meilleure que les hommes, sinon c’est perdu d’avance. Elle était meilleure que les hommes. Surtout au cadre. Elle a révolutionné le cadre et le temps. Aujourd’hui encore, je ne peux pas faire un plan-séquence sans penser à elle !
Elle poursuit sa formation en intégrant l’Institut des Hautes Études Cinématographiques (IDHEC ex FEMIS). Alors que le cinéma documentaire propose un contre modèle face au cinéma de divertissement dominant, le monde occidental, impérial et impérieux dans le commerce des images, reste mutique face à ses responsabilités, notamment ses histoires coloniales. Les blancs de l’histoire persistent, entre amnésie, déni et manipulation. Parce qu’elle porte en elle une trinité déchirante, elle deviendra la première cinéaste à raconter l’histoire de la Palestine. Avant elle, aucune archive palestinienne n’avait été montrée aux citoyens français. De fait, toute histoire tue deviendra sa matière à filmer, pour documenter le réel oblitéré par les récits dominants, qu’ils soient du pouvoir français, marocain ou israélien. Lorsqu’elle réalise ses premiers films, le cinéma documentaire est quasiment absent des salles de cinéma. Hormis quelques festivals, les documentaires ont pour seule visibilité la télévision publique.
Au début des années 80, avant la privatisation accélérée des médias par des industriels milliardaires, elle s’engage totalement au service de la télévision publique, avec l’Institut National Audiovisuel. Dans la continuité d’autres cinéastes tels que Sarah Maldoror, Robert Kramer, qui partagent avec elle l’expérience de l’exil comme du combat pour la dignité humaine, elle ne cessera d’arpenter les mémoires vivantes qui traversent la région du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord. Elle réalisera pas moins d’une douzaine de films documentaires : des portraits (Nissim et Chérie, La vie devant elles, Nos mères de Méditerranée, Citizen Bishara) une biographie politique (Ben Barka, l’équation marocaine) l’enquête (L’attentat, Rachel) des chroniques courtes sur la vie quotidienne à Ramallah (Ramallah daily) des dialogues filmés (Elias Sanbar et Serge Daney, Mahmoud Darwish) des portraits d’artistes du monde arabe (Les grandes voix de la chanson arabe).
Ces portraits intimistes de femmes, de couples, d’écrivains et d’hommes politiques s’inscrivent dans les mémoires des immigrations et d’exils, mais aussi dans le combat anticolonial. Son travail est exemplaire, où l’exigence dans la recherche historique va de pair avec le souci, chevillé au corps, de nouer un dialogue entre celles et ceux qu’elle filme et elle-même. Et surtout avec la communauté humaine à qui le film, toujours, est adressé, ce tiers inclus dès le processus de création.
Ce tiers, c’est aussi elle, dans les interstices du film, une citoyenneté inquiète et vigilante qui veut saisir ce réel assourdissant. Chacun de ses films est cette expérience de l’altérité en question et en souffrance, la sienne bien sûr, mais surtout de tout le monde. Elle crée ce cadre où se dépose des traces de vie en suspens, des vies borderline, lorsque ce ne sont pas tout simplement des disparus… Chacun est accueilli dans son cinéma, elle archive ce qui se dépose, silences comme larmes, poèmes comme colères, et peut-être aussi, parfois elle console. Elle est cette éclaireuse du langage pluriel, pour qui la parole a une fonction quasi thérapeutique, cette suture des mots qui manifeste une présence, un corps, même dans ses brisures et murmures, afin de raccorder ce que le social détruit. Que ce soit avec le poète exilé Mahmoud Darwish (Mahmoud Darwich : et la terre comme langue, 1997) avec l’essayiste Elias Senbar qui dialogue en fraternité territoriale avec le critique de cinéma Serge Daney (Conversation Nord-Sud, Daney/Sanbar, 1993) ou avec le philosophe palestinien et député au parlement israélien, Azmi Bishara, (Citizen Bishara, 2001). Le dialogue suppose une écoute, comme un désir partagé de créer un tiers lieu dans lequel chacun peut déployer les possibilités de penser/panser le monde.
Juive arabe européenne, marocaine, israélienne, française. Une réalité existentielle qui façonne son destin de cinéaste. Et, dans une évidence quasi originelle, elle devient la première réalisatrice française à prendre à bras le corps l’histoire de la colonisation palestinienne. Trois années de recherche et de travail sur les archives pour la réalisation d’une série de deux films, Palestine, Une histoire de terre, avec comme directeur de collection Jean Michel Meurice (1993). Nul ne peut échapper à la terre surtout celle qui se vit dans la guerre, et comme Rithy Panh mémorialiste du génocide cambodgien, Simone Bitton ne cessera de revenir en Israël comme en Palestine pour filmer ce qui ne fera qu’empirer. Dès 1983, soit dix ans après sa fuite de la guerre du Kippour, elle retourne en Israël pour filmer ce voyage si particulier, ce sera La réunion d’entre deux guerres.
Après son grand film documentaire d’archives sur l’histoire de Palestine, ce sera la guerre qui sans cesse la fera revenir. Le 4 septembre 1997, trois jeunes Palestiniens se sont fait sauter dans une rue piétonne de Jérusalem, causant la mort de cinq civils israéliens dont trois adolescentes. L’une d’elles était la petite-fille d’un célèbre pacifiste israélien, Mati Peled. Elle se souvient
Je n’étais pas en Israël à ce moment-là, j’étais à Paris. Mais je suis arrivée très vite, et je me suis rendue à l’enterrement de Smadar, la petite-fille de Mati Peled, avec des amis palestiniens de Ramallah qui ont bravé le bouclage des territoires pour déposer une fleur sur sa tombe. J’ai connu Mati Peled, en son temps j’avais soutenu la liste progressiste pour la paix, le parti politique israélo- palestinien dont il avait été député. J’étais particulièrement bouleversée par la tragédie qui s’abattait sur cette famille. Je n’avais pas de caméra ce jour-là et je ne pensais absolument pas faire un film, mais il est certain que la motivation profonde est venue de l’émotion très forte que j’ai ressentie à cet enterrement. Le film s’est fait entièrement avec les familles des victimes israéliennes et les familles des kamikazes. Mon idée était que ces gens qui avaient perdu un enfant – peut-être pas le lendemain mais quelques mois après – sauraient peut-être mieux exprimer la guerre et la paix que d’autres.
Ce sera L’Attentat (1998) qui sera primé dans de nombreux festivals.
Une rencontre fut décisive dans sa vie pour son passage au cinéma, ce fut avec le producteur Thierry Le Nouvel. Mais le basculement fut encore une fois une catastrophe politique. Il s’agit de la construction d’un mur, ordonnée par le gouvernement d’Ariel Sharon, entre Israël et la Cisjordanie. En 2002, Simone Bitton écoute aux informations le ministre de la défense israélien Binyamin Ben-Eliezer évoquer la possibilité de construire un mur de séparation. De ce réel quasi inimaginable, elle en fera une œuvre magistrale Le Mur, son premier film de cinéma sélectionné à Cannes en 2004 et primé dans de très nombreux festivals internationaux. Organique et abstrait, le film déroule une réalité implacable, la construction du mur, à chaque étape, qui enferme, emprisonne, sépare, éventre, érige, obstrue. Elle a choisi de filmer la matérialité même de ce mur qui s’érige comme une nouvelle espèce, totem politique délirant en béton de huit mètres de haut et de tronçons de barbelé et pourtant concret, bien là. Un sur-visible qui va jusqu’à engloutir l’écran.
Si les pouvoirs politiques ne cessent de trahir les peuples, le cinéma demeure le seul espace temps qui recueille l’indicible comme l’inaudible. La banalité du mal n’est pas tant celle du régime des images qui voit ses possibilités de langage se rétrécir, au détriment de l’imposition d’un récit unilatéral qui ne cesse de falsifier le réel, et ce par les plus hautes instances. Que peut le cinéma face à cette guerre de destruction en cours depuis plus de onze mois ? Tout, et il est évident que le cinéma documentaire relève d’une éthique du réel, et non de la manipulation telle qu’elle se déploie avec une rare férocité depuis la fascisation des sociétés occidentales. Le temps du cinéma relève du temps humain, plus encore avec Simone Bitton qui vient avec sa caméra ausculter et enregistrer ce que le discours officiel efface.
Toute langue est la matrice d’une perte, et l’hybridation linguistique dans laquelle est plongée la cinéaste crée aussi une triple absence. Serait-ce cette mère allée ? L’éternité, ultime rêve du cinéma ? Sa quatrième langue est le montage, mon beau souci, selon l’adage godardien ( Les Cahiers du cinéma, 1965). Simone Bitton est aussi et surtout monteuse, naviguant entre ses langues et la multiplicité des outils de langage que le cinéma offre. Nul sacré dans son art si ce n’est celle de la présence humaine, aussi fragile soit-elle. Il n’est pas anodin de noter que sa première réalisation, un court métrage documentaire nominé aux Césars en 1983, Solange Giraud née Taché, revient sur le suicide d’une jeune coiffeuse de province. Le suicide, ce tabou qui hante la société moderne… Une anonyme que la jeune cinéaste qu’elle est permet d’exister. La tragédie intime féminine, c’est aussi retracer les chemins de l’exil au cœur de la méditerranée, cette matrice des mondes occidentaux et orientaux. Rendre visible et audible ce que le temps politique avale. Raconter autrui pour mieux se rapprocher de soi ? Dans ce geste rimbaldien, la cinéaste est allée à la rencontre de Christiane l’Italienne, Norma la Palestinienne, Jacqueline la Juive algérienne et Nadira la Kabyle (Nos mères de Méditerranée, 1982). Lorsqu’en 1986 elle réalise La vie devant elles, documentaire sur la jeunesse, elle remonte le fil des filiations et des mémoires des immigrations françaises, invisibilisées dans le roman national. Trois ans après la Marche pour l’Égalité et contre le Racisme, le cinéma français est encore frileux à raconter son histoire des immigrations, constitutive de son roman national. Le thé au harem d’Archimède de Mehdi Charef (1985) fera hélas exception durant de trop nombreuses années. C’est dire combien la cinéaste documentariste était d’une vigilance aiguisée sur tout ce qui relevait des tremblements, mémoires et blessures identitaires. Ce titre volontairement optimiste, clin d’œil à Romain Gary, restera peut-être son unique titre le plus ouvert aux espérances.
En effet, plus de vingt ans plus tard, en 2008, ce sera Rachel, son deuxième long métrage de cinéma, qui revient sur la mort d’une jeune américaine, Rachel Corrie. Âgée de vingt trois ans, cette militante pour la paix a été écrasée le 16 juin 2003 par un bulldozer de l’armée israélienne, à Rafah dans la bande de Gaza, alors qu’elle tentait de s’opposer à la destruction de maisons palestiniennes. A cette mort atroce, autant niée par l’armée israélienne que la justice du pays, la cinéaste oppose toute la rigueur d’une enquête cinématographique.
Au cinéma, le résultat de l’enquête compte moins que le fait même d’enquêter. Il s’agit de filmer et d’observer des lieux, des gens, des objets ; de recueillir des paroles, des gestes et des silences. De faire jaillir l’émotion des matières les plus froides et les plus dures, comme les images d’une caméra de surveillance ou le métal lisse d’une table d’autopsie.
Cette exigence l’amène à montrer dès le générique les images du corps démembré de la jeune Rachel, alors que le film se révèle au fil du récit une ode à la jeunesse, où la poétique affleure par la voix off de Rachel et une écriture cinématographique mixte.
Qu’est-ce qui relie Oum Kalthoum, Mahmoud Darwish, Farid Al Atrache et Mohamed Abdelwahab. Simone Bitton certes, mais surtout le tarab, cette émotion artistique d’intensité maximale. Cet amour qui devient extase et communion des sens entre le spectateur et le créateur, où l’âme s’élève au firmament d’une ivresse esthétique, spirituelle. Cette langue arabe qui porte en elle la puissance de la mélancolie, entre incantation à l’absolue et puissance de la perte.
En 1990, elle réalise trois portraits des stars mythiques de la chanson arabe : Oum Kalsoum, Mohamed Abdelwahab et Farid Al Atrache, suivi six ans plus tard de Mahmoud Darwich : et la terre comme langue, 1997). Leurs mots chantés, scandés, c’est l’amour, el Hob, non romantique ni même romanesque. Il n’est que perte, arrachement, quête et déracinement ; mélancolie de l’ivresse déjà évanouie, extase en suspension, toujours inaccomplie, à jamais recherchée.
Cet amour morcelé, elle le retrouvera, presque intimement, lorsqu’elle s’autorise enfin à faire son propre pèlerinage cinématographique avec Ziyara son dernier film sorti en 2002. Si la mort a dès son premier court métrage marqué de son sceau tout son cinéma, avec ce vrai faux retour au pays natal, le Maroc, elle trace un chemin d’amour par la présence ténue des morts.
Tel un spectre, elle se filme, déambulant dans les cimetières, à la recherche de quelque chose qui n’existe presque plus. Des tombes juives entretenues manuellement et quotidiennement par des femmes et des hommes arabes, musulmans. Film le plus énigmatique de sa carrière, il n’en est pas moins le plus arrimé à la politique du corps, celui de la résistance à tout, au nom de l’amour. C’est entre les tombes, dans son errance intérieure, que la cinéaste nous offre son portrait le plus lucide et aussi le plus émouvant. Aucun pays ne nous appartient, la terre nous est légère, et nous n’avons perdu ce qui jamais de fait nous avait appartenu. C’est aussi une des énigmes que le film revisite, ce qu’opère en chacun de nous un retour à quelque chose qui n’existe plus et qui fait pourtant advenir quelque chose que l’on pensait oublié. Ne serait-ce pas là tout ce que le cinéma, dès ses origines, permet et offre à l’humanité, un espace-temps ?
Nadia Meflah est autrice, critique, programmatrice et formatrice cinéma. Elle est autrice d’un documentaire sur Oum Kalthoum, « La voix du Caire » (Arte, 2017) et du livre « Chaplin et les femmes » (éd. Philippe Rey).
Elle est aussi scénariste pour des cinéastes du Sud, (Maroc, Mauritanie, Burkina Faso) et engagée dans des programmes de formation cinéma en France et à l’international.
Elle est l’une des voix les plus singulières et les plus attachantes de la littérature contemporaine française. Loin de tout esprit de sérieux, elle montre à quel point la littérature engage, en secouant nos certitudes en même temps que nos désirs. Portrait de Lydie Salvayre, prix Marguerite Yourcenar 2024 pour l’ensemble de son œuvre.
Salvayre ne nous fait cadeau de rien tout en nous faisant don du monde, un cosmos murmurant de voix tour à tour acides et suaves, grouillant de reines et de bourreaux.
Simonetta Greggio
Il y a des choses mille fois pire que la férocité des brutes, c’est la férocité des lâches, écrit Lydie Salvayre dans Pas Pleurer, le roman qui a été distingué par le Prix Goncourt en 2014.
Depuis le début de son aventure littéraire, voire depuis le début de son aventure humaine, de toutes ses forces, Salvayre fait acte de résistance. Arjona de son vrai nom, ou plutôt, devrait-on dire, de ce nom paternel qu’elle a abjuré, l’écrivaine porte en elle le récit de ses ancêtres. Née en 1946 en France, elle est la fille d’un couple d’exilés espagnols. Enfant, elle fait trésor du fragnol – mélange de français et d’espagnol – langage à l’émail éblouissant parlé dans le cercle familial que l’on retrouve dans beaucoup de ses histoires, et qui leur donne une saveur à nulle autre pareille. Mais ce jargon magnifique n’est que la Stolpersteine[*], pierre d’achoppement, d’une langue sombre, fluide, intense – d’un verbe porté haut, vibrant de la folie des hommes et de leur course contre une mort annoncée mais jamais admise. Comme sur une route noire éclairée par une grande lune jaune, on avance en suivant son verbe rapide, coulant, surprenant. On se sent seuls, entourés d’ombres pas toujours rassurantes, et on ne sait jamais de quel côté ça va tomber, on ignore s’il s’agira d’un baiser ou d’un coup de couteau. Salvayre ne nous fait cadeau de rien tout en nous faisant don du monde, un cosmos murmurant de voix tour à tour acides et suaves, grouillant de reines et de bourreaux. Elle les porte dans son cœur, dans sa mémoire ancestrale, ses personnages ; ils étincellent dans ses yeux, parlent par ses lèvres qui se ferment parfois comme pour empêcher un gros mot de sortir. Mais ils sortent quand même ces gros mots, ces mots terribles qui sonnent comme des anathèmes, des jurons qui libèrent, de la même manière que Jung fut libéré de la peur du divin par son premier blasphème, celui où il voyait Dieu chier : me cago en Dios, hurlent les créatures de Salvayre. C’est permis, c’est même normal de maudire Dieu et sa clique céleste lorsque l’on tient ses morts sur ses épaules, lorsqu’éclate dans la poitrine l’exécution des ancêtres, leur mise au ban, les violences faites aux femmes et aux enfants, aux hommes aussi, dont les blessures, pour être différentes, n’en sont pas moins fatales, et relèvent du même pouvoir dévoyé. Et encore, non, peut-être que comme le disait une autre grande écrivaine, Elsa Morante, qui ressemble à Salvayre par l’inflexibilité, il n’y a pas de pouvoir dévoyé : le pouvoir EST violence.
Cette rage comme un cri lancé à l’Univers, cette impossibilité à la résignation parce que la résignation, c’est déjà l’acceptation, et qu’elle n’en veut pas, sourdent de partout dans les pages de l’écrivaine : comme l’eau qui sauve – comme l’eau qui noie.
[*] Stolpersteine, pavés de mémoire pour les victimes du nazisme, initiés par l’artiste Gunter Demnig.
Mon frère les regarda dans les yeux avec ce regard qu’il avait d’une douceur de fille, il les regarda dans les yeux en espérant qu’il arrêterait par la seule force de son regard l’enchaînement terrible des gestes que chez eux il pressentait. Mais c’est l’inverse qui advint. Les jumeaux Juel n’eurent plus qu’une idée, vaincre ce regard doux et droit comme une lance jusqu’à ce qu’il se brisât.
Comment faire quand la mort de l’être qu’on aime dure, et dure encore. Quand l’agonie ne cesse jamais, dans le vif d’un souvenir qui supplante le présent. Quand des hurlements vieux de trente ans vous réveillent la nuit en pleurs, trempé de sueur, bouche ouverte dans la peur atroce de ce que, vous le savez, sûrement viendra. Quand l’instant est procrastiné à l’instant d’après, puis encore au suivant, dans une éternité d’expiration. Les larmes qui vous dévastent, et l’impuissance, et la peine, et la déchirure, deviennent alors si fortes que votre existence se mue en cri de colère, en poing brandi vers le ciel. Les êtres chers ne devraient jamais mourir, surtout si les êtres chers sont victimes de grotesques nazillons secoués par des orgasmes de destruction – surtout si les êtres chers sont vos anges succombant aux cons, aux salopards, aux fachos. Cet instant qui dure, c’est l’instant du livre de Salvayre, de Pas Pleurer à La Compagnie des Spectres :
J2 s’agenouilla près du visage de ton oncle en faisant claquer le chien de son pistolet, puis il posa le canon sur sa tempe et lentement, amoureusement, il lui fit tourner la tête et
Et
Une étude récente établit que les personnes réceptives à l’humour noir ont un niveau d’étude élevé, des émotions stables et ne sont pas agressives. Ça fait du bien de le savoir. Ça rassure. De l’écholalie tragicomique à une ironie si cinglante qu’elle en devient mortelle, de la dérision à la raillerie, du persiflage au sarcasme, Salvayre joue en virtuose, se servant de ses mots au rasoir comme d’une arme de subversion. Plongés dans l’acide de son œuvre au noir, les pouvoirs – tous les pouvoirs – sortent calcinés. Le Général Putain est son meilleur antagoniste, qui les résume tous : les chefs de bande et leurs auxiliaires de mort ont beau écraser leurs bottes sur la tête de leurs victimes, les personnages de Salvayre leur trouvent des manières de bouffons. Le rire, ce rire dément qui se moque jusqu’au souffle ultime, est la dernière ressource du condamné, qui remarque chez son bourreau les détails les plus burlesques : un bout de persil coincé entre les dents, une haleine de baleine à bosse, une démarche de pingouin. Hitler était, dans sa sinistrose, un clown du désastre, Franco, un papi petomane, Mussolini, une baudruche satisfaite – et un idiot utile aux intérêts de son grand copain moustachu. Cette bande d’escrocs, cette racaille, Salvayre la dénonce en hurlant de rire. Leurs gesticulations, analysées par le scalpel désespéré de ses protagonistes, sont l’attestation de l’abêtissement des despotes. Il y a du snobisme dans le fait de tirer la langue à son tortionnaire. La supériorité de celui qui aura eu raison en fin de comptes, même mort. Surtout mort ?
On ne connaît pas de dictateur ayant le sens de l’humour. C’est antinomique. Ça ne les fait pas rigoler, les salauds, qu’on se foute de leur gueule jusqu’au bout. Et c’est notre ultime consolation. On sort vengés, le sourire au bec, de La Compagnie des Spectres, mais aussi, d’une certaine manière, de La Déclaration, du Petit traité d’éducation lubrique, de l’Irréfutable essai de successologie. Et même si l’ennemi est chaque fois déguisé sous un chapeau différent, on l’a bien reconnu, va, le bougre. Bien fait. Merci Lydie.
L’amour, l’amour ! vous en avez de bien bonnes, aussi ! L’amour, il fait ce qu’il peut dans les romans de Salvayre. Mais il est sauvé, et il sauve. Il se sauve, aussi. Envers et malgré tout, il se faufile partout comme une eau vive, chemine dans BW, où Salvayre parle de, à travers, au travers, de son compagnon de route, pas pour parler d’amour – de quoi parle-t ’on quand on parle d’amour ? – mais pour parler par l’amour. Ce qui, avouons-le, se tient bien mieux. C’est plus raisonnable, et même justifié. De quel tissu est fait ce sentiment ? De quelles ombres ? Quels secrets ? Nul ne le sait, hormis ceux qui en sont les porteurs. L’amour est là, donc, qui fait que les hommes et les femmes prennent des décisions, entreprennent des actions, suivent des chemins partagés. Et cet amor che move il sole e l’altre stelle, qui fait bouger le soleil et les étoiles, comme le dit Dante dans le dernier vers du Paradis de sa Divine Comédie, est le mécanisme du monde, la mécanique du Cosmos, et son but. Pas de vaines récriminations, ni de larmes servant de prétexte à un désengagement, à un découragement, à une lâcheté morale ou physique ; rien de tout cela. Chez Salvayre, on se remet debout, on sèche ses yeux, et on avance. Comme on peut. Comme on doit, probablement.
Ou comme on se doit.
Tous ceux que Salvayre admire sont pris dans une radicalité : mot auquel il faudrait restituer la force et la beauté violente que lui ont confisqué les nouveaux idiomes en l’associant au pire des extrémismes, au pire des fanatismes et au pire des terreurs.
Elle admire aussi la folie qui fait passer son œuvre – quelle qu’elle soit – avant tout le reste et lui sacrifie tout, au point d’en devenir dingue, au point d’en souffrir, au point d’en mourir : Rilke, Proust, Pascal, Nietzsche, Woolf, Van Gogh. Des élus corps et âmes tendus vers l’inatteignable, dans une rigueur, un dévouement, une ascèse par le travail qui devient sanctification. Nécessité impérieuse, voie solitaire et risquée, creusée d’ornières et qui ouvre sur l’inconnu.
Salvayre est radicale parce qu’elle refuse les tièdes compromis où d’autres s’égarent, et peut brûler de sa passion hasta la muerte ! Mais c’est hasta la vida qu’il faudrait dire en récapitulant son œuvre, vive la vie maintenant et toujours, vive la vie dans son flux le plus brûlant et le plus limpide, dans sa radicalité la plus dangereuse, car si notre passage sur Terre a un sens, il ne peut être que celui-là.
Jurée du prix Marguerite Yourcenar, Simonetta Greggio est membre de la commission de l’écrit de la Scam. Romancière italienne aux multiples talents, Chevalier des Arts et des Lettres, un temps journaliste pour City, Télérama, Magazine Littéraire, Figaro Madame, La Repubblica, Marie France, Signature, Senso, elle manie à merveille les mots et l’art de « fabriquer des histoires ».
Patrick Chamoiseau a reçu le prix Marguerite Yourcenar 2023 pour l’ensemble de son œuvre. Retour sur le parcours de ce témoin de l’histoire coloniale et fervent penseur de la créolité, un chemin façonné de livres et d’essais marqués par la magnificence des mots.
Toujours, les grandes œuvres s’éclaircissent rétrospectivement de l’accomplissement qu’elles atteignent à la maturité, lorsque l’évidence s’impose de les célébrer comme un tout : ce tout était agissant dès le départ, dans chaque fragment, chaque esquisse sans doute, mais il aura fallu un long cheminement pour le dégager du brouillard des origines.
Peu d’œuvres en témoignent aussi nettement que celle de Patrick Chamoiseau, portée par la nécessité d’ouvrir la littérature francophone à un imaginaire de la diversité dégagé des œillères que nous a léguées l’histoire, et tout particulièrement l’histoire coloniale. Non sans atteindre parfois à une forme d’urgence dans « la ferveur des indignations » (Frères migrants, 2017), c’est dès ses prémisses que cette œuvre s’est inscrite à rebours exactement des processus de sclérose identitaire qui ronge notre début de millénaire hérissé de murs et de barbelés pour mieux reléguer les uns et enfermer les autres dans le ressentiment de leurs propres peurs.
Par-delà la magnificence d’une langue à la richesse harmonique nouvelle, c’est bien ce qui frappe à relire les premiers livres de Patrick Chamoiseau, de Chronique des sept misères (1986) au magistral Texaco (1992), chatoyante épopée des splendeurs et misères du peuple antillais depuis la sortie de l’esclavage : le chemin parcouru était donc tout entier contenu dans les prémisses, s’il y demeurait indiscernable ; pour reprendre une expression de Franz Kafka, une « conclusion innée » conditionnait déjà les premiers livres, serait-ce à l’insu de leur auteur qui cherchait, précisément, à la définir.
Patrick Chamoiseau l’affirme à sa façon à l’orée du fascinant Le Conteur, la nuit et le panier (2021) qui remonte aux sources de la création en terres créoles : alors que tout artiste est voué à cheminer de manière singulière, son œuvre en devient « un cheminement vers la compréhension de l’art qui est le sien ». Les livres publiés sont autant de pierres blanches qui matérialisent a posteriori ce « cheminement dépourvu de chemin ». « Comme tout artiste, l’écrivain s’invente une voie qui n’aboutit jamais, une voix qui cherche toujours son chant. C’est ainsi qu’il demeure désirant », car il n’est pas d’autre carburant que le désir, quand bien même le maître-mot de l’œuvre tout entière, en l’occurrence, resterait l’émotion : car au commencement est l’émotion, qui par deux fois s’est confrontée à la barrière de l’expression au long d’une « enfance créole » bientôt formatée par l’école coloniale, sous la férule d’un maître « grand pourfendeur de sabir créole, négateur des fastes de la culture dominée », celle qu’incarnait « Gros-Lombric », le double ou « l’écolier marron » amenant des confins de l’en-ville des contes de zombis et autre « Chouval-trois-pattes », ainsi que le raconte Chemin-d’école (1994), deuxième volume de la trilogie Une enfance créole.
Chamoiseau racontait volontiers comment l’écriture de l’essai, destiné à restituer la trajectoire d’une conscience ayant eu à trancher le choix d’une langue d’écriture, a ouvert la voie pour libérer enfin, et d’un seul souffle, le roman.
Bertrand Leclair
Si le Maître voguant « immatériel sur les cimes du savoir universel » terrifiait le présent, la langue qu’il imposait n’en reste pas moins celle dans laquelle a pu opérer l’appel d’air de la littérature mondiale. Alors que l’œuvre de Chamoiseau s’est construite sur deux jambes, alternant essais et romans ou récits, on ne peut sur ce point que s’attarder sur la parution conjointe, en 1997, de L’Esclave vieil homme et le Molosse et de Écrire en pays dominé. Chamoiseau racontait volontiers, à l’époque, comment l’écriture de l’essai, destiné à restituer la trajectoire d’une conscience ayant eu à trancher le choix d’une langue d’écriture, a ouvert la voie pour libérer enfin, et d’un seul souffle, le roman, très ancien projet qui lui résistait depuis des années. L’essai lui avait permis de comprendre que l’élan vers la liberté de son vieil esclave était certes un élan vers la réhumanisation mais que ce qu’il devait retrouver, à s’enfoncer dans les bois, n’était pas une essence perdue : de fait, il y découvre la présence agissante des traces de l’imaginaire amérindien aussi bien que le souvenir confus des divinités africaines ou des représentations symboliques imposées par le maître à travers la plantation. L’esclave vieil homme ne peut se réaliser en tant qu’être humain que dans une « totalité du monde » qu’il porte en lui, traçant la voie au monde ouvert né de la créolité, celui de « la Relation », chère à Édouard Glissant (1928-2011), dont l’élaboration théorique a profondément marqué Patrick Chamoiseau, l’incitant à dépasser à son tour les cloisonnements et les clivages identitaires.
On voudrait, bien entendu, s’attarder également sur le monumental Biblique des derniers gestes (2002), sur le lumineux L’Empreinte à Crusoé (2012). En tant que membre du jury du prix Marguerite Yourcenar destiné à couronner l’ensemble d’une œuvre, cependant, on ne peut conclure qu’en se réjouissant d’avoir l’honneur de décerner ce prix à Patrick Chamoiseau au moment où, une fois de plus, un diptyque associant roman et essai confère une dimension nouvelle à l’ensemble de son œuvre.
À l’essai déjà cité Le Conteur, la nuit et le panier, paru en 2021, répond merveilleusement le chef d’œuvre qu’est Le Vent du nord dans les fougères glacées, paru à l’automne dernier, et qui joue à merveille, en sous-main, du vertige que nourrissent les découvertes de la physique quantique[1]. Là où l’essai remontait aux sources de la création en retraçant l’extraordinaire émergence des premiers « maîtres de la Parole » dans le secret des veillées mortuaires, au temps de la catastrophe esclavagiste, le roman précipite quelques habitants des mornes en quête du dernier des maîtres de la Parole dont l’absence, d’abord passée inaperçue, creuse l’espace d’un manque, dans leur quotidien anesthésié. Aucun d’entre eux ne saurait dire exactement depuis quand Boulianno ne se présente plus aux veillées mortuaires : ayant « dépassé vieux » sans que nul ne puisse faire le compte de ses années, il n’apporte plus « cette lumière qui vient de la Parole, seule grâce capable de soutenir la vie en face de la mortalité ! » Car tous se souviennent que, lorsqu’il se présentait pour « monter au tambour » et entrer dans une la-ronde à la nuit tombée, « la mort elle-même trouvait à qui parler. (…) Hélas ! un jour, Boulianno Nérélé Iksilaire – honneur sur sa naissance et respect sur son nom – cessa de répondre aux appels ».
Par poussées fulgurantes qui sont autant de surprises, la logique du texte qui se fait luxuriant semble dès lors creuser dans un inconnu indiscernable.
Bertrand Leclair
L’homme a disparu comme on s’efface, ou s’estompe, dans la modernité martiniquaise, sans avoir « déposé chez personne » « ce cœur-de-chauffe de la sagesse » désormais « serré au plus profond dans le silence de Boulianno ». Doutes et hypothèses lancent les plus fervents des enquêteurs à sa recherche sur les hauteurs inhabitées de Sainte-Marie, haut lieu du marronnage à l’époque de l’esclavage. Par poussées fulgurantes qui sont autant de surprises, la logique du texte qui se fait luxuriant semble dès lors creuser dans un inconnu indiscernable d’être situé non pas au dehors, mais à l’intérieur des enquêteurs, et par conséquent du lecteur – puisque le chemin de la Parole « n’est pas dans ce monde, il n’est nulle part en dehors de ta force : il est en toi-même ! » Les voici en prise immédiate avec « cette affaire insondable du vivre », constatant que « dans ce monde-ci, le nôtre, celui où l’on bat la misère », les choses « comprenables ne sont hélas pas les plus importantes ».
Ce faisant, ce n’est rien de moins qu’une métonymie de la création littéraire et de sa nécessité vitale que propose Le Vent du nord dans les fougères glacées, grand roman de la maturité artistique. Le « cheminement sans chemin » de Patrick Chamoiseau y dévoile des terres inconnues où déployer ses somptueuses harmoniques, et nous enchanter à nouveau.
[1] On pourra lire à ce propos l’article publié dans le quotidien numérique AOC le 13 décembre 2022
Juré du prix Marguerite Yourcenar, Bertrand Leclair est journaliste, romancier, essayiste et dramaturge. Il est également auteur d’une vingtaine de pièces radiophoniques et a collaboré à de nombreux ouvrages collectifs.
Le Prix Charles Brabant 2023 récompense Jean-Pierre Thorn, en cette année du documentaire, pour l’ensemble de son œuvre. 2023 est aussi le cinquantième anniversaire de la naissance du Hip Hop. Les étoiles s’alignent pour ce cinéaste qui est toujours resté dans l’ombre et n’a cessé de mettre en lumière les opprimés, les révoltés. Et ironie du sort. Le jour où l’on doit lui remettre son Prix, le 19 octobre 2023, une grève est annoncée…
Nadja Harek et Atisso Médessou ont rencontré Jean-Pierre Thorn pour un regard croisé.
Nadja Harek – On dit de toi que tu es un réalisateur militant politique et engagé. Mais qu’est-ce que ça veut dire ? Une case ? Un style ? Et ta poésie on la met où ? La première fois que je t’ai découvert c’est avec « Faire Kiffer les Anges » au festival de Montpellier Danse en 1996. Ça commence par un graffeur. Aujourd’hui on dit Street artiste. On a du mal à dire Hip Hop comme on a du mal à dire noir et arabe. Noredine marche au milieu de sa cité et se dirige vers un spot pour graffer en arborant le tee-shirt du groupe Public Enemy. Qu’est-ce qu’on attend du groupe NTM introduit le film. On se dit ça commence fort. C’est Vénèr. Ça claque. C’est Nous. Enfin un film qui parle de notre génération.
Atisso Médessou – À cette époque, je vivais à la Cité universitaire dans le quartier des Pyramides à Evry. Je n’en croyais pas mes yeux, comment Arte pouvait donner à voir des personnes faire du break sur des cartons au pied de leur immeuble. Des personnes comme toi et moi Nadja, celles que l’on côtoie dans notre quotidien. Je n’en croyais pas mes oreilles, entendre NTM c’était frais et dans ce documentaire cela ravivait l’essence même de ce morceau de rap que tous les JT avaient détourné pour mépriser les jeunes des quartiers populaires que nous étions, toujours relégués à la marge. Tu les as fait sortir de l’underground pour les mettre en lumière.
Un vrai électrochoc. On offrait enfin la possibilité à Noredine, Nicolas, Gabin, Karima et les autres de raconter leur vie en France et surtout de dire comment artistiquement ils restent debout grâce à l’art .
Nadja Harek – Nous sommes nombreux à avoir été marqués par ce film qui nous ressemble, qui parle de nous. Ce n’était pas encore l’insipide diversité, l’islamophobie, toussa toussa comme dirait le rappeur Disiz la Peste. Le racisme systémique que tu dénonçais, on le connaissait trop bien. On n’a jamais su nous nommer. Mais toi tu as su nous regarder, nous écouter, sublimer notre art et mettre en lumière notre personnalité à nous les enfants d’ouvriers. Par écho, par miroir. C’est la première fois que je vois une danseuse hip hop, Karima Khélifi avec qui en 2012 je ferai mon documentaire BGirls. Et puis nous découvrons tes autres films, tous liés à la colère de la rue, à l’injustice, au monde ouvrier.
Tu as posé une brique de plus dans le documentaire. Avec plusieurs films dont On n’est pas des marques de vélo et 93 la Belle Rebelle, tu as su donner les lettres de noblesse à un mouvement culturel longtemps perçu comme un phénomène de mode.
Tu nous reçois Atisso et moi chez toi non loin de République. Je vois trôner sur le haut de ta bibliothèque le livre culte Hip Hop Files, de la photographe et anthropologue Martha Cooper.
Comme Atisso, le premier monde que j’ai filmé c’est celui de la culture Hip Hop. Dès que je proposais un projet lié à cette culture, un responsable documentaire du service public me disait « c’est bon y a déjà Jean-Pierre Thorn qui a réalisé un film ». Je lui disais mais la nouvelle génération existe elle a des choses à dire. Il fallait se battre et tu m’as encouragée. Et tu t ‘excuses encore aujourd’hui devant moi parce qu’on a fait de toi le fusible ? Il ne faut pas s ‘excuser de la bêtise des autres.
Jean-Pierre Thorn – J’ai été financé oui mais je ne suis pas dupe. On me donnait ce rôle pour que des gens comme toi ne prennent pas la parole.
Depuis quelque temps, le sentiment dominant est la déception. Les opprimés sont mutilés pour leur colère face à l’injustice. Même si le mélange des cultures te tient à cœur autant qu’à nous, nous assistons à une montée inquiétante d’un racisme décomplexé. Mais comme nous, tu as la rage intacte.
NH et AM – On dit que c’est au pied du mur que l’on reconnaît un maçon. Avec Le Dos au mur j’ai reconnu en en toi un cinéaste exigeant qui place la classe populaire au cœur de ses récits. Tu es de la trempe de ceux qui filment des mouvements collectifs à en faire jaillir des voix d’hommes et de femmes singulières. Dans ce film, tu parviens à nous faire partager la ferveur au quotidien des ouvriers en grève à l’intérieur comme à l’extérieur de leur usine.
Oser lutter oser vaincre est le film dont tu es le plus fier. Slogans de 68 que je retrouve écrit noir sur rouge en 2019 sur une banderole d’un de mes personnages à venir, lors d’un tournage pendant le Hirak, mouvement révolutionnaire algérien.
Ne faire qu’un avec ce qu’on voit est mortel et ce qui sauve c’est toujours la production d’un écart libérateur.
Marie -José Mondzain, L’image peut-elle tuer?
Ce que tu refuses c’est l’endormissement des facultés d’indignation, face aux images dites naturelles et vides de sens. Ton style c’est de créer des ruptures avec le réel filmé comme un acte politique, comme la possibilité de regarder vraiment à travers l’opacité des images. Jouer avec le cinéma pour atteindre la vérité c’est ça ton cinéma. Le destin collectif apparaît en suivant les traces du destin individuel. L’ouvrier, la bonne sœur, le rockeur, l’artiste hip hop, le gilet jaune, de ta place tu parles de la société française qui implose, qui se désintègre.
De six à seize ans, tu as vécu au Cameroun et en Côte d’Ivoire. Ton père exerçait le métier de technicien au sol d’Air France, avant de finir chef d’escale.
Je me foutais de la gueule de mon père, je le traitais de colon. Ça le mettait en colère.
J’étais fils de protestants, avec une mère très pratiquante, dont le comportement m’amusait : elle faisait venir de France des sapins de Noël via le commandant de bord !
Son plus grand désespoir a été le jour où on a dû utiliser, pour faire le sapin, des branches de palmiers à Douala. D’ailleurs à la maison on mangeait français, alors que j’aimais bien la cuisine africaine.
Tu étais déjà avec “Nous”. Par ricochet, tu es passé du continent Africain, aux usines où nos parents trimaient, pour nous rencontrer par l’intermédiaire de la culture Hip Hop. C’est comme si nos parents étaient à tes côtés pour résister habillés de dignité. Une dignité qu’ils nous ont transmise. Tout était tracé pour que tu atterrisses dans les usines afin de vivre ta conscientisation et surtout afin d’agir au lieu de « blablater » comme les gauchistes. En 1968, tu fais des pieds et des mains pour faire rentrer une caméra dans une usine.
Dans un film, on n’est jamais neutre. Les ouvriers étaient mis dos à dos avec les grévistes. Toujours cette menace de perdre son emploi, ses indemnités, et ce patron qui m’interpelle en me demandant ce que je faisais là ! Je dis toujours que lorsqu’on filme on est d’un côté ou d’un autre. Il faut arrêter de dire qu’on est neutre et invoquer la distance. On n’empêche que les films se fassent à cause de ça. En mai 68 quand tu as une caméra, tu es soit du côté des étudiants soit des flics. Je déconseille à tout le monde de monter au-dessus de la barricade, tu reçois des deux côtés des grenades et des pavés.
Je ne suis jamais du côté des privilégiés parce que j’ai trouvé une générosité, une intelligence chez les autodidactes. Ils n’ont pas cet orgueil des bourgeois qui savent tout. Les trois quarts du cinéma c’est « je sais tout ». Les bourgeois m’ont toujours fait chier, leur hypocrisie aussi.
Tu dis « Il faut savoir sortir de la narration pour que le spectateur prenne position ». Tu respectes trop le réel. Dans Je t’ai dans la peau, ton unique film de fiction, tu composes avec le Mistral et tourne tes scènes de la cité ouvrière, à l’église des prêtres ouvriers communistes, tu portes attention au soin des tenues de l’époque. C’est pour ça qu’on entend coupez à la fin du film L’Âcre parfum des immortelles, et qu’on voit les regards caméra au début de Faire kiffer les anges.
C’est une façon de dire c’est un spectacle, je regarde. Vous avez peut-être un autre regard sur ce que je vous montre et c’est à vous spectateur de l’affirmer.
Le naturalisme a toujours été pour moi au cœur de l’esthétique du pouvoir pour aliéner les capacités d’indignation du peuple, le maintenir dans une résignation.
La théorie d’Eisenstein c’est que le sens d’un film est lié par deux images qui s’entrechoquent. L’unité des contraires, le matérialisme dialectique.
Il faut présenter des fragments de scène et que le montage se fasse dans le cœur du spectateur, dans la tête et dans le cœur de manière à créer un saut extatique.
Et c ‘est là dans ta fiction à la manière d’Eisenstein que le sens se fait. On se retrouve en 1956, après avoir rencontré ton personnage dans les années 1940, La religieuse, débarrassée de sa croix, devient ouvrière à la chaîne dans une usine. Une musique mélancolique nous donne à entendre ses pensées. Le bruit de la presse et la venue du chef viennent sortir Jeanne de ses pensées. Et le couperet tombe, le chef qui sans pitié lui dit “quel enthousiasme mademoiselle Rivière”. Comment peut-on être enthousiaste lorsqu’on travaille à la chaîne ? lorsqu’on risque de perdre son travail à tout moment si on n’atteint pas le rendement ?
Le documentaire c’est apporter de la poésie, de la couleur. Je travaille énormément à l’étalonnage de mes films et à la bande son. Ce sont des moyens que je me donne, cette notion de contrepoint que j’ai appris chez Eisenstein est très importante pour moi. En 1967, j’ai vu Octobre, j’ai suivi des cours de Barthes qui enseignait la sémiologie, j’avais convaincu mon père qui ne comprenait pas que je puisse écrire une thèse “Matérialisme dialectique et montage”. Les plus grands documentaristes pour moi c’est Eisenstein, Glauber Rocha ou Godard qui travaillent la fiction en y mettant du documentaire.
« Le parti je l’avais dans la peau si j’étais exclue j’en mourrai ». C’est la phrase de ton personnage Jeanne Rivière Les premières images de ta fiction sont des images du réel. Une femme dans la pénombre de son modeste appartement de banlieue assiste au décompte de l’élection présidentielle de Mitterrand. Le malaise, la désillusion se lisent sur son visage et n’augurent rien de bon. L’avenir malheureusement lui donnera raison.
Dès les premières scènes de Je t’ai dans la peau, on voit la condition des opprimés. Là il s’agit d’une femme aux prises avec son quotidien de daronne qui, pour cacher la violence conjugale qu’elle subit, dit à la religieuse qui lui rend visite qu’elle s’est cognée contre un coin du fourneau. « Et le fourneau il vous fait des coquards des deux côtés ? » lui demande avec compassion la religieuse. Cette femme voudrait juste travailler mais son mari refuse et la traite de traînée. Tu dénonces le patriarcat à l’état pur. C’est à coup de poings qu’ils discutent. Voilà l’époque. Et ça continue…
Ta révolte et tes idéaux sont dans tes dialogues. Comme le rappeur Grandmaster Flash, Tu as un flow, des lyrics, un message. L’avortement, les violences conjugales, la guerre, il faut choisir son camp. A travers ton personnage, tu questionnes la position de l’Eglise face aux injustices.
Le fait qu’un moyen de lutte devienne une fin en soi, presque religieuse, ça résonnait en moi. Je ne pouvais l’aborder que dans la fiction. Peut-être que je me serais simplifié la vie si j’avais fait un documentaire plutôt qu’une fiction.
Charles Brabant m’a fait une commande d’écriture. J’ai eu l’avance sur recettes pour ce projet co-écrit avec Lorette Cordrie. Je n’arrivais pas à le monter pourtant je n’étais pas encore mal vu. Toutes les télés l’ont refusé, personne ne comprenait cette histoire de femme qui se suicide à 52 ans pour contester ce qu’était devenu la gauche. Pourquoi cette femme est allée jusqu’à la mort ? Toutes ces questions, cette fidélité à l’appareil résonnaient en moi.
Là ou après toi, Rabah Ameur-Zaïmeche va faire la fiction Bled Number one, pour parler de la double peine, toi tu choisis le documentaire avec ton film On n’est pas des marques de vélo.
Bouda le personnage principal du film n’arrêtait pas de dire « mais je n’ai rien fait ». Je lui disais arrête Bouda tu as fait des conneries, ce qui n’est pas normal c’est qu’on t’ait expulsé vers un pays que tu ne connais pas. S’il s’était agi de mon fils, au bout de deux ans il aurait repris sa place dans la société française.
Je voulais le faire marcher pour qu’à la fin il soit dans le soleil. On a dû répéter avec le caméraman et sans Bouda, pour qu’on ne se casse pas la figure. Je lui faisais des signes pour qu’il avance vers moi et qu’il arrive vers la lumière. Et c’est là que c’est génial le documentaire : Bouda m’a échappé! Il s’arrête devant moi et dit : « finalement elle est belle ma vie ». J’étais sidéré. Car ce personnage disait : « j’ai bien commencé », « j’ai mal tourné et puis finalement je m’en suis bien sorti ». J’espère que ça servira aux jeunes pour qu’ils fassent moins de conneries. Il avait tout compris.
Ça, j’y arrive tout simplement en faisant marcher les gens. J’appelle ça la scène des aveux. Comme on l’avait chauffé à blanc la veille, c’est presque de la fiction.
Quand je fais du documentaire c’est parce que j’aime les gens. Je savais que Bouda pouvait me dire ça et je le respecte. S’il n’avait pas voulu, je ne l’aurais pas filmé. Ce que je voulais montrer c’est l’inadmissible : ne pas donner une chance de réinsertion.
Dans ta jeunesse, tu te rends à Madagascar, voir ton père, avec Joëlle, ton amour. Vous attrapez tous les deux le paludisme. « Elle y est restée moi je m’en suis tiré » dis-tu. Et tu as réalisé L’Acre parfum des immortels, un film en forme de lettre à ta bien aimée. Tu reviens sur tes fantômes filmiques, certains sont encore debout et vivants, d’autres te hanteront à jamais. Un amour perdu dans mai 68 où apparaissent fantômes rebelles d’hier et d’aujourd’hui. Toujours l’insoumission. Toujours la rage face à l’injustice. Toujours l’amour de tes personnages que tu fais vivre et revivre au-delà du temps et sans frontières.
La scène finale de ce film est comme une jonction entre le hip hop et le rock.
Oui, le guitariste Serge Teyssot-Gay et la rappeuse Casey m’ont fait comprendre que pour retrouver leur énergie de départ et sortir de leur côté établi, le Hip Hop et le Rock devaient se rejoindre. Quand j’ai dû faire la musique de L’Acre parfum des immortels, je me disais, mon histoire à moi c’est le rock alternatif. Pourquoi je me retrouve au côté du Hip Hop, il faut que j’aie le courage d’assumer d’où je viens.
Notre génération écoutait à la fois du rock alternatif du punk et du rap, parce qu’il y avait un message.
Je raconte l’échec d’une lutte. J’ai pensé que la meilleure manière de finir le film était de situer la danse dans une usine déserte. Ça renvoie à l’histoire ouvrière.
Le Hip Hop c’est une culture de la banlieue qui veut aller dans le centre.
Ma famille ça a été le Hip Hop, au moins c’était concret. Mes copains étaient les fils des ouvriers. J’adore leur vision du monde, leur façon de travailler, leur franchise. Ils t’invitent à leur première. Tu vois comment les éclairagistes des scènes de théâtres ne leur donnent pas les moyens de bien faire leur spectacle. Tu vois tout le racisme endémique de la société, tu vois aussi comment on peut leur monter la tête pour qu’ils perdent leurs valeurs. Scandaleux! Le mépris des décideurs culturels pour la culture qui vient du peuple.
Dans ton dernier film, un de tes personnages dit : “Il aurait fallu couper des têtes”.
Le système est pervers. Le Hip Hop a servi aux classes dirigeantes, c’est sous le ministère de Sarkozy et non sous la gauche, que deux chorégraphes issus de l’immigration ont pu diriger des centres chorégraphiques privilégiant les spectacles de divertissement. Tout ça sans permettre à ceux qui ont un vrai message d’accéder à ces scènes. Diviser pour mieux régner. Les chorégraphes issus eux-mêmes du Hip Hop ne les programmaient pas. Ce système pervers a utilisé le Hip Hop pour faire croire qu’on s’occupait des banlieues. Farid Berki l’a bien compris : on veut nous faire jouer les pompiers de service pour éteindre l’incendie sans régler quoi que ce soit. Je trouve que c’est dramatique pour le Hip Hop qui ne s’interroge pas assez sur le rôle que lui a fait jouer le système.
Recevoir ce prix, ça va faire la nique à tous ceux qui m’ont chié à la gueule et ils sont nombreux ! l’avance sur recette du CNC, les diffuseurs me disent que j’ethnicise les rapports sociaux lorsque je me réfère à Alice Diop ou à Rachid Djaïdani.
Les rapports de classe c’est de voir qui est en bas de l’échelle et moi à l’usine j’ai tellement vu ça. Ceux qui sont les plus exploités sont les immigrés. Faut arrêter de se raconter des histoires.
J’ai fait ces films pour redonner de la fierté aux ouvriers, aux immigrés et aux copains, copines, ces enfants d’immigrés qui sont devenus des artistes à part entière.
Tout ce que j’ai découvert je le transmets. Aujourd’hui c’est vous qui allez poursuivre ce combat.Jean-Pierre Thorn
Aux Ouvriers, aux B-Girls, aux B-Boys, aux Graffeurs aux Rappeurs, aux Dj’s, aux Punks, aux Rockeurs, aux Gilets Jaunes, aux Autodidactes, aux Méprisés, aux Opprimés. PEACE !
Crédit photo : Oser lutter, Oser vaincre, manifestation du HIRAK algérien – photo Nadja Harek
Nadja Harek est réalisatrice, scénariste et comédienne. Elle est l’auteure de plusieurs films liés au Hip Hop dont Du Cercle à la Scène, Bgirl, Mayotte Hip Hop Révolution. Ses documentaires qui questionnent l’immigration Ma Famille entre deux terres (lauréate brouillon d’un rêve Scam 2014) et Tata Milouda ont été récompensés au festival du documentaire de Tanger et au Fespaco. Actuellement elle travaille sur deux projets Debout Payé, adaptation du livre éponyme de Gauz et Rage Intacte avec Pierre Carles.
Atisso Médessou est un auteur réalisateur de films documentaires et de fictions. Pour le rappeur Disiz la Peste, il réalise le clip J’pète les plombs. À la télévision, il intervient dans les collections de films documentaires Opération TéléCité (France 3), L’Œil et la Main (France5), Toutes les télévisions du monde (Arte). Son film documentaire Les bandes, le quartier et moi s’est vu décerné l’étoile de la Scam 2012. Actuellement, Atisso Médessou enseigne au sein de la Classe Cinéma du Cours Florent et développe un projet de long-métrage pour lequel il a obtenu le soutien de la Région Réunion.
Lauréat du Prix Nouvelles Écritures au Fipadoc 2023, Thierry Loa n’a de cesse de mettre en lumière notre planète Terre, qu’il arpente drone et caméra VR en main pour nous dévoiler cette vertigineuse époque qu’est l’anthropocène. Son œuvre monumentale « 21-22 », telle une odyssée entamée en 2018, nous fait tourner la tête… et les jambes de ce discret et talentueux cinéaste-baroudeur. À la démesure de son talent. Rencontre.
Vous pouvez demander son âge à Thierry Loa, il ne répondra pas. Vous pouvez le questionner sur ses origines, sa famille, son enfance ou son parcours, il ne répondra pas non plus. Tout juste saura-t-on qu’il a étudié le multimédia, la philosophie, le cinéma et la géographie, entre l’Australie et son Canada natal. Entamé sa carrière en alternant publicités et œuvres d’art multimédia à Toronto, où vit toute sa famille. Migré à Montréal en 2015 pour devenir le cinéaste interdisciplinaire qu’il est aujourd’hui.
Un jour, il aimerait réaliser un projet racontant ses origines. Mais en attendant, il entretient un certain mystère autour de sa personne, en entretien comme avec ses amis. « Je trouve que les gens dévoilent trop de choses », pose-t-il d’emblée lors de notre rencontre. « Je suis très discret, voire privé. Peu de gens me connaissent bien. » Il préfère largement parler de ses œuvres plutôt que de lui-même. Internet ne vous aidera pas à en savoir plus : le premier résultat proposé par Google lorsque l’on cherche son nom est l’article de la Scam annonçant sa récompense au Fipadoc, en janvier 2023.
Alors parlons de ses œuvres, à commencer par la dernière. Je faisais partie du jury qui a décerné ce prix Nouvelles Écritures à Biarritz. Comme les deux autres membres, j’ai été totalement embarquée par 21-22 China, son film en 360 VR, premier volet d’une série qui s’annonce monumentale. Casque sur la tête, on survole la Chine pendant vingt minutes, dans un voyage méditatif, sans aucune voix off si ce n’est une rapide introduction. On découvre des paysages saturés d’urbanisme, déshumanisés, presque surréalistes. Avec 21-22, Thierry Loa observe, explore et critique l’anthropocène, cette époque où l’activité humaine modifie, voire détruit, les écosystèmes de la planète. Le développement industriel majeur et les changements massifs transforment irrémédiablement la topographie. Vu du ciel, le constat est implacable et vertigineux.
L’idée qu’a Thierry de la musique qu’il souhaite que je compose est souvent si précise qu’à chaque fois que l’on termine un projet, j’ai l’impression d’avoir été une extension de son esprit.
Philippe Le Bon, compositeur
Dans les oreilles, la bande-son saisit le spectateur. Comme tous les films de Thierry Loa depuis 2017, elle a été composée par le Canadien Philippe Le Bon, qui décrit une collaboration aussi passionnante que déroutante. « L’idée qu’a Thierry de la musique qu’il souhaite que je compose est souvent si précise qu’à chaque fois que l’on termine un projet, j’ai l’impression d’avoir été une extension de son esprit. Avec lui, je mets plus d’effort à saisir exactement ce qu’il souhaite que d’effort à composer. J’ai souvent eu l’impression que ne rien savoir des origines de Thierry expliquait peut-être, du moins en partie, le fait de ne pas toujours saisir ce qu’il attend du premier coup. »
Exigence, discipline et rigueur font partie des mots qui reviennent le plus souvent pour caractériser Thierry Loa. En salle de montage comme dans un salon de thé, les discussions peuvent durer des heures. Ce qui n’est pas pour déplaire à Philippe Le Bon. « Thierry s’attend à ce que ses collaborateurs appliquent le même niveau d’exigence que le sien. Cette rigueur ne l’empêche toutefois pas d’être quelqu’un de profondément bon, humain et bienveillant. Je n’ai jamais vu Thierry dans un élan de colère, ou même lever le ton. Il reste toujours calme et posé, à la recherche de solution, même quand c’est moi qui commence à m’emporter parce que ça fait six versions que je lui propose pour une scène et que ce n’est toujours pas ce qu’il veut ! »
Au Fipadoc, à Biarritz, j’ai découvert un jeune homme, sac greffé sur le dos et sourire aux lèvres. De courts cheveux noirs, un bouc assorti, un short (il déteste les pantalons) et un accent indéfini. Comme son âge. Et surtout, une humilité saisissante et une reconnaissance immense pour son prix. Deux mois plus tard, j’ai revu Thierry à la Scam. Il arrivait tout droit de Montréal, son sac toujours sur le dos, pour participer à l’événement eXplorations, organisé par la commission des Écritures et formes émergentes. Même sourire, même discrétion, même reconnaissance.
Ma règle de vie depuis des années : jamais de bagage en soute !J’ai amélioré ma façon de voyager au fil du temps pour être plus efficace.
Thierry Loa
Deux mois plus tard, il réalise notre entretien en visio depuis son bureau à Montréal. En arrière-plan, son vélo, avec lequel il se déplace toute l’année, y compris sous la neige. Quelques jours avant, Thierry vadrouillait au Maroc pour commencer les repérages en vue de son prochain volet consacré à l’Afrique. « Pour chaque volet de 21-22, je passe beaucoup de temps sur place, à vivre comme un local, pour comprendre la culture, la société. Je loue un appart, je vais au musée, j’étudie les enjeux climatiques du lieu où je suis. Surtout, j’échange avec les habitants pour comprendre leur point de vue et éviter de plaquer sur eux des préjugés. Ce travail ethnographique ne se voit pas à l’écran, mais ça me nourrit. »
Avec 21-22, Thierry a adopté une vie nomade, détachée des biens matériels. En repérage comme en tournage, toutes ses affaires tiennent dans un sac cabine de 50 litres. « Ma règle de vie depuis des années : jamais de bagage en soute ! J’ai amélioré ma façon de voyager au fil du temps pour être plus efficace. » Légèreté et efficacité le guident sur le terrain qu’il arpente avec une caméra VR attachée à un drone. Un dispositif qu’il a perfectionné en mode R&D, depuis ses premiers tournages en 2018, pour être le plus mobile et le plus discret possible. Pratique en Chine, quand il faut passer pour un touriste.
Reprenons le (long) fil de l’odyssée 21-22. Entrepris en 2018, le premier volet, « Chine », est donc achevé, diffusé et récompensé. Le deuxième épisode mettra le cap sur les États-Unis. Après de nombreux tournages de 2020 à 2022, la post-production se termine bientôt. Direction l’Inde pour la troisième partie, en début de développement. Après l’Afrique, qu’il envisage pour 2025, il restera encore quatre volets, « si tout va comme prévu et si l’univers le permet » : l’Amérique du Sud, le Moyen-Orient, le pôle Nord et l’Europe. Monumental, on vous dit.
Je ne tiens pas forcément à tout faire seul, je ne suis pas un loup solitaire.
Thierry Loa
Patiemment, il finance chaque volet l’un après l’autre, grâce aux soutiens publics tels que le Conseil des arts du Canada, le Conseil des arts de Montréal et le Conseil des arts et des lettres du Québec. « Les gens pensent que mon projet coûte très cher. Pour ne pas exploser les coûts, je fais en sorte d’optimiser au maximum mon budget. Je pars seul, je recrute des locaux avec qui les échanges sont essentiels. Je ne tiens pas forcément à tout faire seul, je ne suis pas un loup solitaire. Je fais juste ce qui est le plus pertinent pour le projet. » Reste que Thierry Loa écrit, tourne, monte, réalise et produit cette folle série qui raconte la Terre.
L’autofinancement, la débrouille et la démesure, il connaît. En 2018, il a mis un point final à 20-22 OMEGA, son premier long-métrage. Un documentaire symphonique muet, tourné en pellicule, pendant cinq ans, dans une centaine de lieux. Un film qui observe la société présente et future du point de vue du passé, et qui prolonge son court-métrage 20-22 ALPHA dans lequel, déjà, en 2015, il documentait notre époque.
Thierry a une vision forte et claire de ce qu’il veut, il est aussi méthodique que créatif.
Forbes Campbell, vidéaste
Pour 20-22 OMEGA, Thierry Loa a embarqué avec lui le vidéaste canadien Forbes Campbell, devenu depuis un ami. « Au début, Thierry était un peu mon mentor et moi son assistant, bien que je sois plus âgé que lui. Il a une vision forte et claire de ce qu’il veut, il est aussi méthodique que créatif », raconte Forbes Campbell. Surtout, le jour où Thierry lui fera acheter des cuissardes de pêche afin de filmer l’intérieur d’une mine abandonnée et inondée. Au rayon des meilleurs souvenirs, c’est le premier qui vient à l’esprit de Forbes Campbell.
Quand il ne capture pas l’univers, Thierry Loa avance sur un autre grand projet : A Man and a Woman, un film de fiction interactif qui l’occupe depuis plus de dix ans. Dans celui-ci, il est question du cycle infini de l’amour et de la vie. Tout un programme. En cours également, son projet CODE MRU, un documentaire sur les habitants de l’île Maurice. Avec tout ça, il trouve (parfois) le temps de poursuivre FACES, un projet ethnographique de portraits réalisés dans l’espace public.
La réalisation, c’est dur, il faut être coriace et prêt à faire face à toutes les situations, comme un athlète de haut niveau.
Thierry Loa
À ses heures perdues, Thierry Loa absorbe tout ce qu’il peut en se perdant sur YouTube : infos, conférences, vulgarisation géopolitique. Et tout ce qui peut nourrir ses projets. Côté fiction, il « gobe tout : cinéma, blockbusters, séries, films grand public… Je regarde juste moins d’œuvres expérimentales qu’avant, car j’ai assez appris pour constituer ma base ». Quand il quitte son écran, c’est pour pratiquer du sport et notamment du crossfit. « Mes tournages pour 21-22 durent des semaines en mode marathon, il faut tenir le coup physiquement et mentalement. Ça m’aide beaucoup d’être sportif. La réalisation, c’est dur, il faut être coriace et prêt à faire face à toutes les situations, comme un athlète de haut niveau. »
Tout cela ne laisse guère de place pour une quelconque vie de famille. Avec toute l’humilité qui le caractérise, il sourit et glisse : « Mes enfants, ce sont mes projets ». Ça tombe bien, les huit volets de 21-22 risquent de l’occuper un bon bout de vie. Certains tournent autour de leur sujet des années. Thierry Loa, lui, tourne autour de la Terre, littéralement.
Journaliste indépendante, Marianne Rigaux réalise des reportages entre la France et la Roumanie pour la presse magazine. Responsable pédagogique, elle est également très investie dans différentes activités associatives et siège à la Scam en tant que membre de la commission Écritures et formes émergentes.
Le jury salue cet essai, écrit sur un ton vif et enlevé, qui propose une réflexion d’une grande intelligence sur les premières traductions de Kafka et plus largement sur la question de la traduction.
Dix versions de Kafka comme dix fois Kafka bien sûr, mais aussi dix portraits de traducteurs engagés tout entiers dans le transport d’une langue à l’autre, et dix gestes de traduction singuliers, chacun découvrant, déplaçant et recontextualisant à sa façon l’œuvre kafkaïenne. Ces premières « versions » de Kafka (parmi lesquelles celles de Jorge Louis Borges, Paul Celan, Primo Levi, Alexandre Vialatte, Milena Jesenská ou de traducteurs soviétiques anonymes) interrogent ainsi, par-delà les circonstances et enjeux spécifiques de chacune d’entre elles, le rapport de l’œuvre originale à ses « extensions », les possibilités de rencontre de deux langues sur les terrains littéraire et politique, le lien personnel et nécessaire enfin entre deux locuteurs qui se découvrent un pokoï commun, variante slave de la « chambre à soi », un espace où se retrouver – celui de la littérature.
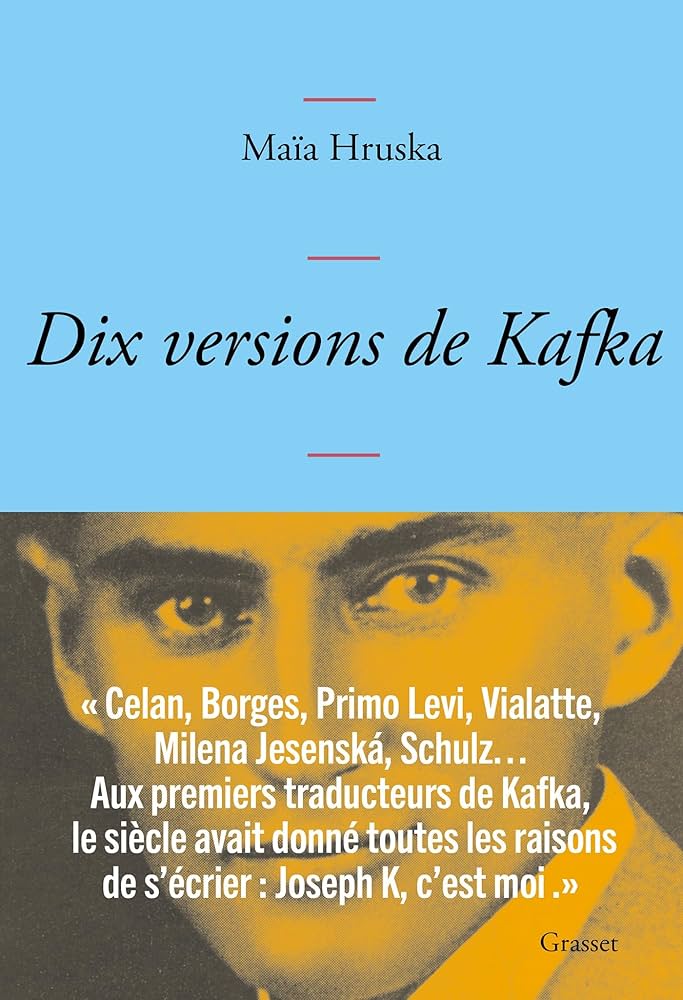
Maïa Hruska est née en 1991 au sein d’une famille franco-tchèque, et a grandi en Allemagne. Elle vit aujourd’hui à Londres et travaille au sein de la maison d’édition Wylie. Dix versions de Kafka est son premier essai.
Le jury du Prix François Billetdoux, composé des membres de la commission de l’écrit, est très heureux de saluer ce livre qui rend grâce au documentaire, au journalisme, à la peinture et la littérature.
Michèle Kahn
Le jury du Prix François Billetdoux 2025 est composé de Lucile Bordes, Simonetta Greggio, Ivan Jablonka, Isabelle Jarry, Michèle Kahn (fondatrice du Prix), Bertrand Leclair, Eloïse Lièvre, Ernestine Ngo Melha, Pascal Ory, Hubert Prolongeau et Jean-Marc Terrasse.
Contact presse : presse@scam.fr – 01 56 69 64 34
Auteur d’une oeuvre multiple et virtuose, écrivain et peintre, Gilles Sebhan se révèle en publiant aux Éditions du Rouergue une série policière saluée par la critique, mettant en scène un héros récurrent, le lieutenant Dapper. Ce cycle comprend cinq romans : Cirque mort (2018, Rouergue en poche 2020), La Folie Tristan (2019), Feu le royaume (2020), Noir diadème (2021) et Tigre obscur (2022).
En 2023 parait, toujours aux éditions du Rouergue son essai Bacon, juillet 1964 qui lui vaut aujourd’hui le prix François Billetdoux.
En 1964, la Radio Télévision Suisse commande au réalisateur Pierre Koralnik un documentaire sur la situation économique de l’Angleterre. Celui-ci part pour Londres avec le journaliste spécialisé Émile de Harven et, sur un coup de tête, demande un rendez-vous au peintre Francis Bacon, alors au sommet de sa gloire.
Au milieu de cascades de pastis et de rires glaçants, dans l’atelier bordélique où déambulent l’ami, l’amant, un bel inconnu et une femme qui pleure, où Bacon joue à manquer de s’étrangler avec un câble, le journaliste (peu familier du peintre) lui fait exprimer, en français et à mesure que croît l’ivresse, une « vérité énigmatique ». Ce sont les mots de Gilles Sebhan dans le livre étincelant où il décrypte le film avec sa profonde et fine connaissance de la vie, de l’oeuvre et de la psychologie du peintre anglais.
Le jury du Prix François Billetdoux, composé des membres de la commission de l’écrit, est très heureux de saluer ce livre qui rend grâce au documentaire, au journalisme, à la peinture et la littérature.
Michèle Kahn
Le jury du Prix François Billetdoux 2024 est composé de Laura Alcoba, Virginie Bloch-Lainé, Simonetta Greggio, Ivan Jablonka, Isabelle Jarry, Bertrand Leclair, Eloïse Lièvre, Ernestine Ngo Melha, Pascal Ory, ainsi que Michèle Kahn, fondatrice du Prix.
Contact presse : presse@scam.fr – 01 56 69 64 34

Un jour, la narratrice de Totalement inconnu entend parler dans son oreille droite. Une voix lui enjoint de porter des habits noirs afin d’attirer la mort, et quantité d’autres commandements absurdes. Désireuse de s’immiscer « dans les petits papiers de la mort » alors qu’un cancer la menace, la narratrice décide aussitôt de se soumettre à l’autorité de ce qui la dépasse, sur la page aussi bien que dans la vie. Rédigeant une conférence, elle exerce à son tour sa propre voix, ce faisant, pour nous maintenir sous un étrange pouvoir en partageant son expérience : sa docilité joueuse l’a libérée du « jugement d’autrui, de l’hésitation, libérée de la contingence», et rien de moins.
Célébration joyeuse de l’écriture, le onzième roman de Gaëlle Obiégly embarque le lecteur dans les méandres de la création avec une insolente et très vivifiante liberté que le jury du prix François Billetdoux, composé des membres de la commission de l’écrit est très heureux de saluer.

Née en 1971 à Chartres, Gaëlle Obiégly a fait des études d’art puis de russe avant de publier son premier roman Petite figurine en biscuit qui tourne sur elle-même dans sa boîte à musique en 2000 dans la collection L’Arpenteur chez Gallimard.
Dans les années qui suivent, elle publie dans la même collection cinq romans dont Gens de Beauce (2003), Faune (2005) et La Nature (2007). Mon prochain paraît en 2013 aux éditions Verticales. De 2014 à 2015, Gaëlle Obiégly a été pensionnaire de la Villa Médicis. Elle obtient un succès critique et public avec N’être personne (Verticales, 2017). Elle collabore occasionnellement à des revues dont L’Impossible et Les Chroniques Purple.
Le jury du prix François Billetdoux 2023 : Laura Alcoba, Arno Bertina, Catherine Clément, Colette Fellous, Simonetta Greggio, Nedim Gürsel, Ivan Jablonka, Isabelle Jarry, Bertrand Leclair, Pascal Ory, ainsi que Michèle Kahn, fondatrice du Prix.

Cristina Campodonico – 06 85 33 36 56 – cristina.campodnico@scam.fr