Sans traducteurs de talent, les films étrangers resteraient inaccessibles à la très grande majorité du public français.
À travers ce Prix, l’ATAA avec le soutien de la Scam met à en lumière le travail de ces auteurs et autrices de l’ombre.

Titre original : The Social Dilemma
94’ – 2020 – USA – diffusé sur Netflix
produit par Exposure Labs, Argent Pictures et The Space Program
Version française : Dubbing Brothers
Direction artistique : Caroline Cadrieu
Entre documentaire et drame, ce film donne la parole à des experts qui nous mettent en garde contre les innovations dont ils ont été les pionniers et décrient l’impact dangereux des réseaux sociaux. Il décortique le modèle économique des entreprises du numérique, telles que Facebook, Google, Twitter, Instagram et YouTube. Des analyses d’universitaires, comme Shoshana Zuboff qui a créé le concept de « capitalisme de surveillance », et des témoignages alarmistes d’anciens employés de ces géants du Web (ingénieurs, concepteurs de services, dirigeants, etc.) défilent, illustrés par des séquences fictionnelles mettant en scène des adolescents dont l’attention est de plus en plus mobilisée par leur activité en ligne.
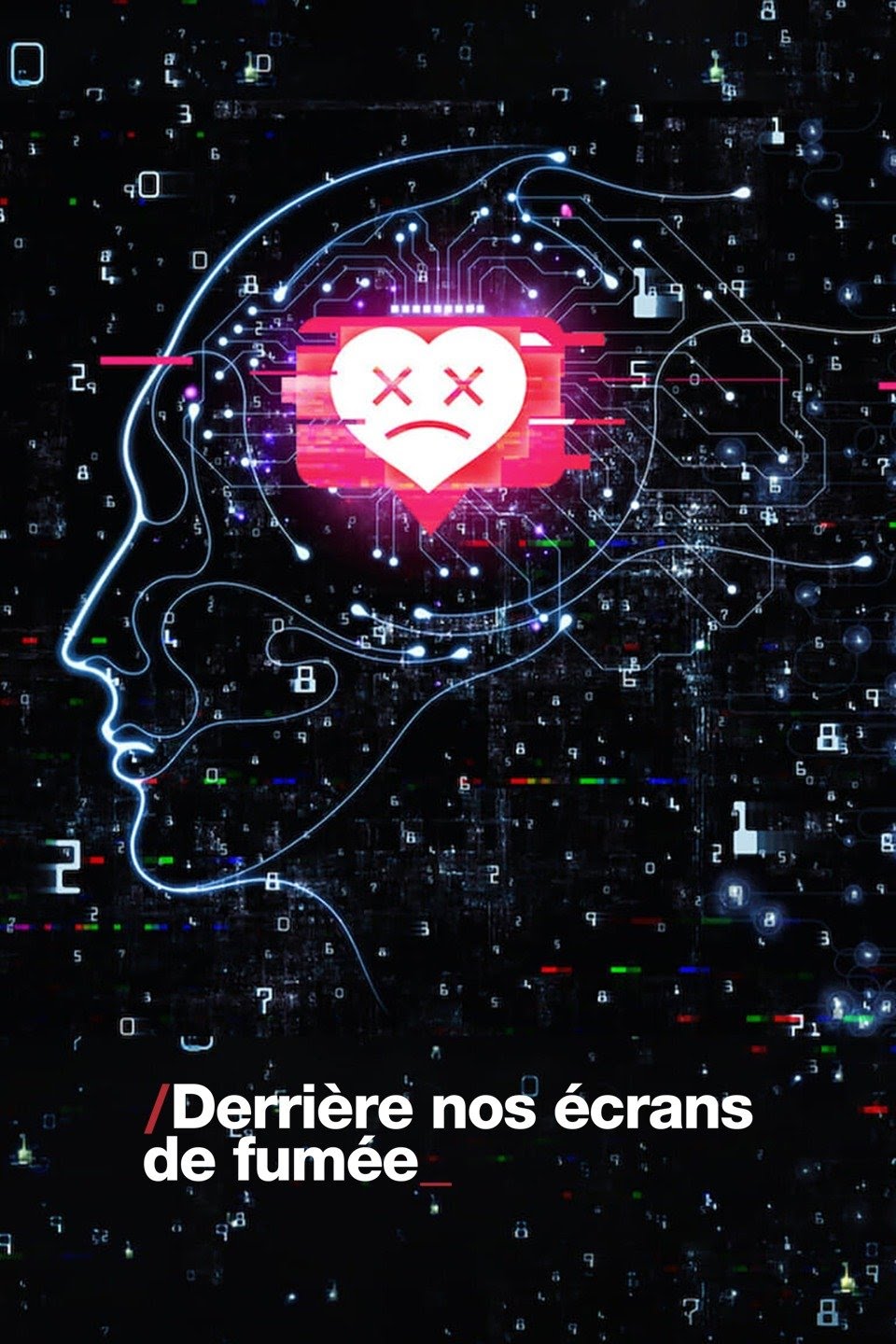

Titre original : Seaspiracy
90’ – 2021 – USA – diffusé sur Netflix
produit par Aum Films et Disruptive Studios
Version française : Dubbing Brothers
Direction artistique : Caroline Cadrieu
Dans ce documentaire caméra à l’épaule sur les dommages des activités humaines sur la vie marine, un cinéaste passionné met à jour une grave corruption à l’échelle mondiale. Il décrit l’impact de l’homme sur les écosystèmes marins, en particulier les débris plastique, les filets dérivants et la surpêche dans l’ensemble des océans, mettant en cause les ravages de la pêche industrielle. Le film s’interroge également sur le concept de pêche durable et mène l’enquête sur plusieurs organismes de préservation en exposant leurs insuffisances dans la lutte pour la protection des océans.

Dix ans ont passé et le canard est toujours vivant. Acteur central du débat public avec ses pages de liberté dédiées à l’irrévérence, Charlie Hebdo s’impose comme une valeur cardinale de la culture française, avec chevillé au corps l’humour à vif, meilleure manière de tout surmonter – ou presque. En remettant à l’ensemble de sa rédaction le Prix Jean-Marie Drot, la Scam salue un engagement irréductible en faveur de la liberté d’expression, de création et d’information.
Né en 1970 dans la continuité d’Hara-Kiri, le journal perpétue une indépendance farouche, assurée par l’absence de publicité et une grande liberté assurée à ses contributeurs. Cet espace éditorial ouvert a permis aux dessinateurs et journalistes de forger un ton personnel, satirique, souvent provocateur, visant les figures d’autorité politiques, religieuses ou sociales.
En 2006, la reprise d’une série de caricatures de Mahomet publiée par un journal danois déclenche une controverse mondiale. Un procès retentissant donne raison à l’hebdomadaire qui devient la cible des radicaux de l’intolérance. L’attentat terroriste de 2015 coûte la vie à douze membres de son équipe. Charlie reparaît dès la semaine suivante, réaffirmant sa liberté de ton, sa vocation à rire de tout et son refus de céder à la peur. Voué à son identité originelle, désormais sous protection permanente et toujours en première ligne, la rédaction de Charlie Hebdo restera toujours Charlie.
Contact presse : 01 56 69 64 34 – presse@scam.fr
Figure emblématique de l’administration publique, François Hurard a joué un rôle majeur dans la structuration et le soutien des filières culturelles françaises, en particulier dans le secteur audiovisuel. Ses travaux ont conduit à la création de la Cinémathèque française en 2017 et au premier Fonds de soutien à la création sonore en 2021. La Scam récompense son engagement envers les auteurs et les créateurs en lui remettant cette année Le Prix Jean-Marie Drot.
Agrégé de philosophie et ancien élève de l’ENS de Saint-Cloud, François Hurard débute sa carrière en tant qu’attaché culturel à Montréal en 1983, avant de devenir enseignant à l’Université de Paris-VIll.
Sa nomination en 1998 au CNC en tant que Directeur du Cinéma est une étape majeure dans sa contribution au secteur audiovisuel. Il poursuit cette mission au ministère de la Culture en 2007, d’abord comme conseiller cinéma, puis comme inspecteur général des affaires culturelles en 2011. Parallèlement, il siège au conseil d’administration du Festival de Cannes jusqu’en 2013.
En réponse à la proposition de la Scam de concevoir une cinémathèque du documentaire, il rédige en 2015 un rapport pour le ministère de la culture, présentant des recommandations sur les modalités de sa création.
Avec Nicole Phoyu-Yedid, il coécrit en 2020 un rapport remarqué sur l’économie du podcast, L’écosystème de l’audio à la demande (« podcasts ») : enjeux de souveraineté, de régulation et de soutien à la création audionumérique, qui conduit un an plus tard à la création d’un fonds de soutien à la création sonore, la première aide publique pour ce secteur alors émergent.
François Hurard a aussi marqué le paysage culturel français par ses rôles de régulation et de gouvernance. De 1987 à 1998, il dirige l’observatoire des programmes de la CNCL, puis du CSA. De 2017 à 2023, il est Médiateur à la Cour des Comptes au sein de la commission de contrôle des organismes de gestion des droits d’auteur. Nommé Commandeur de l’ordre des Arts et des Lettres en 2022, il succède l’année suivante à Dominique Boutonnat comme administrateur de France Télévisions, représentant l’Etat.
Le prix Jean-Marie Drot lui sera remis à la Scam le 26 septembre 2024.
Ce Prix porte le nom de Jean-Marie Drot, membre fondateur et président de la Scam de 1995 à 1999, défenseur inlassable des arts, de la diversité culturelle et du droit d’auteur. Il honore celles et ceux qui, par leur engagement, œuvrent en faveur des autrices et des auteurs, de la culture et de la création.
Contact presse : 01 56 69 64 34 – presse@scam.fr
Auteur, réalisateur, producteur, enseignant, Jean-Marie Barbe est avant tout un « passeur de films documentaire d’auteur », et c’est avec reconnaissance que le conseil d’administration de la Scam lui a attribué le Prix Jean-Marie Drot 2022.
Auteur, Jean-Marie Barbe a réalisé une quinzaine de films documentaires, depuis Benleù Ben, la tradition orale en Cévennes (1979), jusqu’au portrait de Chris Marker, Chris Marker never explain never complain, avec Arnaud Lambert (2014). Citoyen du monde enraciné en Ardèche, il nourrit la conviction de rester en milieu rural afin de le transformer par le cinéma. Sous son impulsion, le festival Cinémas des pays et régions voit le jour en 1978.
Producteur, il crée en juin 1983 la société de production audiovisuelle Ardèche Images production qui compte à son catalogue plus d’une centaine de films réalisés par plus de quarante cinéastes, dont André S. Labarthe, Pierre Oscar Lévy, Christopher Walker, Caroline Buffard, Joëlle Janssen, Jacques Deschamps…
Passeur de films documentaires, Jean-Marie Barbe est à l’origine en 1988 du premier festival consacré au documentaire de création, Les États Généraux du film documentaire, à Lussas en Ardèche. Depuis, il n’a eu de cesse de poursuivre son action en développant une véritable « cité » du documentaire dans le village de Lussas : un pôle édition et distribution avec Doc Net Films, un pôle information avec Film-documentaire.fr, un pôle formation avec L’Ecole du doc, un pôle d’actions internationales avec DocMonde et Lumières du Monde… Dernière-née, la plateforme de S-VOD Tënk, spécialisée dans le documentaire de création, qu’il fonde en juillet 2016 et compte aujourd’hui 10 000 abonnés.
Ce Prix porte le nom de Jean-Marie Drot, membre fondateur et président de la Scam de 1995 à 1999, défenseur inlassable des arts, de la diversité culturelle et du droit d’auteur. Il honore celles et ceux qui, par leur engagement, œuvrent en faveur des autrices et des auteurs, de la culture et de la création.
Astrid Lockhart – 06 73 84 98 27 – astrid.lockhart@scam.fr
Chaque année, les Prix ATAA font honneur aux auteurs et autrices de l’ombre que sont les traducteurs. Découvrez les finalistes de cette nouvelle édition du Prix de la traduction de documentaires audiovisuels créé par l’ATAA avec le soutien de la Scam. Il sera annoncé et remis au cours de la soirée du jeudi 6 novembre à la Scam.
Pompéi, ses nouveaux secrets – épisode 1 « Des corps et des vies » (titre original : Pompeii – The New Dig, ep1 « The Bodies ») d‘Elena Mortelliti
Italie – 2024 – 55’ – Produit par LionTV et diffusé sur Arte, laboratoire Audiophase/Cinephase
Produite pour Arte France et la BBC, « Pompéi, ses nouveaux secrets » est une série documentaire captivante suivant la plus grande campagne de fouilles menée sur le site depuis plus de dix ans. Ensevelie en 79 apr. J.-C., Pompéi renferme encore de nombreux secrets qui sont désormais révélés dans ce reportage exclusif centré sur la vie quotidienne de ses habitants.
On peut ne pas adhérer à toutes vos saillies, n’empêche, quand vous l’ouvriez, ça avait de la gueule.
A Yvonne Baby, autre grande disparue de l’année qui vous interrogeait en mars 1960 sur A bout de Souffle, vous lâchiez : « Ce film est un documentaire sur Jean Paul Belmondo et Jean Seberg ».
« Jean Luc Godard n’a jamais opposé fiction et documentaire. Pour lui, un film, c’est d’abord voir, avant d’écrire et filmer. C’est un documentaire avec des acteurs, le personnage est d’abord filmé « documentairement » : telle est la clé pour rentrer dans le cinéma de Godard, sa marque de fabrique » analyse Marc Cerisuelo, professeur d’études cinématographiques à l’Université Gustave Eiffel.
En 1959, à propos de Moi un Noir, film de Jean Rouch, vous écriviez dans les Cahiers du Cinéma : « Mettons les points sur les “i”. Tous les grands films de fiction tendent au documentaire, comme tous les documentaires tendent à la fiction ».
Vous remettiez le couvert, si j’ose dire, en 1992 dans un entretien avec Artavazd Pelechian dans Le Monde : « Aujourd’hui la différence entre documentaire et fiction, entre un film documentaire et un film du commerce, même s’il se dit artistique, c’est que le documentaire a une attitude morale qui n’existe plus guère dans le film de fiction. La Nouvelle Vague a toujours mêlé les deux, nous avons toujours dit que Rouch était passionnant parce qu’à force de documentaire il fait de la fiction, et que chez Renoir, à force de fiction, il fait du documentaire ».
On vous salue Godard, membre de la Scam depuis 1989. Parmi la trentaine d’œuvres dont vous nous avez déclaré les droits, citons : la série « Histoire(s) de cinéma » avec « Toutes les histoires », « Une histoire seule », « Seul le cinéma », « Fatale Beauté », « La Monnaie de l’absolu », « Une vague nouvelle », « Le Contrôle de l’univers », « Les Signes parmi nous »… et la série « Six fois deux / Sur et sous la communication », réalisée aux côtés de Anne-Marie Miéville.
Rémi Lainé, réalisateur, président
Pour son podcast L’Île sous la mer, Camille Juzeau est allée à la rencontre de collégiens et de collégiennes sur l’île de Petite-Terre à Mayotte. En nous dévoilant les coulisses de son enregistrement, elle nous raconte une terre secouée, entre tremblements de terre et violence, où la jeunesse îlienne dévoile des chemins de vie empreints de ces réalités qui s’entrechoquent, mais n’empêchent finalement pas les histoires d’enfant d’exister.
Tout au bout de l’île de Petite-Terre, 12 kilomètres carrés accrochés au flanc ouest de Mayotte et reliés par une barge, le collège de Pamandzi est déjà un peu sur les hauteurs.
Je dois y rencontrer des élèves de troisième pour le podcast que je suis venue enregistrer ici. À l’accueil, ils ont l’air préoccupés. Des parents sont là, des enseignants, les discussions semblent animées. Le professeur d’histoire-géo me cueille quelques minutes plus tard et m’explique : « Un règlement de compte est survenu hier soir dans le quartier : deux gamins de 12 ans ont été assassinés, décapités par d’autres du même âge. »
Il poursuit : « Une bonne partie des parents n’ont pas voulu laisser leurs enfants venir au collège ce matin, ils s’inquiètent pour leur sécurité. Ces derniers temps les violences ont augmenté, la Covid n’a pas aidé. » Nous sommes en janvier 2021, entre deux confinements. Tandis qu’il me parle, nous montons à l’étage, vers les classes. J’aperçois le proviseur par la porte ouverte de son bureau, il est au téléphone, l’air un peu dépassé par la situation.
Le professeur d’histoire-géo est calme, lui. Je lui dis que je peux revenir plus tard dans la semaine, mais il a déjà ouvert la porte d’une classe. Aux dix élèves présents, il demande : « Coucou les jeunes, qui veut parler du nouveau volcan au micro de la dame ? » Ça ne se bouscule pas, timidité des adolescents. Il en interpelle un ou deux gentiment, qui se lèvent, finalement pas mécontents. Je me dis que c’est pour eux une bonne excuse pour sécher le cours de SVT qui débute. Même chose dans la classe attenante où je me retrouve avec sept collégiens qui me sourient et chahutent entre eux. Ces mêmes collégiens qui connaissent sûrement les victimes ou les bourreaux des sinistres événements de la veille.
J’ai coupé la clim pour le son, et la chaleur envahit la salle de classe du préfabriqué où nous nous sommes installés. Djounaidi, 14 ans, s’est proposé pour commencer. Tout en faisant les tests micro je lui demande comment il va et il me raconte que ce sont ses cousins qui ont été tués. Ça s’est passé sur la colline de Pamandzi, derrière l’école, là où il habite.
Ces collines, couvertes de végétation haute, abritent des maisons en tôle, les bidonvilles de Mayotte sur Petite-Terre et Grande-Terre. Y logent surtout les Comoriens sans papiers. Dans la jungle, les descentes de police sont moins aisées.
Djounaidi est d’Anjouan. Soixante-dix kilomètres de mer séparent cette île des côtes françaises de Mayotte. Soixante-dix kilomètres que ses parents et lui, petit à l’époque, ont traversé de nuit, à bord de « kwassa-kwassa », minuscules bateaux de pêche. Le prix de cette périlleuse traversée ? Entre 700 et 1 000 euros, l’équivalent d’une année de travail aux Comores, l’un des pays les plus pauvres du monde. Une somme que beaucoup de Comoriens, aspirant à rejoindre les côtes françaises, continuent de payer aux passeurs aujourd’hui.
Le département, qui comptabilise la moitié des reconduites aux frontières françaises, a vu croître le nombre de mineurs isolés sur l’île. En 2015, le Défenseur des droits en recensait 3 000, sans famille et sans papiers. Sans ressources. Alors il y a l’errance, et la baston. Ça le met en colère, Djounaidi, cette violence qui défigure son île. La violence qui colle à la peau est là, latente, tout autour d’eux.
Mais dans ce préfabriqué où nos peaux sont déjà moites et où nos masques collent au visage, ce n’est pas cette histoire que je suis venue lui faire raconter. Alors je lui pose les questions que j’ai griffonnées sur un carnet : l’île comment est-elle ? Et la mer ? Et ce volcan sous-marin qui a surgit d’un coup au large de Petite-Terre ?
Il se prête au jeu facilement, raconte les tremblements de terre qui ont secoué l’île depuis 2017 ; la montée des eaux, l’inondation des routes ; l’arrivée des scientifiques de métropole à bord du Marion Dufresne, le bateau d’étude océanographique et de ravitaillement des Terres australes et antarctiques françaises. Mais il conte aussi ses excursions avec ses frères et sa sœur autour de l’ancien cratère devenu lac, vert fluo et acide ; les histoires que sa mère lui rapporte, les souvenirs qu’elle a de sa vie sur l’île comorienne ; sa grand-mère, restée là-bas et qu’il n’a pas revue depuis des années ; les nuits où il observe les étoiles et qu’il se prend pour un pirate, et les matins où les oiseaux multicolores piaillent à ses fenêtres. Sa sœur qui veut devenir ornithologue et lui policier.
Sa réalité : tout cela à la fois.
Sur la barge, je divague en regardant la mer, chargée de chacune des histoires qui constituent la complexité d’un réel, qu’un documentaire ne peut qu’effleurer, et pourtant.
Camille Juzeau
Puis chacun des six autres avec leurs mots sortis de l’enfance racontent les évolutions liées à la naissance du géant sous-marin qui a fait perdre douze centimètres à leur île. Ça charrie gentiment, certains sont timides, d’autres attirés par le micro. On a ri, finalement, cet après-midi-là. Ils ont pensé un peu à autre chose, c’est ce que je me dis.
En reprenant la route en sens inverse, en fin de journée, je marche longuement le long de la nationale, guettant un bus censé passer en ce lieu. On m’a dit de ne pas traîner dans les parages. Alors quand, à un angle de rue, j’aperçois un gars qui s’approche de sa voiture et me voyant un peu perdue me fait signe de monter, je n’hésite pas. En roulant vers la mer, il me parle. Il me dit qu’il vit là, à Petite-Terre, depuis cinq ans. Il a fui la Syrie, réfugié politique. On doit avoir à peu près le même âge. Il me parle des fêtes qui ont lieu ici, et me propose de revenir le samedi suivant.
Sur la barge, je divague en regardant la mer, chargée de chacune des histoires qui constituent la complexité d’un réel, qu’un documentaire ne peut qu’effleurer, et pourtant.
J’élague des parties entières du réel pour construire une bonne histoire.
Camille Juzeau
Paris, quelques semaines plus tard. Face à mon ordinateur, je coupe et découpe les paroles, les mots, les ambiances de la mer ou des oiseaux enregistrés à Mayotte. Je réécoute Djounaidi, le professeur d’histoire-géo… Et aussi la dame mahoraise qui m’a ouvert sa maison – alors que ces maisons sont difficiles d’accès aux blancs – et qui, malgré sa gentillesse, s’énervait pourtant que trop de Comoriens transforment l’île autrefois si calme. La faute, pensait-elle, leur revenait. J’élague des parties entières du réel pour construire une bonne histoire. Un récit avec un début percutant, des cliffhangers et des scènes fortes, car il faut embarquer l’auditeur.
Mais face à mon écran, j’ai encore en tête imprimés les yeux brillants de Djounaidi, celui qui se rêvait pirate.
***
Après des études en sciences du vivant et en histoire et philosophie des sciences, Camille Juzeau se lance notamment dans le journalisme avec l’écriture de chroniques pour Radio France, avant de devenir autrice et réalisatrice de ses premiers podcasts, et d’ajouter à ses compétences celle de productrice. En parallèle, elle poursuit ses nombreuses collaborations à la radio.
À l’occasion du festival Frames 2024, le Prix de la vulgarisation de la Scam a été décerné à Carl-Maxence Vinh, de la chaîne Youtube ARCHITEKTON, pour son œuvre « Pourquoi ASSASSIN’S CREED est plus VRAI que l’Histoire ? »
https://www.youtube.com/watch?v=oIv2zUEWzrM
De l’Antiquité grecque à la Révolution française en passant par les Croisades, Assassin’s Creed nous fait revivre les périodes qui ont marqué l’Histoire. Mais d’un point de vue architectural et urbain, que valent ces modèles numériques ? On va enquêter sur le processus de reconstitution historique des équipes créatifs d’Ubisoft pour comprendre ce que Assassin’s Creed dit de notre rapport à la culture.
À l’occasion du festival Frames 2022, le Prix de la vulgarisation de la Scam a été décerné à Emmanuel Gougeon, chaîne Feedback Chroniques, pour son œuvre Des Mythes au storytelling : pourquoi ce besoin de nous raconter des histoires ?
Des mythes anciens aux écrans publicitaires, des contes fantastiques aux campagnes présidentielles, les récits font partie de ces choses auxquelles on ne prête pas beaucoup d’attention bien qu’ils nous accompagnent depuis nos origines, traversent nos sociétés, influencent notre quotidien. Alors essayons de considérer, non pas comme une évidence, mais comme une curiosité, le fait que les récits et les fictions narratives occupent à ce point nos esprits.
Après avoir effectué un master en science politique et sociologie à l’université Lyon 2 puis un master en histoire des sciences et des techniques à l’EHESS, j’ai voulu prolonger les recherches que j’avais entreprises sur la circulation des savoirs à un niveau plus expérimental, en travaillant à la diffusion des sciences sociales, dans une optique interdisciplinaire et auprès du grand public. Ce projet a abouti aux chroniques Feedback.
Accords signés entre OCS, les syndicats de producteurs et distributeurs audiovisuels et les sociétés d’auteurs.
OCS, les syndicats de producteurs et distributeurs audiovisuels (AnimFrance, SATEV, SEDPA, SPECT, SPI et USPA) et les sociétés d’auteurs (SACD et Scam) ont conclu des accords interprofessionnels dans le cadre des décrets n°2021-1924 du 30 décembre 2021 et n°2021-793 du 22 juin 2021.
Acteur important et singulier de la production audiovisuelle depuis plus de 10 ans, comme en témoignent ses deux labels de création « OCS Signature » et « OCS Originals », OCS a souhaité porter son obligation d’investissement dans la production audiovisuelle patrimoniale de 6 à 7% du chiffre d’affaires net de l’exercice précédent pour soutenir une politique éditoriale ambitieuse et diversifiée.
Les parties se sont mises d’accord sur un certain nombre de modulations de la contribution d’OCS autorisées par les décrets.
Les accords conclus entrent rétroactivement en vigueur au 1er janvier 2022, pour une durée de trois ans. OCS, les syndicats de producteurs et distributeurs audiovisuels (AnimFrance, SATEV, SEDPA, SPECT, SPI et USPA) et les sociétés d’auteurs (SACD et Scam) se félicitent du renouvellement de leur partenariat au bénéfice de la création française.
Scam – Astrid Lockhart – astrid.lockhart@scam.fr – 06 73 84 98 27
OCS – Isabelle di Costanzo – isabelle.dicostanzo@orange.com – 06 08 71 42 99
OCS – Ludovic Gottigny – ludovic.gottigny@orange.com – 06 77 07 10 28
SACD – Agnès Mazet – agnes.mazet@sacd.fr – 06 85 12 29 59
AnimFrance & Uspa – Stéphane Le Bars – s.lebars@uspa.fr – 06 60 23 53 96
Satev – Florence Braka – f.braka@ffap.fr – 06 03 51 70 18
Sedpa – Emmanuelle Jouanole – ejouanole@terranoa.com – 06 33 68 36 54
Spect – Vincent Gisbert – vincentgisbert@spect.fr – 06 18 01 54 34
SPI – Emmanuelle Mauger – emauger@lespi.org – 06 63 01 83 06